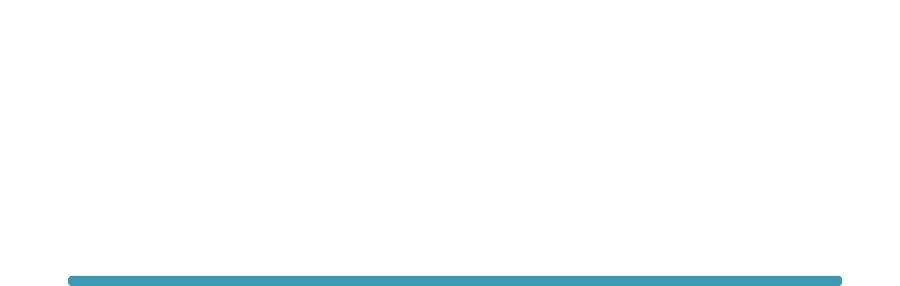Les recherches impulsées par Florence Faberon et Claire Marliac au sein du Centre Michel de L’Hospital de l’Université de Clermont Auvergne se révèlent toujours d’une exceptionnelle richesse dans le domaine social et médico-social. L’intérêt réside dans la méthode utilisée qui, pour la recherche universitaire, met au premier plan la pluridisciplinarité, indispensable dans un tel domaine. Elle y joint le droit comparé comme a pu en témoigner le colloque de Winnipeg (Manitoba, Canada) de juin 2018, « Regards croisés sur le handicap en contexte francophone » et surtout, elle donne une place privilégiée aux acteurs sans lesquels le chercheur, isolé dans son laboratoire, ne pourrait pas comprendre pleinement son domaine et se priverait d’expériences et pratiques qui permettent d’anticiper souvent des évolutions législatives et réglementaires nécessaires. Ces acteurs sont, bien sûr, tous les professionnels qui travaillent dans le domaine social et médico-social, mais aussi les collectivités territoriales et avant tout le département, point d’ancrage de ce secteur et dont le rôle essentiel est malheureusement trop méconnu. Cet écueil est évité ici avec la Direction générale des solidarités et de l’action sociale du Puy-de-Dôme et le Comité d’éthique du conseil départemental coorganisateur de cette manifestation. La participation de François Roche, Président du comité d’éthique du conseil départemental du Puy‑de‑Dôme et est une parfaite illustration de nos propos. Il faut ajouter le soutien de partenaires privés qui encouragent aussi dans cette voie. Ainsi en est-il de la CASDEN et de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes au statut coopératif, qui contribuent à ce que de telles recherches puissent émerger.
Cette publication consacrée au thème « secret professionnel, partage d’information et éthique en matière sociale et médico-sociale » est issue des actes du colloque qui s’est tenu les 6 et 7 juin 2019.
Quelle peut être la place de l’information en matière sociale et médico-sociale ? Et pour le juriste se posera immédiatement la question de son statut. À l’époque des réseaux sociaux, l’information est déferlante. Mais toute information – sous réserve bien évidemment qu’elle soit exacte – est-elle bonne à dire ?
On se heurte à un paradoxe. On veut répondre à des exigences contradictoires. On veut préserver ces droits fondamentaux que sont devenus aujourd’hui le droit à la vie privée, le droit à la protection des données personnelles évoqué par Aurélie Virot-Landais, et simultanément on veut mettre en avant le droit à l’information considéré comme un des socles de la démocratie et qui vient heurter des droits revendiqués par les individus ou par l’État. À cet effet, on constatera une volonté de revendication du secret de certaines informations et en même temps une volonté de partage de l’information. On voudra taire l’information (I) mais aussi la dévoiler (II). Comment résoudre cette contradiction ?
I. Taire l’information
On pourrait s’abriter derrière le dieu Harpocrate mentionné au début de cette publication, considéré par certains comme le dieu du silence. Mais cette interprétation n’est pas exacte et sans contradiction nous devrons parler du silence, un silence revendiqué à travers le secret professionnel, mais aussi un silence auquel il est porté atteinte souvent illégalement.
A. À la recherche du secret professionnel
Taire l’information est souvent une revendication. Cette revendication d’une protection de l’information, classiquement, était illustrée par le secret médical et a pu trouver des développements par la reconnaissance du secret professionnel à d’autres professions. À cet égard, on évoquera, comme justification du silence, la déontologie ou l’éthique, deux concepts qui ne sont cependant pas identiques.
Les juristes connaissent bien la déontologie même si les comités d’éthique se sont développés depuis quelques années. Les élèves avocats, lors de leur examen professionnel, subissent une épreuve de déontologie à laquelle les responsables de la profession tiennent tout particulièrement. L’idée d’éthique apparaît peut-être plus récente chez les juristes et elle nous amène plus à la morale ou à la philosophie. C’est un « positionnement », souligne Saül Karsz qui en montre l’ambiguïté avec le risque des « éthiques partisanes », car elle est un « espace de luttes, d’accords et de désaccords ».
Cette publication veut évoquer le « partage de l’information » mais aussi l’information gardée secrète. Il faudra comme pour toute recherche s’interroger sur les termes utilisés. Qu’est-ce qu’une information ? Et on place cela en regard du secret professionnel. Mais qu’est-ce que le secret ? Et qu’est-ce que le secret professionnel ? Le juriste aura le réflexe de se tourner vers un dictionnaire de termes juridiques et plus particulièrement vers celui qui en semble la bible, le dictionnaire du Doyen Cornu auquel emprunte à juste titre Claire Magord. C’est que le Code pénal ne définit pas réellement le secret professionnel.
Lorsqu’on évoque l’idée de partage d’information, on pensera ici à l’idée de « secret partagé ». Cette notion ne figure dans aucun texte. En revanche l’article L. 226-2-2 du CASF évoque le partage « d’informations à caractère secret ». Le partage d’information conduit, comme l’ont montré Patricia Sicard Kalka et Anne Dépinoy avec l’expérience du comité d’éthique du département du Nord, à une « relecture des pratiques ».
Le partage d’information qui prend une place de plus en plus grande dans le domaine social et médico‑social conduit à de nombreuses interrogations. Il en est ainsi avec la question du consentement éclairé pour tout acte de soin, ainsi que pour la prise en charge d’une personne par un établissement ou service social ou socio-médical exposée par Maître Anne-Marie Regnoux. Cette question se pose avec acuité principalement pour les personnes accompagnées.
On sait que certaines professions, malgré leurs revendications, se voient refuser le secret professionnel. C’est notamment le cas des journalistes qui se sont toujours heurtés à un refus du législateur pour une telle reconnaissance. La seule avancée pour eux a été sur la protection des sources avec la loi – bien décevante – du 4 janvier 2010 conduisant à un nouvel article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Sans doute pose-t-elle de façon un peu solennelle que « le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public ». Mais bien vite elle apporte des exceptions. Une atteinte peut intervenir « si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi », même si « cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources ».
Le texte pose qu’il « est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité ». Fort heureusement la Cour européenne des droits de l’Homme a pu se montrer ferme à ce sujet, décidant à l’unanimité en faveur de la protection dans son arrêt Becker c. Norvège1.
La Cour avait depuis longtemps pris position avec l’affaire Goodwin c. Royaume-Uni en 1996 en affirmant que « la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre d’États contractants et comme l’affirment en outre plusieurs instruments internationaux sur les libertés journalistiques… L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de “chien de garde” et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie. Eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l’effet négatif sur l’exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public2 ».
B. La violation de l’information protégée
C’est sans doute parce que le secret professionnel ou le secret de l’information s’étend à de plus en plus de professions qu’il connaît en même temps de nombreuses exceptions pouvant facilement conduire par une interprétation large à sa violation. Ainsi que le souligne Antoine Guillet, l’institution est devenue « plurielle » et de ce fait souvent contestée car « le secret est un moteur de la relation humaine ». C’est pourquoi la protection du secret professionnel présente sans doute beaucoup plus d’intérêt aujourd’hui et cette publication a voulu y consacrer une place importante en y consacrant la fin de ses travaux.
Les titulaires d’un secret professionnel ont vu leur nombre s’élargir. À l’origine on trouvait les médecins, le serment d’Hippocrate posant que « Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs ».
Le Code pénal de 1810 dans son article 378 évoquait seulement « les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie ». Le nouveau code de 1992 évite le recours à la l’énumération des professions concernées, préférant une formulation ouvrant la voie à beaucoup de possibilités, notamment dans le domaine social et médico‑social car ce sont de nombreuses lois hors du Code pénal qui permettront à encore plus de professionnels de bénéficier des dispositions de l’article 226-13.
Sa violation peut être sanctionnée avant tout par le juge pénal et c’est évidemment à lui qu’on pense immédiatement car la première référence utile est celle du Code pénal. Mais le juge civil peut être compétent même si comme l’a rappelé Marie Nicolas-Graciano les décisions sont rarissimes.
Mais on aurait aussi tort d’oublier le rôle du juge administratif comme l’a montré Hervé Rihal. L’administration peut voir sa responsabilité mise en cause pour faute de service, mais la responsabilité de l’agent peut intervenir soit dans l’hypothèse d’une faute personnelle détachable du service ou bien par la reconnaissance d’une faute disciplinaire.
II. Partager l’information
Plus que jamais, il y a une exigence de connaître l’information, et le secret posé par la loi peut être dévoilé. Il peut l’être aussi d’une façon très médiatique avec les lanceurs d’alerte.
A. Le secret dévoilé
L’article 226-14 du Code pénal envisage le dévoilement du secret professionnel considérant que dans certains cas cela est possible. Le secteur social et médico-social est particulièrement concerné.
Dans certaines hypothèses le professionnel aura la possibilité de dévoiler l’information. Il aura ce que Claudia Quica-Lemarchand appelle une « option de conscience ». Il n’y a pas obligation mais s’il révèle, il sera exempté des sanctions prévues par l’article 226-13 du Code pénal. L’alinéa 1 vise à protéger les personnes vulnérables victimes de privations et de sévices. L’alinéa 2 vise seulement les médecins et tous les professionnels de santé qui pourront saisir le Procureur de la République ou la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes, mais à condition pour les personnes majeures et non-vulnérables d’avoir leur accord. Le troisième alinéa est très particulier et peu usité, concernant les personnes détenant une arme.
Le professionnel agissant dans le cadre de cet article bénéficiera d’une protection que nous retrouverons avec les lanceurs d’alerte.
Le Code pénal, dans la section relative aux entraves à la justice, exempte les personnes visées à l’article 226-14 d’obligations touchant tout citoyen pour empêcher certains crimes.
B. Le secret médiatisé
La notion de lanceur d’alerte est apparue il y a une trentaine d’années en France, s’inspirant des « whistleblowers » (souffleurs de sifflet) anglo-saxons. Mais on pourrait remonter à Deep Throat dans l’affaire du Watergate3. Parce que certains lanceurs d’alerte ont eu recours aux médias, ils ont acquis une notoriété les exposant parfois à certains risques. Il suffit de penser à Julian Assange et Wikileaks et aux lanceurs d’alerte dans le cadre du « LuxLeaks ».
La France a essayé d’encadrer ces lanceurs d’alerte avec, là encore, la gestion d’un paradoxe qui fait que les lanceurs d’alerte, par les révélations de certains scandales, ont su montrer leur forte utilité, mais en même temps il a pu apparaître aux autorités qu’il y avait un risque dans la divulgation d’informations qui à leurs yeux devraient rester secrètes. Un statut bien insuffisant a été créé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II ». Le lanceur d’alerte devra obéir à certaines conditions, notamment agir de manière désintéressée et de bonne foi, avoir une connaissance personnelle des faits et enfin respecter une procédure par palier.
L’intérêt de cette législation est d’avoir élargi le champ d’intervention. Auparavant seule la dénonciation de crimes protégeait les lanceurs d’alerte, tenus de les dévoiler faute de quoi ils s’exposaient à une sanction pour non-dénonciation de crimes. Maintenant le lanceur d’alerte peut intervenir en cas de « violation grave et manifeste » d’une norme juridique et de « menace ou préjudices graves pour l’intérêt général ». Mais l’intérêt de la loi est peut-être surtout de protéger le lanceur d’alerte à la fois sur le plan pénal et, plus intéressant, sur le plan professionnel, puisqu’il ne pourra être sanctionné, licencié ni même être l’objet de discrimination. Le lanceur d’alerte prend en effet souvent de grands risques pour lui-même et aussi pour ses proches.
Mais on n’a pas voulu ouvrir largement les possibilités et la procédure exigée freinera à coup sûr nombre de lanceurs d’alerte, notamment parce qu’il doit y avoir saisine préalable des instances de direction de l’établissement.
La protection des lanceurs d’alerte a été singulièrement confortée par la Cour européenne des droits de l’homme en 2008 dans l’arrêt Guja c. Moldavie4 décidé à l’unanimité. Elle détermine six critères pour examiner l’action du lanceur d’alerte (les recours à sa disposition ; information divulguée devant servir l’intérêt général ; authenticité de l’information ; préjudice causé par la divulgation ; bonne foi du lanceur d’alerte ; nécessité ou non des sanctions infligées).
Pour conclure, la soif d’information(s) que semblent développer les nouvelles technologies et plus particulièrement les réseaux sociaux souvent favorisés par une irresponsabilité de fait, a pu conduire à s’interroger sur la portée pratique du secret professionnel aujourd’hui. Largement développé en raison de l’importance du champ social et médico-social, il résiste difficilement à son intangibilité. Le secret professionnel peut-il être absolu ? Rien n’est moins sûr. Il faudra que le droit s’en empare à nouveau pour l’appréhender afin de préciser très exactement ses contours. Ce colloque et cette publication auront été utiles à cet effet car des pistes ont été explorées grâce aux chercheurs et aux praticiens. Elles permettront sans doute d’aller plus loin dans les interrogations que suscitent aujourd’hui secret professionnel et partage d’information. Bien évidemment la dimension éthique devra éclairer la recherche car elle a à trouver sa véritable place dans ce débat, les juristes étant souvent moins à l’aise pour l’intégrer comme nous avons pu le constater pendant ces travaux stimulants.