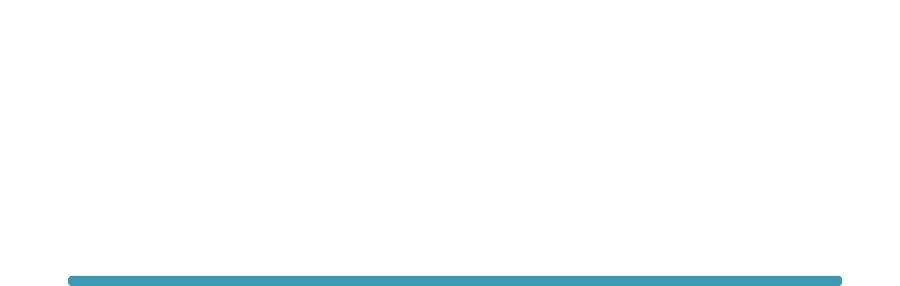Introduction : de la sainteté d’un principe
« Les reliques d’un principe ». L’intitulé du colloque qui fournit matière au présent exposé interpelle le médiéviste. Les reliques sont des restes matériels du passé qui ont pour caractéristique d’être saints puisqu’ils sont une partie de la dépouille du saint ou bien un objet lui ayant appartenu, ayant été en contact avec les ossements ou le tombeau. Les historiens ont questionné l’état des saints et relevé que les hommes saints étaient parfois féminisés, dans des constructions allégoriques d’allaitement, tandis que les femmes saintes sont virilisées à la mode médiévale, négligeant les tâches du foyer et faisant preuve de raison et de courage, voire recevant de Dieu une barbe leur permettant d’éviter les mariages et protéger leur chasteté. Certains ont donc parlé d’un troisième genre saint, tandis que d’autres ont analysé les saints comme un laboratoire des variables possibles fondées sur les genres masculin et féminin1.
Bien entendu, j’entends le sens commun que les organisatrices ont souhaité attribuer au terme dans l’intitulé mais l’emploi témoigne de la puissance évocatrice du mot, a fortiori en affichant la fracture d’une statue de marbre. Ce marbre, immaculé, alors qu’ils étaient peints de couleurs vives dans l’Antiquité, est une reconstruction esthétique visant à éloigner les bigarrures orientales et marquer la rupture politique avec la méditerranée et l’Europe occidentales2. Voilà donc un canon de beauté fracturé, victime de l’iconoclasme d’une société qui ne saurait conserver le « beau » en l’état. Cela ouvre un certain champ de questions : le droit, en tant que technologie du langage et de l’abstraction, peut‑il avoir des reliques ? Et ces reliques sont‑elles des restes voués à disparaître ou bien un substrat insoluble dans le bouillon de notre culture juridique ? Doit‑on vénérer des discours juridiques ? L’état des personnes est‑il naturel ou soumis aux transformations du droit positif et des sociétés ?
Il est vrai que l’expression « d’état des personnes » interpelle dans le sens où le status évoque une position fixe, immuable, une pérennité. D’où l’emploi au Moyen Âge de ce terme, au génitif, en lien avec les communautés politiques : l’état du royaume, de la cité, de la communauté. Elle donnera naissance à cette expression puissante qui gouverne le monde actuel : l’État.
Ainsi, l’état des personnes est lié aux transformations et permanences de l’État lui‑même, l’état civil des personnes étant lié à leur état politique. Dans l’esprit du Code civil de 1804, c’est la « présomption de la loi » qui garantit l’état des personnes, présomption née du caractère public et solennel du mariage car, le souligne Portalis :
Les opérations de la nature dans le mystère de la génération, sont impénétrables3.
Il ne pouvait imaginer que, deux cents ans plus tard, il serait possible de lever une bonne partie de ces mystères, au point que les individus eux‑mêmes en devinssent les maîtres par la science médicale4.
Malgré une surveillance de plus en plus serrée des citoyens par les technologies numériques, l’État perd le contrôle sur les corps et ne peut plus se réfugier derrière l’ignorance qui a forgé l’état des personnes. Et cette fin du contrôle étatique sur les corps serait‑elle une « bonne » chose ? Le principe est si ancien et ancré dans la culture juridique que le juriste et le citoyen s’inquiètent de le voir attaqué. Qui désapprouverait le confort d’une situation binaire ? Qui ne rêve d’équilibre et de juste milieu aristotélicien à atteindre entre le défaut et l’excès ? Or, depuis plusieurs décennies, la pression est forte, qu’elle soit sociale ou de la Cour européenne des droits de l’homme, pour briser ce qui semblait immuable et, oserais‑je dire, « naturel ».
Le respect de la vie privée, masque d’un individualisme libéral, peut‑il disloquer la communauté politique dans ses fondements traditionnels ? Cette vie privée a été bâtie au xixe siècle à partir du combat contre les injures et les calomnies, en particulier par voie de presse5. Ce qui est en cause est la recherche de la « vérité » entendue dans un sens juridique et sous le règne de la loi. Auparavant, ce qui justifiait le secret de la vie privée était l’honneur, avant toute chose. Toutefois, si une culture de la transparence est peu à peu née à l’époque contemporaine dans la sphère publique, elle a mis beaucoup plus de temps à pénétrer la sphère privée6. Aujourd’hui, la manière de « faire connaissance » est bouleversée par les outils numériques. Il n’y a plus de culture de la discrétion ni de respect du « secret de l’autre7 ».
Dans un tel contexte, comment refuser aux individus le droit de modeler cette vie qui n’est plus celle d’un sujet, ni même d’un citoyen, mais d’un individu qui s’adapte aux contraintes et autorisations sociales, en décalage avec la tradition juridique ? Une société politique peut‑elle autoriser l’expression de tant d’individualités et limiter les injonctions sociales au strict minimum ?
Deux distinctions primordiales émergent dans l’histoire de l’état, tout d’abord celle par le nom (I), puis par le sexe (II), démontrant la longue incapacité à penser par le droit la non‑binarité (III).
I. La distinction par le nom : une construction moderne de l’État
La globalisation des enjeux politiques, économiques, écologiques et des capacités de communication des individus entre eux ont un impact fondamental sur le rôle des identifiants juridiques des personnes, à savoir leur nom et leur sexe. Ces identifiants de l’individu, en particulier le nom, sont aussi un moyen de « situer socialement8 ». Au départ, rappelons que les noms ont été formés par le seul usage : noms de baptême (en grande majorité9), toponymes, qualités, métiers, voilà les matrices essentielles des noms en France, qui n’étaient au départ que des surnoms à côté du nom de baptême :
Tout nom propre fut à l’origine un nom commun10.
Toutefois, cette transition de la liberté de se donner des noms correspondant à l’environnement social immédiat, au nom gravé dans le marbre d’une pièce d’identité nationale est un processus très long qui va de pair avec le développement technologique et la capacité effective de contrôle de l’État sur les individus.
La France n’est pas passée de manière brutale d’un statut de liberté médiéval à un contrôle serré de l’État au xvie siècle par le jeu d’ordonnances, dont certaines se sont d’ailleurs avérées légendaires11. L’ordonnance de Blois de 1579, rendant obligatoire l’enregistrement des baptêmes, mariages et sépultures, n’en demeure pas moins un jalon essentiel.
Quiconque a effectué un travail généalogique sait combien l’orthographe du nom est fixée par le scribe lui‑même et donc très sensible aux changements de mains, avant la machinisation de l’écriture. Même des noms à peu près fixés localement au xviiie siècle subissent des mutations lorsque des officiers d’état civil laïcs souvent bien moins lettrés que les prêtres, ont pris le contrôle des registres sous la Ire République.
La tendance générale durant l’époque moderne est donc celle d’une difficulté croissante de changement de nom, a fortiori lorsque sont en jeu des noms de fief ou de seigneurie qui deviennent patronymiques12. L’interdiction des surnoms à l’époque révolutionnaire n’empêche pas leur emploi récurrent dans les arrêts et jugements, processus d’identification mais aussi, parfois, d’information psychologique ou physique du prévenu, du « méchant » au « cul de plomb13 ».
La Révolution a poursuivi l’œuvre monarchique en rigidifiant le nom dans le but avoué de faire disparaître les particularismes sociaux. Il est d’autant plus remarquable de constater, d’une part que les stratégies de distinction sociale se sont aujourd’hui déporté sur le prénom, d’autre part que c’est par le biais de particularismes intrafamiliaux, voire individuels, que le nom devient de plus en plus disponible.
II. La distinction par le sexe : naturalisation du droit et de la médecine
Autre élément d’identification et de distinction dans l’état des personnes : le sexe. Le sujet est plus complexe puisqu’il est bien plus simple d’évoquer ici la nature. Aujourd’hui, cette question dépasse celle du sexe et touche au fond, à toutes les situations d’exclusion liées au corps, qu’il s’agisse de handicap ou de transformations et mutilations dues à la maladie ou à des pratiques sociales14.
La question de l’identification par le sexe est fondamentale dans le sens où elle est inscrite dans l’état civil qui ouvre les droits à la citoyenneté. En outre, n’oublions pas que les hiérarchies femme‑homme qui sont combattues chez nous dans le champ social et professionnel, sont encore des réalités juridiques dans certains pays, notamment en matière de succession15. Ces questions sont autant d’injonctions sociales autour de la normalité et de l’intégration dans un environnement sédentaire rigide. Les rapports à l’altérité sont trop souvent perçus comme une entrave au déroulement simple et linéaire du monde, une somme hétéroclite de particularismes et de nuances nuisibles au bien commun.
Le dimorphisme sexuel femme‑homme a été fondé, au moins jusqu’au milieu du xviiie siècle sur le ton de l’analogie, sur un rapport de contraste plutôt qu’une distinction radicale qui s’impose ensuite. Ainsi la femme est un « homme mutilé » selon Savonarole au xvie siècle et réduite à des fonctions de reproduction puisqu’elle incarne le corps et l’homme l’esprit, le froid et l’humide féminin par rapport au chaud et sec masculin selon la théorie des humeurs, elle‑même fruit d’une observation des éléments naturels appliqués à l’être humain16. Dans la continuité des principes d’Hippocrate et de Gallien, les sexes féminin et masculin sont perçus comme une inversion l’un de l’autre (interne/externe) avant les progrès en dissection qui ont conduit à la naturalisation de l’existence de deux catégories sexuelles distinctes et étanches17.
III. Distinguer l’indistinct : l’intersexuation
Dans un tel cadre, l’intersexuation, dépassant le cadre restreint de la seule figure construite de l’hermaphrodisme, ne peut exister, et la médecine s’est évertué à corriger cet état afin de construire un sexe en fonction de celui qui apparaît comme dominant aux yeux des médecins. La détermination du sexe est fondamentale, sous le contrôle du pouvoir car, à l’image du roi souverain absolu défini par Jean Bodin, délié et ne pouvant se lier lui‑même :
Le sujet ne peut vouloir contre lui‑même18.
La détermination du sexe est un enjeu social, ordonnant des séries de relations. En histoire du droit, l’intersexualité est un sujet bien plus présent que la transsexualité qui est invisible dans les anciens droits19 – le terme date des années 1950 – car sa reconnaissance suppose une « conjonction entre une offre psychiatrique nouvelle, des demandes en droit naissantes et une technique médicale en constante progression qui assure la reconnaissance, le diagnostic et la clinique du changement de sexe20 ». Cette histoire a fait l’objet de nombreuses études qui, même lorsqu’elles ne sont pas juridiques, reposent en partie sur des sources, en particulier les procès mais aussi les registres paroissiaux et d’état civil21.
Le hasard des dépouillements avait attiré mon attention sur une note marginale à un acte de naissance du 10 août 1822, rapportant le jugement du tribunal de Vienne du 3 juillet 1851 qui ordonne le remplacement du terme féminin par masculin et substituant le « véritable » prénom Claude à celui de Madeleine22. Les juges estiment que l’acte de naissance est entaché d’une erreur matérielle évidente et que cette modification est liée à l’intention du requérant de contracter un mariage qui a effectivement eu lieu deux jours plus tard, avec des enfants à venir23. Rien dans le texte ne laisse deviner les interventions qui ont peut‑être permis cette transformation, si jamais elle avait eu lieu. Cela dit, à supposer que l’officier d’état civil ait été négligent et n’ait pas vérifié le sexe de l’enfant24, ce qu’il n’est d’ailleurs pas tenu de faire et ce à quoi les familles s’opposent parfois25, il apparaît peu probable qu’il confonde, sur le fondement d’une déclaration, Madeleine avec un prénom masculin et en tire les conséquences de genre.
Un cas plus saisissant et explicite a été relevé au xviie siècle dans les archives d’Eure‑et‑Loir26. Anne Brunet est baptisée le 9 mars 1660. Une note marginale à l’acte de baptême indique qu’elle s’est « trouvée hermaphrodite » mais que « le sexe masle ayant prevalu et recogneu par la medecine », elle fut appelée François par l’évêque d’Orléans le 16 juin 1669, en lui « donnant le sacrement de confirmation en foy ». Malheureusement,
Francois ayant été cousu/refermée par un medecin pour ce qui paroissoit féminin, mourut la 14e année de sa vie par l’impertinence de la médecine, ayant toujours esté malade de la langueur depuis sept ans de cette opération notamment dans la perte de ses purgations.
Tout cela est par ailleurs rappelé dans son acte d’inhumation du 16 août 1676.
Ces deux exemples d’époque moderne et contemporaine, illustrent l’exigence relevée par Michel Foucault visant à faire correspondre « le sexe anatomique, le sexe juridique, le sexe social […] [qui] nous rangent dans une des deux colonnes de la société27 ». La figure de l’hermaphrodite a évolué dans la littérature depuis l’Antiquité, mais une série de procès a forgé à l’époque moderne les modèles de genres juridiques dont nous sommes encore tributaires. La responsabilité des juristes dans la construction des genres par des discours médicaux, sociaux et comportementaux est fondamentale.
Néanmoins, Mathieu Laflamme a montré que la justice de l’Ancien Régime n’avait pas cherché à modifier les individus et se bornait, malgré des examens physiques invasifs, à sanctionner des comportements alors illégaux :
- travestissement,
- sodomie,
- profanation du sacrement du mariage28.
C’est alors la justice qui détermine le sexe, de manière négative, par la répression de délits et de crimes. De là découle l’évidence d’appartenir à l’un ou l’autre sexe dans les dictionnaires juridiques des modernes et contemporains, comme celui de Claude‑Joseph de Ferrière :
Concluons que comme il n’y a point de véritables hermaphrodites, c’est‑à‑dire en qui les deux sexes soient parfaits, ceux qui participent de l’un et de l’autre sexe, doivent être réputés du sexe qui paroît en leur personne prédominer sur l’autre29.
La place de la science et des experts s’accroît à partir de la seconde moitié du xviiie siècle. Elle cloisonne peu à peu la perception des sexes en la naturalisant, alors même que des médecins ne cessent de mettre en garde au xixe siècle contre les déterminations hâtives du sexe à la naissance30. Cela consolide l’existence d’une vérité naturelle et l’absence d’états intermédiaires en trouvant toujours plus de critères permettant d’identifier l’un ou l’autre sexe : anatomiques puis physiologiques, étudiant non pas seulement l’apparence mais la fonctionnalité des organes, puis l’étude chromosomique et hormonale. Ironie de l’histoire, c’est aussi la science qui justifie un « retour au droit », dans le sens où les luttes sociales ont poussé à la dénaturalisation des rapports sociaux, en relevant les multiples intermédiaires existants entre mâle et femelle et en insistant sur la part de construction sociale et comportementale du genre31.
Une fois encore, l’histoire ne nous dira pas ce qu’il faut faire ou ne pas faire et livrera encore moins de vérité sur ce que nous sommes et voulons être. Elle offre les clés de questionnement des évidences : dans un ordre social fondé sur la supériorité du roi sur ses sujets, de l’homme sur la femme, du père sur sa famille, la détermination non ambiguë du sexe est fondamentale. Mais à partir du moment où l’on considère que les êtres humains sont égaux, sans aucune distinction, l’édifice juridique, qu’il soit soutenu par une nature fantasmée ou un ordre social anachronique, a besoin, non pas d’un étayage de ses murs ou d’un colmatage de ses fissures, mais d’un ambitieux redimensionnement de son intérieur.