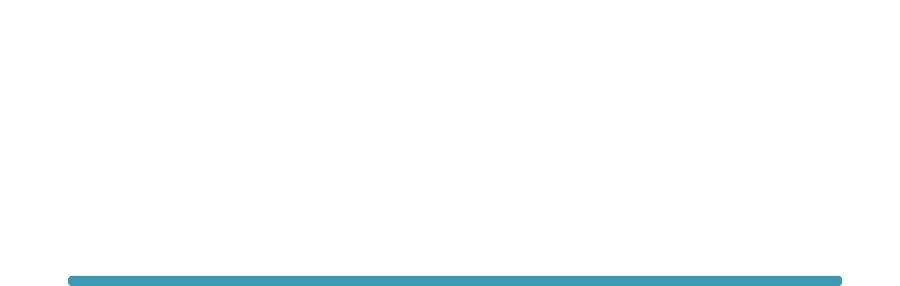S’il est courant d’invoquer le principe d’indisponibilité en droit de la filiation, il est moins habituel de s’intéresser à la mutabilité des filiations.
En droit de la filiation, la loi prévoit que :
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation1.
Cette disposition légale est classiquement analysée comme le prolongement de l’indisponibilité de l’état des personnes en droit de la filiation2. L’état des personnes étant, ou étant censé être, indisponible3, une personne ne peut pas renoncer à une action tendant à modifier un élément de son état, à savoir, ici, sa filiation. Par conséquent, il existerait une certaine indisponibilité de l’action en établissement ou en contestation de la filiation. Dit autrement, cette action ne serait pas à la libre disposition des parties.
Néanmoins, affirmer l’indisponibilité des actions en matière de filiation ne revient ni à écarter la place de la volonté en droit de la filiation en général, ni à instituer une immutabilité des filiations. La volonté a, à l’inverse, une place importante dans l’établissement d’un lien de filiation ou dans sa contestation. En outre, la filiation n’est pas immuable et est, au contraire, sujette au changement.
L’objet de ces quelques lignes ne va donc pas être d’exposer une éventuelle indisponibilité de la filiation ou une éventuelle immutabilité des filiations. Cela ne signifie pas pour autant que le principe – certes remis en cause – d’indisponibilité de l’état des personnes n’a aucune influence dans notre champ de recherche.
Au cours du temps, la filiation d’une personne peut évoluer. Une personne née sans aucun lien de filiation peut se voir établir, postérieurement, un ou plusieurs liens de filiation. Une personne dont seul un lien de filiation est établi peut se voir instituer un second lien de filiation. Le ou les liens de filiation d’une personne peuvent être remis en cause. À la suite de cet anéantissement, un ou plusieurs autres liens peuvent être reconnus. Une personne peut également se voir substituer un lien de filiation par une adoption plénière. Une personne peut encore bénéficier d’un nouveau lien de filiation, sans effacement des liens existants, grâce à une adoption simple.
Il est, par conséquent, indéniable que les filiations peuvent varier au cours du temps.
Deux principaux facteurs d’évolution sont aisément identifiables : la volonté de celui à l’origine de l’établissement ou de l’anéantissement de la filiation d’une part, et la vérité biologique qui, très souvent, est au cœur de la contestation et de l’établissement judiciaires d’une filiation d’autre part.
Néanmoins, ces éléments propices aux changements – la volonté et la vérité biologique – ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer les modifications affectant la filiation. Celles‑ci, en effet, ne peuvent se faire qu’en s’inscrivant dans un cadre légal – et c’est là que les considérations d’ordre public restent présentes. La loi régit les modes d’établissement et de contestation des liens de filiation et la mutabilité des filiations est bien subordonnée au respect de ces conditions légales.
En particulier, depuis l’ordonnance de 20054, notre droit de la filiation est régi par trois grands principes directeurs5 :
- l’égalité,
- la vérité,
- et la sécurité.
À ces trois grands principes, il pourrait être ajouté le consentement si l’on élargit notre domaine d’étude à l’adoption.
L’égalité des filiations6 – premier principe directeur – implique la suppression des distinctions ayant pu exister entre les enfants dits légitimes des autres enfants, dits naturels ou adultérins. Ce principe, très important, de notre droit n’interfère pas dans les éventuelles modifications affectant la filiation.
La vérité – deuxième principe directeur – renvoie d’abord à la vérité biologique. Le lien de filiation a, en principe, vocation à refléter la vérité biologique, ce qui explique qu’en principe :
En matière de filiation, l’expertise biologique est de droit7.
Cette vérité biologique a aujourd’hui une place essentielle dans notre droit de la filiation et justifie bien des tendances du droit positif. Elle requiert, en particulier, la transcription du lien de filiation biologique du père d’intention qui a eu légalement recours à une gestation pour autrui à l’étranger8. Elle explique également que la rigueur du délai de prescription puisse être tempérée par la mise en œuvre d’un contrôle de proportionnalité. La vérité biologique est ainsi primordiale. Néanmoins, la vérité sociologique est également considérée en droit français puisqu’une filiation peut être établie par possession d’état et la Cour de cassation a, à cet égard, récemment rappelé que :
La circonstance que le demandeur à l’action en constatation de la possession d’état ne soit pas le père biologique de l’enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention9.
Quant à la sécurité – troisième principe directeur –, elle se manifeste, notamment, à travers le principe chronologique ou les délais de prescription. Cet objectif de stabilité de la filiation est incontestablement un frein à la mutabilité des filiations. Cependant, il a été affaibli par l’introduction dans notre droit du contrôle de proportionnalité.
Enfin, à ces trois principes directeurs du droit de la filiation, il peut être ajouté celui du consentement si l’on s’intéresse aussi aux effets de l’adoption sur les variations de la filiation. Dans l’adoption en effet, le consentement des parents d’origine a toujours été considéré comme la pierre angulaire de l’institution10. Pourtant, la récente réforme du droit de l’adoption11 marque un certain recul de ce consentement.
Ainsi, si la vérité conserve une place de prédilection dans le changement de la filiation, d’autres repères traditionnels, tels que la sécurité et le consentement, connaissent un certain recul. Parallèlement à ces tendances, d’autres critères déterminant la mutabilité ou l’immutabilité des filiations peuvent être mis en exergue. En particulier, le projet parental peut susciter la modification de la filiation d’une personne alors qu’un certain modèle légal12 de la filiation peut y faire obstacle.
Autrement dit, la mutabilité des filiations est aujourd’hui marquée tant par un assouplissement de repères traditionnels (I) que par l’affirmation d’autres repères (II).
I. L’assouplissement de repères traditionnels
Jusqu’à peu, la sécurité juridique (A) et le consentement (B) constituaient des obstacles à la mutabilité des filiations. Ceux‑ci persistent mais se trouvent quelque peu affaiblis.
A. La sécurité
La sécurité, ou la stabilité, est un des grands principes directeurs du droit de la filiation tel qu’il est issu de la réforme de 2005. La sécurité justifie, en particulier, la mise en place du principe chronologique, en vertu duquel « tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait13 », et de délais de prescription au terme desquels une filiation ne peut plus être contestée. Ce principe chronologique et ces délais s’appliquent même si la filiation légalement établie n’est pas conforme à la vérité biologique.
Néanmoins, la récente introduction du contrôle de proportionnalité en droit français14 tempère la rigueur de ces règles. Dans une espèce donnée, le déploiement du contrôle de proportionnalité pourrait en effet conduire à écarter l’application inflexible du délai de prescription, voire du principe chronologique. Il se peut, en effet, que dans une affaire particulière, la mise en œuvre concrète d’un délai de prescription ou l’application concrète du principe chronologique, constitue une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et porte ainsi atteinte à la vie privée et familiale d’une partie. Ainsi, depuis les années 2010, la Cour de cassation invite les juges du fond à effectuer ce contrôle de proportionnalité. Ils doivent par exemple prendre en considération :
- la vérité biologique15,
- les intérêts successoraux16,
- la présence d’une possession d’état17,
- le délai dans lequel l’intéressé agit en justice alors qu’il avait connaissance de la vérité biologique18,
- ainsi que l’ancienneté de la filiation légalement établie,
- et les conséquences de l’éventuelle recevabilité de l’action19.
Par conséquent, la sécurité juridique qui était autrefois un obstacle implacable à la mutabilité de la filiation se trouve assouplie.
Une analyse analogue peut être menée en ce qui concerne le consentement à l’adoption.
B. Le consentement
En droit de l’adoption, le consentement des parents d’origine a toujours été considéré comme essentiel. Si la récente réforme de l’adoption insiste apparemment sur la nécessité d’obtenir un consentement libre, éclairé, sans contrepartie et non équivoque20, la réalité est bien autre. La loi du 21 février 2022 marque plutôt un recul du consentement des parents d’origine21 afin d’encourager l’adoption et, par là même, la mutabilité des filiations.
La place moindre accordée au consentement des parents d’origine est perceptible à deux égards.
D’une part, le consentement à l’admission en qualité de pupille de l’État emporte désormais consentement à l’adoption22. Autrefois, deux consentements des parents d’origine étaient requis23 : l’un était nécessaire à l’admission en qualité de pupille de l’État, l’autre à l’adoption. La suppression de ce second consentement permet de favoriser l’adoption des pupilles de l’État et ainsi d’accélérer le processus d’adoption. L’affaiblissement du consentement des parents d’origine encourage donc la mutabilité de la filiation.
D’autre part, le législateur de 2022 a adopté une disposition transitoire qui permet l’adoption de l’enfant de la femme lesbienne en dépit de l’opposition de celle‑ci. L’article 9 de la loi24 s’intéresse à la femme qui a réalisé un projet parental avec une autre femme avant la dernière loi de bioéthique25 et par une technique de la procréation médicale assistée mise en œuvre légalement à l’étranger. Il lui permet d’adopter l’enfant ainsi conçu en dépit de l’opposition de la mère. « À titre exceptionnel » et jusqu’en février 2025, le juge peut en effet prononcer l’adoption de l’enfant lorsque sa mère refuse la reconnaissance conjointe26 de son ex‑partenaire avec laquelle elle avait formé un projet parental. L’adoption pourra être prononcée, par une « décision spécialement motivée », dès que le refus de la reconnaissance conjointe est « contraire à l’intérêt de l’enfant » et que « la protection de ce dernier […] exige » le prononcé de cette adoption.
Ainsi, le consentement des parents d’origine est indéniablement affaibli, l’adoption est favorisée et la mutabilité des filiations en sort renforcée.
Deux repères traditionnels, la sécurité et le consentement, ont donc été, ces dernières années, affaiblis, favorisant la mutabilité des filiations. Il ne peut néanmoins être affirmé qu’une fluctuation des filiations serait encouragée de façon plus générale. D’autres facteurs, qui ne sont pas classiquement identifiés comme des principes essentiels du droit de la filiation, interfèrent.
II. L’affirmation d’autres repères
Il nous semble que les changements de filiation sont encouragés ou, à l’inverse, limités par d’autres considérations qui ne sont pas identifiées comme premières en droit de la filiation.
Il en est ainsi du modèle filial (A) et du projet parental (B).
A. Le modèle filial
Les dernières lois réformant le droit des personnes et de la famille ont libéralisé le droit de la filiation, en ouvrant, notamment, la procréation médicalement assistée et l’adoption. Mais, elles ont, dans le même temps, dessiné un certain modèle filial et, ce faisant, limité les changements de filiation à certains égards.
Ce modèle de la filiation justifie d’abord le durcissement de certains interdits, tels que ceux de l’inceste et de la gestation pour autrui.
En effet, la récente réforme du droit de l’adoption27 a élargi en son domaine l’interdiction de l’inceste. Désormais, le nouvel article 346 du Code civil s’oppose, en principe, à l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs. Le lien de parenté devient donc un empêchement à l’adoption et freine par conséquent la mutabilité de la filiation.
En outre, la dernière loi de bioéthique28 a modifié l’article 47 du Code civil qui prévoit, dorénavant, que l’irrégularité de l’acte de l’état civil est appréciée au regard de la loi française. Désormais, le lien de filiation de l’enfant légalement établi à l’étranger n’est donc plus automatiquement transcrit sur les registres de l’état civil, lorsque l’acte de naissance de l’enfant issu d’une gestation pour autrui indique pour parent un parent d’intention qui n’est pas le parent biologique. La mutabilité de la filiation, à la suite d’une gestation pour autrui, est donc freinée.
Outre ces interdits que sont l’inceste et la gestation pour autrui, le modèle filial se veut ensuite conforme au modèle biologique. En ce sens, depuis la réforme de l’adoption, l’agrément des parents adoptifs requiert, en principe, un écart d’âge maximal entre les adoptants et l’adopté, à savoir « cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter29 ». Un écart d’âge trop important peut empêcher le changement de la filiation par une adoption.
Un certain modèle filial, tel qu’esquissé par le législateur, est ainsi de nature à restreindre la mutabilité des filiations.
B. Le projet parental
Paradoxalement, le projet parental aussi semble aujourd’hui être pris en considération, pas seulement dans l’établissement initial du lien de filiation mais également dans ses modifications ultérieures. Législateur et juge semblent par conséquent souffler le chaud et le froid dans le même temps. Le modèle filial et le projet parental peuvent clairement entrer en contradiction mais sont, en réalité, pris tous deux en compte.
Ainsi, depuis la réforme de l’adoption, des couples non mariés30 peuvent adopter. L’essentiel est l’existence de leur projet parental. Cet assouplissement des conditions relatives à l’adoptant favorise ainsi la mutabilité des filiations par l’adoption.
De même, bien que la gestation pour autrui soit strictement interdite en droit français31, les effets de la gestation pour autrui mise en œuvre à l’étranger peuvent être reconnus dans notre droit. Si la filiation de l’enfant issu de la gestation pour autrui est légalement établie à l’étranger, celle‑ci pourra être consacrée en droit français alors même que le parent d’intention n’est pas le parent biologique de l’enfant. Dès lors que le lien de filiation est suffisamment concrétisé, le droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant requiert en effet que ce lien de filiation soit juridiquement reconnu32, par une adoption en particulier. Ainsi, ce n’est pas ici la vérité biologique mais bien la concrétisation d’un projet parental qui encourage la mutabilité des filiations.
En conclusion, penser « la mutabilité des filiations » est l’occasion de mettre en exergue les tendances récentes qui traversent notre droit de la filiation. La mutabilité n’est ni pleinement encouragée, ni pleinement freinée. Elle est les deux à la fois. Aucun mouvement unique, aucun objectif unique, ne peut résumer les dernières évolutions affectant les règles de nature à modifier une filiation. À l’inverse, elles sont significatives des orientations diverses et parfois contradictoires que connaît plus largement notre droit de la filiation.