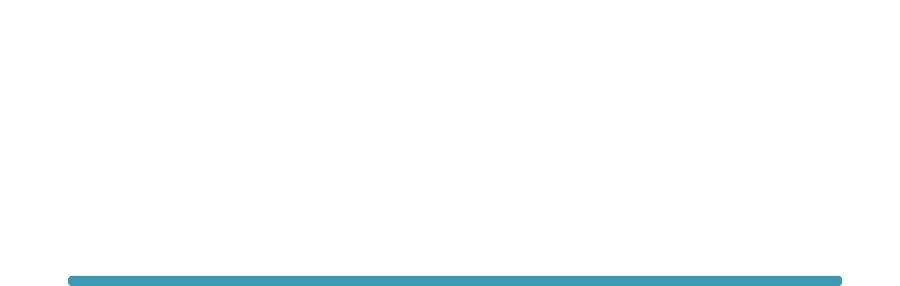Le risque en droit du travail renvoie avant tout au risque professionnel, c’est‑à‑dire celui qui se réalise dans l’entreprise et qui, lorsqu’il se réalise, porte atteinte à l’intégrité physique et/ou mentale du travailleur1. Se dédoublant au plan contractuel, ce risque constitue aussi, indirectement, un risque d’altération du contrat entre le salarié et l’employeur puisque l’accident du travail et la maladie professionnelle iront souvent de pair avec une suspension du contrat de travail voire, éventuellement, avec une rupture du contrat de travail2.
Pour contrer ce risque qui menace à la fois la personne et son emploi, le droit du travail peut compter sur une forte tradition de minimisation du risque. La fonction de minimisation des risques est dans l’ADN de la matière depuis ses origines. Cela explique que depuis longtemps déjà, le droit du travail peut compter sur un corpus imposant et technique de normes en matière d’hygiène et de sécurité accompagné d’une législation très dense sur la durée du travail3. Par ailleurs, le droit du travail n’est pas le seul à chasser le risque professionnel, il peut compter sur sa discipline jumelle : le droit de la protection sociale dont l’action sur les risques professionnels est incontournable depuis la loi emblématique du 9 avril 1898 sur les accidents du travail4.
Ce solide arsenal de minimisation du risque a été rendu encore plus cohérent depuis la fin du xxe siècle grâce à l’apparition d’obligations spécifiques de prévention insérées dans le Code du travail5 sous l’impulsion du droit de l’Union européenne6 et grâce à la consécration jurisprudentielle d’une authentique obligation générale de sécurité mise en musique7 puis modernisée8 par la chambre sociale de la Cour de cassation. Autant d’évolutions qui constituent de véritables boussoles dans la démarche de minimisation du risque en entreprise.
Pour autant, cela ne suffit plus aujourd’hui car la cartographie du risque professionnel a connu, au cours des dernières décennies, de profonds bouleversements. Le risque n’est plus uniquement conçu comme menaçant la santé physique : son influence sur la santé mentale est aujourd’hui pleinement reconnue via la notion de risques psychosociaux. Les nouveaux modes de travail, le progrès technologique, l’irruption du numérique et l’entrée en lice de l’intelligence artificielle (IA) tout en écartant certains risques professionnels « du passé », leur ont substitué, malgré eux, de nouveaux foyers potentiels de risque professionnel.
Dans ce contexte, s’interroger sur les nouveaux outils juridiques de gestion du risque professionnel conduit à mettre en exergue la façon dont le droit du travail s’est adapté aux changements et a amélioré sa maîtrise du risque professionnel en permettant de mieux le visualiser, de mieux l’anticiper et de mieux le réparer. Ce triptyque alimentant un cercle vertueux de prévention du risque professionnel désormais bien ancré dans l’appareil génétique du droit social.
C’est ainsi que sont apparus sur les dernières années de nouveaux outils de gestion du risque professionnel qui ciblent des configurations de risque qui étaient jusqu’à présent insuffisamment prises en compte, voire totalement ignorées. Aux fins de les mettre en lumière, on peut distinguer trois grandes catégories de risques – le risque psychosocial (I), le risque progressif (II) et le risque anormal (III) – dont la prévention et le traitement ont été profondément réorientés ces dernières années.
I. Anticiper les risques psychosociaux
On se situe ici sur le terrain de la santé mentale. Or, les risques psychosociaux (RPS) ne constituent pas des risques comme les autres. Ces risques ne peuvent plus être objectivés comme les risques traditionnels. Ils se manifestent ainsi très différemment d’un individu à l’autre et peuvent d’ailleurs également être liés à des facteurs extérieurs au travail. Il a ainsi fallu résoudre deux problématiques : comment agir sur les causes subjectives des RPS (A) et comment agir sur leurs causes multifactorielles (B) ?
A. Des outils personnalisables de prévention du risque psychosocial : l’exemple de la charge de travail
La charge de travail ne doit pas être confondue avec la durée du travail. Rappelons que la limitation de la durée du travail est un instrument traditionnel de minimisation du risque professionnel posant des bornes quantitatives afin de soustraire le salarié au contexte professionnel pour éviter une aggravation des risques résultant de séquences de travail trop étirées.
Mais face à des nouvelles organisations et à une flexibilisation accrue du travail, la limitation de la durée du travail n’est plus un outil suffisant pour prévenir le risque. Dans certaines situations, le Code du travail et le juge ont ainsi recours, depuis peu, au concept de charge de travail raisonnable pour imposer à l’employeur d’en être le gardien. C’est le cas pour les salariés en forfaits‑jours9 ou pour les salariés en télétravail10.
Ce nouvel outil met en scène trois repères :
- le travail prescrit,
- le travail réel,
- et le travail vécu11.
Si des écarts se créent entre ces trois repères, le salarié s’expose à une surcharge de travail, facteur de stress et de mal‑être au travail. L’employeur est alors sommé, en réaction, de réduire l’écart par des mesures correctrices et de résoudre ainsi, le plus rapidement possible, des problèmes de surcharge de travail par des réajustements.
Contrairement à la durée du travail, seuil de limitation identique pour tous les salariés, la charge de travail est ajustable à la situation de chaque salarié en questionnant l’intensité du travail à partir de la perception de la personne et des ressources dont elle dispose pour faire face aux contraintes propres qui lui sont imposées.
B. Des outils transversaux de prévention du risque psychosocial : le concept de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)
À côté de la charge de travail, un second outil moderne d’anticipation du risque psychosocial peut être identifié : la qualité de vie au travail (QVT), devenue qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) en 202112. Opérant un changement de registre, la QVCT a pour objectif de questionner l’environnement de travail du salarié afin d’agir de manière plus globale et plus positive sur le risque professionnel. Si l’on veut résumer, la QVT c’est la minimisation du risque par la promotion du bien‑être au travail.
Il s’agit donc de promouvoir le bien‑être au travail dans toutes ses dimensions et de créer un contexte professionnel plus épanouissant et donc a fortiori, moins générateur de contraintes et de risques. Il n’est donc pas ici question de se « [centrer] sur la gestion des risques afin de les éviter ou de les limiter. Il s’agit cette fois‑ci d’une approche positive et globale, intervenant de manière complémentaire aux outils existants, qui renouvelle profondément la prévention vis‑à‑vis des risques au travail13 ».
Pour diffuser ce concept dans l’entreprise, le législateur a décidé d’en faire un sujet de négociation obligatoire d’entreprise. Chaque année, en principe, l’employeur et les syndicats doivent négocier sur la QVCT14. Cette négociation permet à chaque entreprise de contractualiser, par l’accord collectif, une stratégie globale et concertée d’amélioration des conditions de travail.
[Et] si la démarche bien‑être au travail/QVT ne se traduit que sous la forme d’une obligation procédurale, celle d’ouvrir des négociations sur ce thème, les engagements contractés à ce titre s’imposeront à l’employeur dans la conduite de la prévention dans l’entreprise15.
Les négociateurs peuvent ainsi agir sur :
- le mode de management,
- les canaux d’expression des salariés,
- l’articulation de la vie personnelle et professionnelle,
- ou encore l’impact du numérique.
De manière encore plus novatrice, certaines entreprises utilisent la QVCT pour minimiser le risque professionnel à partir d’une meilleure emprise sur le mode de vie et le cadre de vie du salarié. Ici, on envisage dans son ensemble, et dans toutes ses dimensions, la protection de la santé du salarié. Cela donne des accords très extensifs dans leur approche qui intègrent des thématiques relatives :
- à l'hygiène alimentaire,
- à la gestion du sommeil,
- à la prévention des addictions,
- aux bienfaits des activités sportives,
- ou encore à la sophrologie16.
II. Atténuer les risques progressifs
Ne bénéficiant pas, à l’inverse du risque psychosocial, d’un identifiant officiel, le risque progressif est celui qui va provoquer, sur la durée, une certaine usure de l’organisme. Par nature, son identification est plus complexe. Certes, l’usure prématurée et irréversible du corps pourra être éventuellement prise en charge par le système de l’assurance invalidité de la sécurité sociale, voire par le système de maladies professionnelles. Force est pourtant de constater que ces dispositifs, s’ils assurent le versement d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), n’interviennent qu’une fois le risque progressif entièrement réalisé.
Conscient du caractère insuffisant de la démarche, le législateur a, pour freiner cette réalisation progressive du risque et préserver les salariés exposés, procédé en deux temps. Dans un premier temps, a été mis sur pied un système de reconnaissance de certains facteurs de pénibilité dans le Code du travail. Ces facteurs visent certains rythmes ou certains contextes de travail auxquels on associe un degré de pénibilité plus élevé. On y retrouve notamment :
- le travail de nuit,
- le travail répétitif,
- le travail posté (les « 3 x 8 »),
- les activités exercées en milieu hyperbare,
- celles exercées sous des températures extrêmes,
- ou encore celles exposant à un bruit élevé17.
Puis, dans un second temps, a été érigé un régime protecteur des salariés exposés à ces facteurs de pénibilité comportant deux volets de minimisation du risque : un volet collectif (A) et un volet individuel (B).
A. La minimisation collective du risque progressif
Le premier volet vise une minimisation collective du risque. Il oblige les entreprises dont au moins un quart des salariés sont exposés à ces métiers pénibles à être couvertes, soit par un accord collectif, soit par un plan d’action unilatéral dont l’objet sera précisément de prévenir les facteurs de pénibilité18. On attend donc de l’entreprise abritant une certaine proportion de métiers pénibles qu’elle fournisse un effort supplémentaire de prévention. Pour ce faire, l’accord collectif ou le plan d’action doit comporter des engagements chiffrés de l’entreprise de réduire les expositions aux facteurs de pénibilité19. L’accent doit être mis sur :
- la réduction des poly‑expositions aux risques,
- l’aménagement des postes de travail,
- ou encore l’amélioration des conditions de travail au plan organisationnel.
Pour donner pleine efficacité à ce dispositif, un mécanisme de taxation l’accompagne puisque l’entreprise qui n’est pas couverte par un accord collectif ou un plan d’action de prévention des facteurs de pénibilité encourt une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1 % de sa masse salariale. On retrouve ici un phénomène d’incitation par la taxation qui est historiquement employé en droit de la sécurité sociale et qui fait dépendre la cotisation de l’entreprise du risque qu’elle représente.
B. La minimisation individuelle du risque progressif
À côté de cette logique de minimisation collective du risque, le législateur a également développé un outil individualisé de minimisation du risque. Le principe est assez simple : chaque salarié exposé à un métier pénible se voit doter d’un compte professionnel de prévention (C2P).
Ce compte est destiné à compenser son exposition prolongée à des facteurs de pénibilité. Pour ce faire, le salarié se voit attribuer un certain nombre de points en fonction du type d’exposition et de son ampleur. Ces points sont cumulés tout au long de la carrière du salarié et lui permettent ensuite d’actionner trois leviers différents de minimisation du risque. D’abord, un levier de formation pour s’éloigner du métier pénible et migrer vers un métier moins pénible. Ensuite, un levier de réduction du temps de travail pour passer à temps partiel sans réduction de salaire et plafonner ainsi la durée de l’exposition au risque. Enfin, un levier d’anticipation permettant au salarié de partir à la retraite avant l’âge légal de liquidation de la pension vieillesse.
En clair, diverses solutions pour se retirer partiellement ou totalement de la situation de travail « pénible » et contrer le risque d’usure prématurée de l’organisme. Grâce à cet outil, le salarié devient acteur de la prévention puisque c’est à lui qu’il revient de décider de l’utilisation et des modalités d’utilisation de son C2P.
III. Réagir aux risques anormaux
Au titre des risques dont l’identification et le traitement ont été renouvelés au cours de la dernière période, on doit enfin citer le risque anormal que l’on peut définir comme celui auquel le travailleur n’aurait pas dû être exposé. L’exposition à ce risque résulte donc d’un comportement fautif de l’employeur et provoque un danger particulier pour le salarié. Traditionnellement on le traite une fois qu’il s’est réalisé par l’intermédiaire de la faute inexcusable qui est une technique pour déplafonner, dans une certaine limite, l’indemnisation versée par la sécurité sociale au salarié en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle20.
Or, la jurisprudence a diversifié, au cours des dernières années, les sources de préjudice pouvant être invoquées dans la séquence d’exposition au risque et avant qu’un risque professionnel ne se réalise. Il s’agit de réparer le « risque professionnel potentiel » lié à la dangerosité d’un produit et ainsi de responsabiliser davantage l’employeur, par la dissuasion financière, en amont de la réalisation du risque. L’exposition au risque devient ainsi une source autonome de préjudice indemnisable. Deux types de « préjudices d’exposition » ont été reconnus au cours des dernières années : le préjudice d’anxiété (A) et le préjudice d’atteinte à la dignité du salarié (B).
A. Le préjudice lié à l’exposition angoissante au risque
Le préjudice d’anxiété, que le droit du travail mobilise depuis 201021, a été initialement déployé dans le contentieux de masse autour du scandale de l’amiante. Il symbolise la meilleure prise en compte des situations d’exposition au risque. Ce préjudice indemnise classiquement la situation d’inquiétude permanente des travailleurs de l’amiante face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante. L’angoisse étant réactivée à chaque contrôle ou examen médical.
Il faut bien saisir la spécificité de la réparation et de ce préjudice. Les travailleurs concernés ne sont pas encore atteints par une pathologie professionnelle et nul ne sait s’ils le seront et quand. En ce sens, le préjudice n’est pas dépendant de la réalisation du risque que représente la maladie professionnelle liée à l’amiante.
Mais encore fallait‑il, pour en faire un véritable outil de gestion du risque professionnel, ouvrir le caractère indemnisable de ce préjudice au‑delà de l’exposition à l’amiante. C’est ce qui a été fait en 201922 puisque désormais tous les travailleurs exposés à une autre substance nocive ou toxique (poussières de bois, de silice, fumées de bitumes, inhalation de produits chimiques, nanomatériaux) impliquant un risque élevé de développer une pathologie grave peuvent demander à leur employeur indemnisation de leur préjudice d’anxiété lorsqu’il est démontré que celui‑ci n’a pas pris suffisamment de mesures préventives23.
B. Le préjudice lié à l’exposition illégale au risque
Tout récemment, la chambre sociale de la Cour de cassation a consacré un préjudice autonome découlant de l’exposition illégale à une substance toxique ou nocive24 : l’affaire concernait des travailleurs qui avaient été amenés à manipuler de l’amiante après l’interdiction générale de ce matériau.
Situant le débat sur le terrain de l’atteinte à la dignité et l’exécution de bonne foi du contrat de travail, la Cour de cassation consacre une dette de réparation autonome du préjudice d’anxiété qui permet donc d’envisager leur cumul. Ici, même si le salarié ne peut démontrer son anxiété, sa seule exposition illégale à un produit dangereux suffit.
À l’évidence, cette approche extensive du risque professionnel incite l’employeur à une surveillance plus avancée de l’exposition à certains matériaux ou à certains produits dans l’accomplissement du travail et accroît donc la démarche de minimisation du risque dans l’entreprise.
Avec la reconnaissance des préjudices d’exposition, il s’agit en définitive de minimiser le risque en maximisant la réparation. Comme souvent en droit social, le lien réparation‑prévention est très fort et la mise en œuvre de la responsabilité est instrumentalisée à des fins de prévention.
Pour conclure, les différents outils que l’on a énumérés véhiculent une conception plus offensive de minimisation du risque ainsi qu’une approche plus globale. Les nouvelles orientations constatées ces dernières années démontrent une fois de plus l’adaptabilité du droit du travail à la morphologie évolutive du risque professionnel.