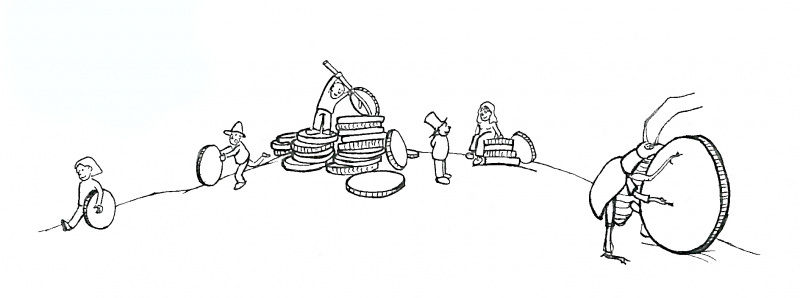Comme en bien d’autres domaines de la vie sociale, l’argent suscite, dans les milieux écologistes et décroissantistes, un persistant malaise. Et pour cause, comment ne pas se défier de ce « dieu jaloux » que fustigeait Marx (1843, p. 30), comme tant d’autres avant lui, lorsqu’on critique l’ordre d’un monde que l’argent semble faire tourner ?1 Ce n’est pas d’hier que l’on considère l’argent et sa convoitise comme étant à « la racine de tous les maux », ainsi que le dit la Bible (1 Timothée 6:10). Aussi le lucre figure-t-il souvent parmi les chefs d’inculpation, aujourd’hui encore, lorsque sont énumérés les facteurs anthropiques de la crise écologique et climatique. Plutôt que de parler d’« anthropocène », comme s’il s’agissait de blâmer le genre humain en son entier, ne serait-il d’ailleurs pas plus juste de nommer « capitalocène » cette ère géologique nouvelle, marquée à jamais par les traces de l’activité industrielle et des énergies fossiles qui la meuvent (Malm, 2017) ? Promue du rang de vice moral à celui d’impératif catégorique d’un système économique fondé sur la concurrence marchande et l’accumulation illimitée, la poursuite du profit monétaire serait ainsi au principe de la dégradation de l’environnement, tout comme on a pu la rendre aussi coupable d’avoir été au motif de l’exploitation de l’humain par l’humain.
Sans doute y a-t-il ainsi filiation entre la pensée écologiste et décroissantiste d’aujourd’hui et l’antique condamnation de la chrématistique chez Aristote, soit cette tendance à placer « l'opulence dans l'abondance de l’argent », alors que « cet argent n'est en lui-même qu'une chose absolument vaine », n’ayant de valeur que par convention, et ne satisfaisant par lui-même aucun des besoins qui poussent les humains à échanger [1257a]. Lui qui n’était qu’un simple moyen d’échange, son accumulation n’ayant point de bornes, l’argent serait devenu à lui-même sa propre fin. Mais pourrait-on s’en passer ? Aussi la méfiance toute aristotélicienne qui caractérise la pensée écologiste et décroissantiste à l’égard de l’argent mène-t-elle vite à plonger dans l’embarras, dès qu’il s’agit d’esquisser ce qu’un monde d’après la croissance devrait en faire. Comme le soulignait Timothée Parrique, « rien n’est plus éloigné des préoccupations des décroissantistes que l’argent » (2019, p. 631). Puisqu’il semble être dans sa nature même de prêter à une accumulation infinie, l’argent paraît congénitalement incompatible avec tout objectif de décroissance. Alors, qu’en faire ? À défaut de l’abolir en pratique, on se contentera donc parfois d’esquiver tout simplement le problème.
Telle que formulée par Aristote il y a 2300 ans, la question demeure toutefois indépassable. Si le besoin et le désir d’agréments poussent les humains à échanger entre eux, cette interdépendance ne requerra-t-elle pas l’établissement d’un étalon permettant la commensuration des choses échangées ? Et devant la complexité des échanges en nature, n’en viendra-t-on pas à matérialiser cette unité de mesure dans des objets devenant eux-mêmes des moyens d’échange, capables d’équivaloir et de se substituer à toute chose ? Bien sûr, cette nécessité pratique de l’argent n’atténue pas le danger qu’il représente, celui de tout subsumer à sa logique d’accumulation. Au contraire, c’est bien parce qu’il est nécessaire qu’il est dangereux. En ce sens, l’argent est irrémédiablement ambivalent ; sa valeur, indécidable. Cette ambivalence constitutive, c’est ce qui fait de l’argent le pharmakon par excellence.
Aborder le phénomène monétaire dans une perspective décroissantiste oblige à réfléchir dans les termes de ce que Bernard Stiegler (2010) appelait, à la suite de Jacques Derrida, une « pharmacologie » de la technique, c’est-à-dire une critique des techniques qui prenne au sérieux leur insoluble ambiguïté. Comme toute technique humaine, l’argent, instrument de paiement et de mesure de la valeur, possède la même dualité. Comme tout pharmakon, l’argent est « à la fois remède et poison », ses pouvoirs pouvant « être – tour à tour ou simultanément – bénéfiques ou maléfiques » (Derrida, 1972, p. 87). La toxicité qu’il engendre, lorsqu’il réduit tout à la loi de l’équivalence générale et fait de toute chose une marchandise à écouler, trouve dans la crise écologique sa plus grave expression, celle d’un empoisonnement planétaire. De ce point de vue, la décroissance est une thérapeutique, une cure de désintoxication. Il s’agit, pour parler comme Yves-Marie Abraham, de « guérir du mal de l’infini » (2019). Mais toute visée thérapeutique implique aussi d’établir une posologie, si tant est qu’il faille baliser l’usage de ce dont on ne saurait se passer2.
Défini comme une drogue, un médicament, le pharmakon guérit en empoisonnant; il guérit parce qu’il empoisonne. Face à une crise qui menace la pérennité de la vie sur Terre, et dont il est peut-être sinon la cause, du moins l’instrument, l’argent pourrait-il sauver le monde pour autant ? Dans son ouvrage intitulé La Magie planétaire (2021 [2016]), l’anthropologue suédois Alf Hornborg n’est pas loin d’en faire la promesse. En montrant l’intrication des processus géophysiques qui conduisent à l’emballement du climat et à la dégradation des écosystèmes, et des imaginaires symboliques qui façonnent le réseau relationnel que l’humanité tisse à l’échelle du globe, il montre comment la puissance sociale d’un artefact comme la monnaie attise à la fois la misère humaine et la destruction du vivant. Néanmoins, dans une posture pharmacologique qui ne dit pas son nom, il propose de réformer l’institution monétaire de manière à briser cette dynamique mortifère.
Dans la suite de cet article, il s’agira de restituer la thèse de l’auteur pour ensuite en questionner les implications. Si une réforme monétaire offre des solutions pour relocaliser les circuits marchands et ainsi entraver la logique de « l’échange écologique inégal », pareille ambition reste limitée du fait qu’elle conçoive d’abord l’argent comme instrument de transaction. C’est plutôt en l’abordant sous l’angle du crédit qu’une monnaie alternative permettra de réorienter le mode de production dans une visée de décroissance. Ce faisant, il s’agira de se réapproprier ce qui constitue l’argent, au fond, comme une institution politique, dans une optique qui fasse pleinement droit à l’autonomie des collectivités.
La monnaie vue au prisme d’une ontologie relationniste
Les revendications écologistes formulées en termes de « justice climatique » ne se rapportent pas uniquement aux disparités sociales relatives à l’exposition aux risques environnementaux. Celles-ci se conjuguent en fait avec de multiples autres formes d’inégalité, dont elles amplifient les effets. Toutefois, dans la mesure où c’est le mode de production capitaliste qui est tenu pour responsable de la crise environnementale, la justice climatique implique plus particulièrement une dénonciation des inégalités de richesse, où culminent en quelque sorte toutes les autres. En ce sens, la question géophysique du climat fait donc intervenir celle, institutionnelle et symbolique, de l’argent. Or, le discours critique sur les inégalités ne considère généralement le problème de l’argent que du seul point de vue des causes et des effets de son inégale distribution, par où l’on voit qu’il joue un rôle instrumental dans la consolidation des hiérarchies sociales. Cependant, rarement la critique va-t-elle au-delà de cet enjeu distributif, pour interroger la nature même de la monnaie.
Or, c’est l’une des thèses du livre de Hornborg: si l’on veut répondre au défi environnemental et enrayer les mécanismes de la destruction écologique, il faut mettre en question l’argent du point de vue de sa nature, de manière à le réformer radicalement. Ceci implique d’analyser ce qui fonde sa puissance sociale, en tant que « technologie d’appropriation ». Comme le suggère le titre de son livre, en dépit de toute la complexité et la sophistication des procédés qui en organisent le fonctionnement et la circulation, l’argent apparaît d’abord comme une forme de « magie ». Pour le comprendre, il faut toutefois se placer du point de vue de ce que Hornborg appelle une ontologie « relationniste » (2021, p. 21), vision du monde qui serait commune à toutes les cosmologies dites primitives, mais dont la pensée moderne prétendrait, elle, s’être débarrassée.
Ce déni moderne du relationnisme s’observe par exemple dans la manière dont on a coutume d’opposer magie et technologie, qui sont deux manières de concevoir « l’agentivité » des objets, ou la manière dont des artefacts produisent des effets concrets. Quand on dit d’un objet qu’il est technologique, on suppose ainsi que son fonctionnement et les effets qu’il produit découlent de ses propriétés intrinsèques, et de la manière dont son mécanisme interne a été conçu, sur le mode de l’ingénierie. Le rendement d’un outil technologique n’aurait ainsi aucune autre explication que d’être le fruit d’une alliance entre l’ingéniosité humaine et des savoirs empiriques sur les propriétés physiques de la matière.
Bien que les modernes aient pu chanter les louanges du progrès scientifique du même souffle qu’ils délégitimaient les savoirs traditionnels, force est néanmoins d’admettre qu’un objet magique produit lui aussi des effets réels. Pour le dire comme Claude Lévi-Strauss, il y a bel et bien une « efficacité de la magie » (1958, p. 184). Même si ses effets peuvent aller jusqu’à provoquer la mort ou la guérison des corps, cette efficacité reste toutefois d’ordre symbolique. Elle ne tient pas aux propriétés intrinsèques de l’objet que manipule la magicienne ou le magicien, mais plutôt à la force propitiatoire des symboles, c’est-à-dire aux perceptions et aux croyances dont on les entoure, aux attentes qu’on leur adresse. Ainsi, tandis que l’objet technologique agit de manière autonome, l’action de l’objet magique s’inscrit, elle, dans un tissu relationnel, et c’est de lui qu’elle tire son efficace.
La pensée magique est donc imprégnée de cette ontologie relationniste, qui pose en somme que tout est relié : les vivants, les choses, les dieux et les âmes, etc. L’esprit moderne rejette quant à lui la pensée magique, mais du même coup, il rejette aussi cette conception du monde qui veut que tout soit relié. L’esprit moderne veut ainsi se défaire de toute mystification, mais ce faisant, il se mystifie lui-même. Or, c’est précisément en se plaçant du point de vue d’une ontologie relationniste qu’on peut saisir pourquoi. En effet, c’est une erreur de croire que la technologie – et partant le machinisme, donc le capitalisme industriel – possède une agentivité autonome. Les technologies que met en œuvre l’économie capitaliste dépendent elles aussi, en vérité, d’un ensemble de relations sociales. Leur efficacité repose sur des relations d’échange qui se déploient à l’échelle planétaire. Parce qu’elle dépend ainsi d’un vaste tissu de relations, la technologie n’est donc pas essentiellement différente de la magie.
Or, le liant de ces relations d’échange, c’est l’argent, et en particulier, l’argent qui se présente sous la forme d’une « monnaie à “tous usages” » (Polanyi, 2008 [1957], p. 73). Au vu de la diversité des formes d’instruments monétaires développées par les sociétés humaines au fil de l’histoire, dont les fonctions, la circulation et la fongibilité étaient le plus souvent partielles et limitées, Polanyi désignait par ce terme la particularité d’une monnaie combinant toutes les fonctions, et permettant par-là de tout acheter, c’est-à-dire une monnaie capable d’établir une équivalence quantitative entre les choses qualitativement les plus différentes, et ainsi de circuler indifféremment parmi toutes les sphères sociales. C’est ainsi que dans la lignée d’Aristote – quoique sans partager ses réserves –, de Adam Smith à Karl Menger, on s’est raconté la même fable concernant l’origine de l’argent, qui serait apparu comme une solution rationnelle au problème des difficultés pratiques du troc. Conçue comme un simple appendice du marché et comme l’instrument d’une échangeabilité généralisée, une telle forme de monnaie se présente ainsi comme un instrument technique ; c’est-à-dire qu’elle prétend par le fait même à la neutralité.
Parce qu’elle est pensée comme un objet technique, la monnaie fait donc l’objet d’une gestion qui s’apparente à l’ingénierie : c’est l’art des financiers, des banquiers centraux, qui sont présumés posséder des compétences que les simples usagers et usagères de l’argent n’ont pas. Toutefois, la question se pose de savoir à quoi tient l’efficacité ou l’agentivité de l’argent ? D’où cet artefact tient-il le pouvoir de mettre en branle les circuits planétaires de l'échange marchand ? C’est essentiellement parce qu’on y croit. L’argent, ce n’est rien d’autre qu’un pouvoir symbolique fondé sur la croyance, c’est-à-dire sur la confiance. En effet, si l’argent est une technique, un instrument de mesure de la valeur des choses qui s’échangent par son intermédiaire, son usage dépend de ce qu’on lui reconnaisse une valeur propre. Or, comme l’écrivait Georg Simmel, « toute attribution de valeur n'est qu’un fait psychologique et rien d’autre » (2018 [1889], p. 29).
N'en déplaise à ceux qui pensent que l’argent ne peut avoir de valeur qu’en s’appuyant sur le métal précieux, l’argent dématérialisé, numérique auquel on est aujourd’hui accoutumés nous montre bien que la valeur de l’argent ne dépend de rien d’autre que de la conviction que tout le monde va l’accepter. C’est dire que l’argent est un artefact dont l’efficacité dépend des perceptions et des croyances, lesquelles s’inscrivent dans un tissu relationnel3. Au sens de la distinction faite tout à l’heure, l’argent est donc un objet magique.
C’est pourquoi la monnaie n’a pas non plus la neutralité qu’on lui prête généralement, à l’instar de l’empereur Vespasien disant à son fils que l’argent n’a pas d’odeur. Les objets techniques se présentent comme moralement indifférents. Leurs usages peuvent certes donner lieu à des dilemmes éthiques, mais dans la prévisible régularité de leur fonctionnement, ils restent sans colère ni passion. Simple voile jeté sur l’échange, comme on l’entend souvent, l’argent prétend lui aussi à la même indifférence, en postulant l’équivalence des biens échangés. On suppose donc qu’il y a entre les échangistes un rapport symétrique, de sorte que chacun donne et obtient en échange des valeurs égales, et que chacun s'en trouve également satisfait. Or, ça aussi, c’est une mystification, ce qui donne d’ailleurs au discours de l’économie néoclassique une fonction idéologique que Hornborg dénonce avec raison.
L’argent, ce n’est pas un simple moyen d’échange : c’est une technologie de pouvoir, une « technologie d’appropriation » dont la possession permet de revendiquer l’énergie d’autrui, soit sous la forme de ressources, ou sous celle de la force de travail. Or, cet échange, explique Hornborg, il est toujours inégal : il consiste toujours à tirer avantage des différentiels de prix d’une région du monde à l’autre, de sorte que là où l’équivalence est postulée, c’est en fait l’exploitation qui règne. Si l’économie-monde présente une structure hiérarchique, c’est bien à cause de la capacité de l’argent à fluidifier ces rapports d’extraction et d’exploitation.
Hornborg reprend à Bruno Latour l’idée que l’humanité aurait cette particularité « d’externaliser » ses relations sociales sous la forme d’artefacts, de sorte que manipuler des artefacts reviendrait à gérer ces relations. C’est le cas de l’argent, mais pas uniquement. On pourrait prendre aussi l’exemple du don tel qu’analysé par Marcel Mauss (2012 [1925]), où l’échange d’objets matériels apparaissait comme une manière de créer et d’entretenir des relations sociales. Dans une économie du don, toutefois, de tels échanges restaient suspendus à un impératif de réciprocité. Tel est bien ce qui disparaît avec l’argent, dont la neutralité alléguée échappe à de pareils enjeux de morale. Tout à sa logique quantitative, l’argent serait en effet indifférent aux conséquences de son usage.
D’où le fait que la nature de l’argent soulève un enjeu de justice, trop souvent refoulé. L’argent est non seulement un instrument de domination sociale ; il est aussi le moteur de la déprédation écologique. En effet, suivant la logique d’accumulation illimitée qui est au cœur du système capitaliste, l’argent doit se multiplier sans fin, c’est-à-dire qu’il faut produire toujours plus de valeur. Or, plus on produit de valeur, affirme Hornborg en suivant les idées de Nicholas Georgescu-Roegen, plus on produit aussi de l’entropie. La chrématistique induit donc invariablement la dislocation des écosystèmes. C’est bien le comble de l’aliénation fétichiste que dénonçait déjà Marx à l’époque. Si être aliéné, c’est se laisser dominer par nos créations, c’est laisser l’artefact imposer sa loi à celles et ceux qui l’ont fabriqué ; au vu de la crise environnementale, il ne s’agit plus de se laisser dominer, mais de se laisser carrément détruire.
Hornborg propose une façon originale de comprendre l’enchevêtrement entre processus matériels ou géophysiques, comme ceux qui dictent le réchauffement du climat, et processus symboliques ou « sémiotiques », comme ceux qui donnent sa valeur à l’argent. Bien qu’irréductibles l’un à l’autre, ces processus interagissent d’une manière qui conduit à l’effondrement des écosystèmes comme des sociétés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne peut y avoir de solution technologique à la crise environnementale, selon Hornborg. Les technologies qu’il faudrait développer pour assurer un soi-disant développement durable ayant elles-mêmes pour condition de possibilité la structure de l’échange écologique inégal, elles ne feraient en somme que perpétuer la même frénésie extractiviste qui a conduit au point où nous sommes. Suspendu à la logique ou plutôt à la magie de l’argent, le solutionnisme technologique reste une illusion.
Une pharmacologie monétaire
D’où la proposition de réforme monétaire sur laquelle se conclut le livre de Hornborg, qui consiste à rompre avec le principe d’une monnaie tout usage, de manière à échapper à la logique globale de la marchandisation dont elle est l’instrument. On pourrait bien penser, comme Georg Simmel (1987 [1900], p. 148), que cette capacité qu’a l’argent de rendre toute chose quantitativement comparable attestait du progrès rationnel de l’esprit humain. Il semble qu’il faille plutôt y voir le signe d’un hubris funeste. Aussi, contre la forme de la monnaie tout usage, il faut plutôt réinstituer une monnaie « à usage spécifique », c’est-à-dire une monnaie, comme l’expliquait Polanyi, qui ne puisse circuler que dans certains espaces sociaux, et/ou n’être échangée que contre certains types de biens et pas d’autres. Une idée semblable inspire les artisans des multiples projets de monnaies locales complémentaires qui ont essaimé au cours des dernières décennies4. Ces initiatives visent à faire de l’argent un instrument pour relocaliser les circuits de l’échange, de manière à réduire la vulnérabilité systémique des communautés. Il s’agit par le fait même d’associer à l’argent des valeurs non monétaires, soit des valeurs qui priorisent la satisfaction des besoins humains et la préservation des écosystèmes.
À la différence de celles-ci, toutefois, Hornborg propose qu’une telle monnaie alternative soit créée et mise en circulation par l’État sur l’ensemble du territoire national, mais qu’elle puisse servir uniquement à l’achat de produits fabriqués localement. Du reste, il préconise qu’elle soit versée aux gens sous la forme d’un revenu de base universel. Si l’objectif reste d’encourager la consommation de biens localement produits, et ainsi de diminuer l’avantage concurrentiel des produits importés, la formule qu’il envisage, celle du revenu universel, permet ainsi d’esquiver une difficulté récurrente dans les projets de monnaies locales, soit de créer une demande pour la monnaie elle-même. En toute logique, ainsi munis d’un pouvoir d’achat accru, les bénéficiaires de ce revenu de base seraient conduits à dynamiser la demande pour des biens et des services issus de l’économie locale, qui pourraient ainsi se substituer à des importations rendues moins attractives.
On constate donc que la proposition de Hornborg n’entraîne pas une remise en question radicale du marché comme institution. Le problème, dit-il, ce n’est pas le marché en soi ; c’est plutôt son étendue. En réformant la monnaie de façon à circonscrire au seul échelon local ou régional cette étendue du marché, l’argent servirait ainsi à limiter également les dégâts écologiques et humains de la mondialisation. Dans cette perspective qui s’aligne sur les objectifs de la décroissance (2021, p. 140), il ne s’agit donc pas d’abolir l’argent, au contraire. Il s’agit d’en inverser les pouvoirs. Agent de la destruction planétaire, l’argent deviendrait ainsi le correctif nécessaire. Si l’on en faisait un usage différent, si on l’institutionnalisait autrement, l’argent offrirait ainsi la solution à son propre mal. À la magie noire de l’argent tout usage, il faudrait donc opposer la magie blanche de la monnaie à usage local. Telle serait donc la posologie adéquate pour neutraliser la toxicité inhérente au pharmakon monétaire.
Bien entendu, la proposition défendue par Alf Hornborg ne va pas sans poser quelques problèmes d’ordre pratique. Après tout, le propre du pharmakon, disait Derrida, c’est d’être indécidable. La même indécidabilité vaut sans doute pour ce qui est de définir l’étendue de ce qu’on qualifie de « local ». Pour peu qu’un produit soit complexe à fabriquer, et qu’il contienne un grand nombre de composantes, les chances que celles-ci puissent être toutes approvisionnées localement s’amenuiseront sans doute. Faut-il donc que l’ensemble de la chaîne de valeur soit spatialement circonscrite pour qu’un produit soit qualifié de local, et dès lors admissible à l’achat au moyen de cette monnaie alternative ? Sans compter toutes les marchandises dont il faudrait dorénavant se passer car faites de matières non disponibles localement (mais que l’on pourrait encore se procurer au moyen de la monnaie conventionnelle, qui resterait en vigueur), imagine-t-on la lourdeur des procédures administratives qu’impliquerait la certification de l’ensemble des produits qui se prétendraient « locaux » ?
Du reste, s’il s’agit d’inciter les consommateurs et consommatrices à se tourner vers l’achat local, en leur allouant un revenu qui ne pourrait pas être dépensé à d’autres fins, il n’est pas impossible que l’effet général aille à l’encontre de la sobriété qui est implicitement visée ici. En effet, il ne s’agit pas d’abolir la monnaie officielle « tout usage », dans laquelle les citoyennes et citoyens continueraient à percevoir l’essentiel de leurs revenus. L’idée est d’annexer à celle-ci une monnaie complémentaire « à usage spécifique », valable uniquement pour l’achat de biens localement produits. Globalement, l’ajout de cette seconde monnaie et sa mise en circulation sous forme de revenu de base auraient donc pour effet d’augmenter le pouvoir d’achat. Plutôt qu'à une substitution des importations, dont c’est pourtant l’objectif, la demande accrue induite par une telle réforme monétaire pourrait bien mener à simplement consommer davantage. De même que la monnaie nouvelle serait complémentaire à la monnaie officielle, la demande pour des produits locaux pourrait bien, non pas déplacer, mais s’ajouter à celle pour des produits importés.
En tout état de cause, une proposition semblable participe pleinement d’une forme de gouvernementalité qui, comme le montrait Michel Foucault dans son analyse du néolibéralisme (2004), consiste à instrumentaliser le calcul d’intérêt individuel afin de « conduire les conduites » vers des objectifs politiquement valorisés. Il n’y a là rien d’extravagant en soi. De tout temps, l’argent a constitué une technologie politique, un instrument au service du pouvoir souverain (Graeber, 2011). Dans le cas présent, la formule présente toutefois une analogie assez frappante avec l’esprit des nudges chers aux tenants du « paternalisme libertarien » (Thaler et Sunstein, 2003), soit l’idée qu’on puisse amener les individus à modifier leurs comportements sans compromettre pour autant leur liberté de choix.
À n’en pas douter, relocaliser les circuits économiques dans l’optique d’une décroissance est une condition nécessaire à l’évitement de la catastrophe. Mais que ce soit par manque d’information ou de sensibilisation, ou simplement parce que la convenance ou la contrainte les y poussent, la plupart des gens perpétuent des habitudes d’achats écologiquement insoutenables et éthiquement douteuses. En distribuant sous forme de revenu universel une monnaie qui ne pourrait être utilisée que dans le cadre de circuits courts, on donnerait non seulement aux gens les moyens qui leur manquent peut-être pour consommer localement, tout en stimulant l’offre de ces produits du fait d’une demande accrue. On pousserait du même geste les personnes à faire, malgré elles, des choix censément vertueux, du seul fait que celles-ci auraient un intérêt objectif à dépenser cet argent tombé du ciel. En ce sens, si la proposition de Hornborg se revendique d’une idée de la liberté proche de celle que promeuvent les décroissantistes, celle-ci se résume essentiellement à une liberté de choix, c’est-à-dire une liberté du marché telle que la conçoivent les économistes libéraux, même si ledit marché voit son étendue limitée.
Par là même, on voit en outre en quoi cette proposition reste enferrée dans le vieux paradigme aristotélicien, en ce qui concerne la nature de l’argent. Si elle partage avec Aristote, en effet, l’idée pharmacologique que l’argent est un mal nécessaire – utile aux transactions où s’exprime l’interdépendance humaine, mais nuisible du moment qu’il devient une fin en soi –, la proposition de Hornborg lui fait aussi écho en concevant l’argent, de façon primordiale sinon essentielle, comme un moyen d’échange. Or, comme le notait Simmel, les Grecs anciens n’auraient pu concevoir autrement le rôle de la monnaie « parce qu'autrefois [elle] servait seulement à la consommation, tandis que maintenant [elle] sert essentiellement aussi à la production » (1987 [1900], p. 276). Autrement dit, il manquait à la structure économique autant qu'à la vision du monde des Anciens, le genre d’intérêt qui aurait mené à concevoir l’argent comme un véritable facteur de production. C’est ce dont manque également la proposition de Hornborg, qui, parce qu’elle se résume à réformer l’argent de manière à relocaliser les circuits de l’échange et de la consommation, en vient à perdre de vue en quoi la crise écologique impose un changement dans les modes de production.
Or, en cela aussi, l’argent révèle son caractère pharmacologique ; lequel remonte d’ailleurs aux origines mêmes de la monnaie. Quoi qu’aient pu en dire Aristote et tous ceux et celles qui l’ont suivi, l’argent n’a pas été inventé afin de servir de moyen d’échange. Cette « fable du troc » (Servet, 1994) nous aura trop longtemps aveuglés à la nature réelle de l’argent comme institution sociale. L’argent n’est pas né comme un appendice du marché, de manière à fluidifier des transactions. Héritier de l’école chartaliste, Geoffrey Ingham assure au contraire que « toutes les preuves relatives aux origines historiques de l’argent en font un moyen de calculer des obligations et des dettes » (2004, p. 105)5. Encore aujourd’hui, d’ailleurs, l’argent n’est toujours rien d’autre, fondamentalement, que de la dette. En effet, la plus grande part de la masse monétaire en circulation dans le monde a été portée à l’existence par l’octroi de crédits bancaires, et ceux-ci l’ont été en majeure partie afin de financer non la consommation, mais la production.
Aristote estimait qu’il était contre-nature que l’argent « fasse des petits », qu’il se démultiplie lui-même, puisqu’il ne devait servir que d’intermédiaire entre de « vraies » richesses, qui, elles, comme le bétail, auraient eu ce pouvoir. C’est d’ailleurs pourquoi le métier d’usurier lui paraissait tout spécialement exécrable [1258b]. Or, aussi banale que massive, aujourd’hui, l’usure se paye assurément du prix de l’exploitation humaine et de la déprédation environnementale. En effet, la monnaie de crédit, venue à l’existence par l’octroi de prêts portant intérêts, mène inexorablement à toujours plus de croissance. Comme l’explique Adrian Kuzminski (2013), il faut que l’économie croisse constamment afin que puissent être payés les intérêts sur l’ensemble des dettes en cours. Puisque tout emprunteur ou toute emprunteuse doit rembourser davantage, en guise d’intérêts, que ce qu’on lui a prêté, il lui faut donc se procurer cet excédent. Au niveau global, ceci crée donc un puissant incitatif à la fuite en avant dans le productivisme.
Sans revenir sur les séculaires débats concernant la légitimité du prêt à intérêt (cf. Visser et Mcintosh, 1998), reste qu’un argument décisif en sa faveur fut de faire valoir ses vertus productives. De l’argent épargné dont le prêteur ne faisait pas usage, l’emprunteur pourrait l’employer à ses propres desseins, ce qui encouragerait l’esprit d’entreprise et dynamiserait l’industrie. À plus forte raison, puisque l’émission de prêts ne consiste pas, de nos jours, en une réallocation de l’épargne mais en une création monétaire ex nihilo, il ne semble pas qu’il y ait de limites à cette capacité qu’a la monnaie de crédit de rendre immédiatement disponibles les moyens nécessaires à la fructification des initiatives. De ce point de vue, l’argent n’est pas qu’une simple technologie d’appropriation. Il représente aussi un pouvoir de mobilisation des ressources, humaines et matérielles, qui permet de s’affranchir des limites du donné.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’argent n’est pas une chose, mais une puissance. Créé par un simple jeu d’écriture, l’argent n’est donc pas intrinsèquement rare, comme le sont les ressources qu’il sert à employer et qui sont nécessairement limitées. Les ressources sont rares, mais l’argent ne l’est pas. Il est la puissance, virtuellement sans limite, qui permet de mobiliser des ressources qui, elles, sont limitées. Or, tel est bien ce qui rend la monnaie de crédit immensément problématique dans la perspective de la décroissance. Elle permet d’en faire plus, alors qu’il faudrait plutôt en faire moins. Une approche pharmacologique suggère toutefois qu’elle pourrait aussi permettre de faire mieux, cela tout en favorisant l’épanouissement d’une conception autrement plus riche de l'autonomie que celle qui se résume à la simple liberté de choix, telle qu’elle s’applique à des alternatives monétaires conçues en termes de moyen d’échange.
Dans l’état actuel des choses, l’essentiel de la création monétaire est aux mains des banques commerciales, qui se réservent ainsi le « privilège exorbitant » d’octroyer ou non les financements nécessaires à tout ce que la société entreprend de produire. Elles possèdent donc un droit de regard considérable sur les orientations générales de l’activité économique, qu’elles évaluent selon un critère prépondérant, celui du risque et de la rentabilité. Il va sans dire que les considérations chères aux décroissantistes, comme la dignité humaine ou la soutenabilité écologique, sont globalement absentes de leurs analyses, qui ne répondent d’ailleurs à aucun plan ni vision d’ensemble. Autrement dit, la création monétaire par le crédit bancaire est aussi acéphale et relativiste que ne l’est le marché capitaliste en général. Pour peu qu’il y ait un profit à faire, anything goes…
Or, c’est aussi cette absence de vision, et le court-termisme qui la caractérise, qui nous pousse toujours plus en avant vers la catastrophe. Même sans aller jusqu’à prôner la décroissance, et même en estimant comme le fait Hornborg qu’il ne peut y avoir de solution technologique à la crise écologique, il est pourtant manifeste qu’une réorientation majeure des systèmes productifs s’impose de toute urgence. La transition vers une économie humainement juste et écologiquement soutenable exigera de gigantesques investissements financiers, tout comme elle imposera de renoncer à des activités économiques marquées du sceau de l’extractivisme et de l’exploitation. Dans les deux cas, il y va de la nécessité de faire jouer le pouvoir de l’argent.
En d’autres termes, l’enjeu est celui d’un contrôle démocratique du crédit, qui consisterait à décider collectivement des finalités auxquelles devrait servir la création monétaire. « Démocratiser le crédit », en ce sens, veut dire se réapproprier collectivement le pouvoir de créer la monnaie pour décider en commun de ses usages et de ses finalités. De la même façon qu’il permettrait de décider de ce que l’on devrait cesser de financer au nom de la justice sociale et de la justice écologique, un tel pouvoir offrirait pareillement la capacité de juger de ce qui mérite qu’on lui accorde collectivement notre crédit6. En somme, la lutte autour du pouvoir monétaire est par le fait même une lutte pour la définition du possible et du souhaitable. C’est pourquoi elle devrait être au cœur de toute réflexion visant à faire advenir une économie post-capitaliste.
*
Si l’argent constitue une puissance sociale, cela doit s’entendre au double sens de ce qu’on appelle en latin la potentia, soit la capacité d’agir et d’affecter, et la potestas, soit l’autorité légale ou politique, c’est-à-dire le pouvoir de décision. La prise en compte de ce double caractère politique est nécessaire à toute pensée de l’argent comme outil d’émancipation. En ce sens, la potentia monétaire, le pouvoir de mobilisation des ressources inhérent à l’argent et qui décuple notre capacité d’agir collective, est elle-même adossée à l’idée du pouvoir comme potestas, comme autorité au sens politique du terme. De ce point de vue, l’atteinte des objectifs de la décroissance, soit la possibilité d’une organisation sociale qui puisse être compatible avec les limites écosystémiques, exige non seulement une transformation profonde de notre mode de production et de consommation, mais aussi une démocratisation intégrale de l’argent, en tant que technologie fondatrice de notre économie.
L’intérêt de cette approche de l’institution monétaire, c’est qu’elle reformule la question de savoir comment l’on peut financer les moyens de satisfaire nos besoins. Aussi, si l'on entend par « économie » ce genre de relation que Karl Polanyi aurait qualifiée de « substantive » – c’est-à-dire l’économie en tant que rapport métabolique entre une collectivité humaine et son environnement naturel –, la manière d’instituer socialement le pouvoir de l’argent apparaît déterminante quant à notre façon de vivre et d’habiter le monde. Il importe donc de réévaluer en profondeur le rôle que joue l’argent dans notre société, et ainsi la nature, apparemment si banale, de cette chose qui n’est justement pas une chose, mais bien une institution politique fondamentale.
La perspective dessinée par Alf Hornborg dans son ouvrage nous invite précisément à une telle réflexion, mais elle reste cantonnée à une vision trop limitative de la monnaie, comprise d’abord et avant tout comme moyen d’échange. Cela étant, elle a le mérite d’attirer l’attention sur l’ambivalence essentielle de l’argent, qui, tout en étant à la racine du pillage écologique, peut néanmoins offrir les contre-mesures nécessaires à son interruption, pour peu qu’on réforme radicalement son mode de création et de mise en circulation. En revanche, en visant d’abord et avant tout à changer nos modes de consommation, de manière à relocaliser les circuits de l’échange marchand, elle laisse dans l’ombre le rôle que joue aussi la monnaie en tant qu’instrument de crédit. Or, celui-ci est primordial du point de vue de la structure de la production, et peut-être plus dommageable encore, dans la mesure où la prise d’intérêt rend impérative une croissance illimitée.
En cela aussi, toutefois, l’argent présente un caractère pharmacologique. L’argent a toujours été, et reste encore aujourd’hui, d’abord et avant tout le marqueur d’une relation sociale d’endettement, et c’est à ce titre qu’on peut aussi comprendre en quoi il constitue un pouvoir au double sens entendu il y a un instant. Mais ce pouvoir est fondamentalement ambivalent. Créateur de dettes, celles-ci peuvent tout aussi bien asservir qu’émanciper7. Ainsi en va-t-il du crédit. Ordonné aux seules fins du profit, il est sans doute à la racine de tous nos maux. Or, à l’inverse, il est aussi ce qui permet de mobiliser les ressources nécessaires à toute entreprise, y compris à des projets qui viseraient à satisfaire les besoins humains dans le respect des équilibres naturels. C’est pourquoi la réappropriation de ce pouvoir est indispensable dans l’optique de la décroissance. En permettant de décider collectivement des finalités de la création monétaire, une démocratisation du crédit fournirait les moyens et l’impetus nécessaires à la transition vers une économie socialement et écologiquement plus juste et soutenable.
Or, puisqu’il s’agit, comme le dirait Polanyi, de « réencastrer » l’économie dans les limites des écosystèmes, cette vision du pouvoir de l’argent exige, de façon paradoxale, de sortir du paradigme de la rareté. Combien de fois a-t-on entendu, en effet, qu’on ne peut satisfaire les besoins fondamentaux de l’humanité ni financer les coûts de la transition écologique, parce que l’argent manque ? Sous prétexte d’une soi-disant rareté de l’argent, on laisse inemployées quantités de ressources humaines et matérielles qui ne demandent pourtant qu’à être mobilisées au service du bien commun. Pourtant, l’argent n’est pas une chose, inextensible et finie. L’argent, c’est fondamentalement une relation de crédit qui, comme le mot le dit, constitue un acte de foi, un pari fondé sur la confiance. Du point de vue d’une ontologie relationniste, l’argent relève donc bel et bien de la magie. Ceci implique qu’il n’y a pas de limite au pouvoir de l’argent.
Si le pouvoir de création monétaire obéissait à une volonté démocratique, il deviendrait théoriquement possible de financer tous nos besoins, par le simple effet performatif d’un jeu d’écriture. Maintenant, comment peut-on réconcilier ce pouvoir, a priori illimité, de création monétaire, et les limites écologiques avec lesquelles nous devons apprendre à composer ? La question reste entière. Ceci suggère en effet de penser la décroissance non pas sur le mode de l’austérité, mais de l’abondance, ce qui, convenons-en, ne va pas de soi. Toutefois, si cette réflexion a quelque mérite, c’est de nous rappeler que l’argent est un pharmakon, une puissance foncièrement ambivalente. S’il peut servir d’instrument à l’oppression, à la dépossession et à la dilapidation de nos ressources, il peut aussi contribuer à notre émancipation collective, cela non pas en nous libérant de nos dettes et de nos dépendances, mais en nous rappelant au contraire à notre interdépendance sociale et naturelle, ainsi qu’aux dettes qui nous lient les uns aux autres, et dont dépend in fine notre survie sur cette Terre.