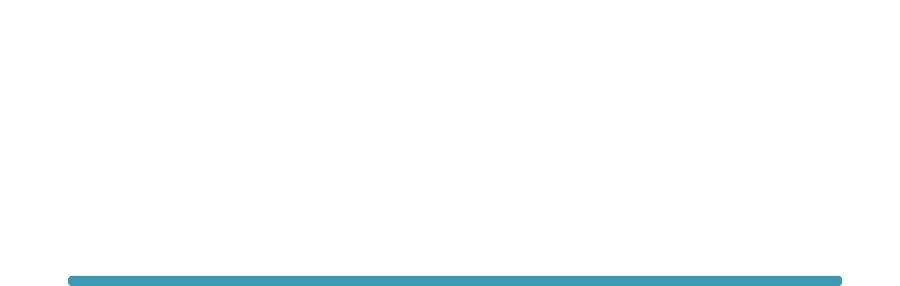I. Droit immobilier1
A. Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20‑17.554, FS‑B n° 583
Dans son arrêt du 23 juin 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que le promettant d'une promesse unilatérale de vente ne peut pas se rétracter. S’il tente de se rétracter, alors la sanction peut résider dans l’obligation de conclure la vente, mais le bénéficiaire peut également préférer obtenir des dommages et intérêts ou la mise en œuvre de la clause pénale.
Dans cette affaire, deux époux avaient consenti à deux autres une promesse de vente d’un appartement le 1er avril 1999, l’option ne pouvant être levée qu’au décès de la précédente propriétaire, laquelle s'était réservée un droit d'usage et d'habitation. Après le divorce des époux promettants, l’un d’eux est devenu attributaire du bien et s’est rétracté de la promesse le 17 février 2010. Au décès de la précédente propriétaire, les bénéficiaires de la promesse ont levé l’option le 8 janvier 2011 et ont assigné l’épouse promettante pour avoir violé son engagement. Cette dernière a sollicité le rejet de la demande.
La Cour d'appel de Lyon a relevé que, dans l'acte du 1er avril 1999, l’épouse promettante avait donné son consentement à la vente sans restriction et que la levée de l'option par les bénéficiaires était intervenue dans les délais définis à l’avant‑contrat. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a retenu à bon droit que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente, et en a promptement déduit que les consentements des parties s'étant rencontrés lors de la levée de l'option par les bénéficiaires, la vente était parfaite. Elle rejette alors le pourvoi.
Une promesse unilatérale est, selon l’article 1124 du Code civil :
Le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Puisque seul le promettant est engagé, libre au bénéficiaire de lever l’option et ainsi de former le contrat, ou non. Toutefois, le cas de figure qui suscite le plus de difficultés en pratique est celui dans lequel le promettant se rétracte pendant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option. En l’absence de solution textuelle, c’est la jurisprudence qui s’est d’abord prononcée et est restée constante depuis son arrêt de principe « Consorts Cruz » du 15 décembre 19932. La Cour de cassation refusait en effet toute exécution forcée en cas de rétractation du promettant avant la levée de l’option par le bénéficiaire car, selon elle, il n’y avait jamais eu de rencontre de volontés.
Le législateur a rompu son silence par l’ordonnance du 10 février 2016 et a consacré la solution de l’impossibilité de révocation de la promesse unilatérale par le promettant. Il va de ce fait à l’encontre de la jurisprudence établie et énonce à l’article 1124 alinéa 2 du Code civil que :
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Toutefois, cette réforme n’étant entrée en vigueur que le 1er octobre 2016, ce nouvel article ne s’appliquait pas aux promesses conclues avant cette date, qui restaient alors régies par la jurisprudence « Cruz ». Cette différence de solution a souvent abouti à des solutions divergentes en fonction de la date de conclusion de la promesse.
Ainsi, cet arrêt du 23 juin 2021 vient harmoniser le régime de la rétractation des promesses unilatérales par le promettant. La Cour de cassation fonde d’abord son argumentaire sur le fait que la promesse unilatérale de vente est un avant‑contrat qui contient les éléments essentiels du contrat définitif, dont l’intérêt est de laisser la faculté d’option au bénéficiaire. L’acte de vente définitif n’est, en effet, que la réitération des éléments énoncés dans la promesse. Désormais, l’irrévocabilité de la promesse conclue ne pourra plus être remise en cause par le promettant, même si celui‑ci décide de se rétracter, alors même que le bénéficiaire se trouve encore dans son délai d’option. Ainsi, cette solution s’applique dorénavant aux promesses conclues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 20163.
B. Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 19‑24.9944
Dans cette affaire, la Cour de cassation apporte des précisions concernant le contenu de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement. En effet, il était demandé à la Cour si la surface stipulée dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement s’entend d’une surface habitable au sens de l’article R. 111‑2 du Code de la construction et de l’habitation.
Une société civile de construction avait vendu à des époux différents lots d'un ensemble immobilier, dont un appartement vendu en l'état futur d'achèvement. Après la livraison, les époux avaient fait mesurer la surface habitable de l'appartement par un technicien. Ce dernier avait constaté une différence entre la surface indiquée dans le contrat de vente et la superficie réelle. L’écart provenait des parties de l’appartement, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres. Les acquéreurs ont donc assigné la société venderesse en diminution du prix et dommages et intérêts.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu le 27 septembre 2019, a déclaré l’action irrecevable, estimant que les acquéreurs ne justifiaient pas que les parties avaient entendu exclure de la surface habitable les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres. En conséquence, les époux acquéreurs se sont pourvus en cassation. Ils soutenaient qu’il ne fallait pas prendre en compte la surface habituelle réelle mais la surface habitable ; et que cette dernière était précisée sur les plans annexés à l’acte. Ce document récapitulait la surface totale de 51,7 mètres carrés et par conséquent, les parties s’étaient entendues sur cette surface habitable.
Il est opportun de relever que, jusqu’à cette décision, la mention d’une superficie, au sens de la loi « Carrez » qui comptabilise seulement les surfaces d’une hauteur sous plafond atteignant 1,80 mètres, n’était pas obligatoire dans un acte de vente en VEFA, y compris en secteur protégé, pour lequel seule la « surface habitable approximative » était requise selon l’article R. 261‑25 du CCH5.
Selon l’article L. 261‑10 et l’article L. 261‑11 du Code de la construction et de l’habitation, l'acte de vente, ayant pour objet un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte rentrant dans le champ d’application du secteur protégé, doit comporter des mentions obligatoires, dont la consistance. Selon l’article R. 263‑13 du même code, la consistance résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et de l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements. Le contrat doit mentionner une surface approximative. Pourtant, les textes relatifs au contrat définitif de vente d’immeubles à construire ne visent pas de surface habitable.
La Cour de cassation a comblé cette omission. Elle affirme que la surface stipulée dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement s’entend à une surface habitable au sens de l’article R. 111‑2 du Code de la construction et de l’habitation ; et que, par conséquent, les surfaces d’une hauteur sous plafond inférieur à 1,80 mètres de hauteur sont exclues. La jurisprudence a réaffirmé sa position6 7.
II. Droit de la famille
A. Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19‑21.4638
Deux époux s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils avaient acquis durant leur union un bien en indivision, devenu le logement de la famille. Ce bien avait été financé par un apport personnel réalisé par l’épouse. Les époux ont décidé de divorcer et des difficultés sont nées lors de la liquidation de leur régime à propos de l’existence d’une créance entre époux. Leur contrat de mariage stipulait notamment que :
Chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
L’épouse estimait avoir doit à une créance entre époux pour avoir financé le logement de la famille.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 mai 2019, a rejeté la demande de créance de l’épouse au titre de l’acquisition du logement de la famille au motif que « les versements effectués par l’un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition » au cours du mariage, constituent une contribution aux charges du mariage. Elle n’opère aucune distinction selon le mode de financement, emprunt ou apport. En outre, elle considère que l’apport de l’épouse n’est pas d’un montant excessif eu égard à ses facultés et rentre bien dans cette obligation9.
L’épouse a formé un pourvoi en cassation. Elle affirme que seul le remboursement d’un emprunt participe à l’obligation de contribution aux charges du mariage. Ayant effectué un apport personnel, comme l’a constaté elle‑même la cour d’appel, et non remboursé un emprunt, elle estime pouvoir bénéficier d’une créance entre époux au titre du financement du logement de la famille10.
La question posée à la Cour de cassation est la suivante : le financement du logement de la famille par apport personnel d’un époux séparé de biens donne‑t‑il lieu à créance entre époux ?
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mars 2021 estime qu’en l’absence de stipulation contraire entre les parties :
L’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Une distinction claire est effectuée selon le mode de financement. En effet, le remboursement de l’emprunt au moyen des revenus de l’époux constitue une forme de contribution aux charges du mariage contrairement à l’apport de deniers personnels. L’apport de fonds personnels pour financer le logement familial donne donc lieu à créance entre époux11.
La Cour de cassation rappelle une solution qu’elle a déjà eu l’occasion d’énoncer dans un arrêt de principe du 3 octobre 201912. Toutefois, cet arrêt précisait l’origine des deniers de l’apport, qui provenaient de la vente d’un bien personnel, alors qu’en l’espèce rien n’est précisé. Ce point a suscité un débat doctrinal. D’une part, certains auteurs affirment que seul l’apport personnel provenant de la vente d’un bien personnel peut donner lieu à créance. D’autre part, d’autres avancent que peu importe l’origine des deniers, dès lors qu’ils sont personnels, le financement donne lieu à créance. Là où la Cour de cassation ne distingue pas, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction. Il semble donc préférable de retenir la seconde analyse13 14.
B. Cass. 1re civ., 1er décembre 2021, n° 20‑10.956 (764FB)15
Dans cette affaire, la Cour de cassation précise la qualification retenue pour les aides personnalisées au logement. En effet, elle considère qu’elles constituent un substitut de revenus, et entrent donc dans la communauté.
Un couple, marié sous le régime de la communauté légale, a divorcé et un litige est survenu au moment de la liquidation de leur régime. Le logement de la famille avait été acquis par Madame avant le mariage, constituant ainsi un bien propre à cette dernière en vertu de l’article 1405 du Code civil. À ce titre, elle avait contracté un emprunt remboursé pour partie pendant le mariage grâce à une aide personnalisée au logement (APL) versée directement à l’établissement bancaire. Quant à Monsieur, il avait acquis un véhicule pendant le mariage sans déclaration d’emploi, et financé au moyen d’un prêt dont il affirme avoir remboursé seul les échéances.
En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement, la cour d’appel a jugé que l’aide perçue entrait dans la masse commune et ouvrait droit à récompense au profit de la communauté. Madame soutient que l’aide versée directement à l’organisme prêteur n’entre pas dans le patrimoine commun et par conséquent n’ouvre pas droit à récompense. En outre, selon elle, la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes, qui constituent des charges de jouissance de ces biens, sans que leur paiement ne donne droit à récompense, même si l’aide est qualifiée de deniers communs. Quant à la voiture, la cour d’appel exclut le droit à récompense sans rechercher la nature des fonds employés. Madame soutient l’existence d’un droit à récompense au profit de la communauté.
Deux problèmes étaient ainsi posés à la Cour de cassation. D’une part, le financement d’un bien propre par une aide personnalisée au logement donne‑t‑elle droit à récompense au profit de la communauté ? D’autre part, une récompense peut‑elle être refusée à la communauté lorsqu’un bien propre a été financé grâce à un emprunt ?
La Cour de cassation a estimé que l’aide personnalisée au logement constituait un substitut de revenus et entrait donc dans la masse commune, « peu important qu’elle soit versée directement à l’organisme prêteur ». La Cour rappelle que seuls les intérêts sont des charges de jouissance incombant définitivement à la communauté. Ainsi, seule la fraction en intérêts peut être soustraite du calcul de récompense. Le capital de l’emprunt incombe à l’époux propriétaire en propre. Sur le second point, la Cour de cassation estime que la cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande de récompense sans rechercher la nature des fonds employés au paiement des échéances du prêt contracté pour l’acquisition d’un bien propre. Elle rappelle que sans preuve, les biens sont présumés communs.
Certains tribunaux avaient jugé au visa de l’article 1404 du Code civil que les aides personnalisées au logement étaient des deniers propres en raison de leur caractère incessible et insaisissable16. Mais par cette décision du 1er décembre 2021, la Cour de cassation retient pour la première fois la qualification de substitut de revenus pour l’aide personnalisée au logement, élargissant ainsi le champ d’application de son célèbre arrêt de 1978, dans lequel elle avait qualifié les gains et salaires de biens communs17. La Haute Cour a déjà retenu la qualification de substituts de revenus, mais uniquement dans le cadre professionnel18. La Cour de cassation rappelle que le financement d’un bien par un emprunt est une opération semblable à un paiement direct de la dépense. Afin de déterminer si une récompense est due, il faut connaitre la nature des deniers utilisés.
Concernant le véhicule, la Cour de cassation rappelle l’existence d’une présomption de communauté. En effet, sans preuve contraire, l’emprunt est présumé avoir été remboursé par la communauté. Ainsi, il faut rechercher et prouver la provenance des fonds employés au remboursement d’un emprunt pendant le mariage afin de renverser la présomption.
Il faut tout de même rappeler que la récompense due par l’épouse ne concerne que le capital emprunté, les intérêts incombant définitivement à la communauté, en vertu de l’arrêt « Authier »19 20.
III. Droit des biens
A. Cass. 3e civ., 15 avril 2021, n° 20‑13.64921
Un père avait construit une maison sur un terrain appartenant à sa fille avec l’autorisation de cette dernière. Après avoir quitté les lieux, le père a demandé le remboursement à sa fille des sommes engagées au titre de ladite construction.
Le père a assigné sa fille en remboursement des constructions sur le fondement de l’article 555 du Code civil. Cette demande a été rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 22 octobre 2019. Le père a alors formé un pourvoi au moyen qu’il avait été autorisé par sa fille à construire l’immeuble objet du litige et qu’il l’avait dès lors fait de bonne foi au regard de l’article 555 du code civil. Il considère donc ne pas pouvoir être condamné à la démolition puisqu’une telle autorisation vaut renonciation tacite au droit à démolition.
La question soumise à la Cour de cassation était de savoir si le constructeur autorisé à faire des constructions sur le terrain occupé peut être considéré comme de bonne foi au sens de l’article 555 du Code civil.
Dans l’arrêt étudié rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les juges rejettent le pourvoi formé par le père, et affirment que ce dernier n’était pas de bonne foi. L’article 555 du Code civil précise que lorsque les constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Cependant, lorsqu’elles ont été faites par un tiers évincé qui n’a pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne peut exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations. La Cour de cassation rappelle que :
La bonne foi au sens de l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550.
Ainsi, l’autorisation donnée à un tiers par le propriétaire d’un terrain d’édifier une construction sur son terrain ne caractérise pas la bonne foi du constructeur, lequel ne dispose d’aucun titre translatif de propriété lui faisant croire qu’il était lui‑même propriétaire du terrain22.
La bonne foi permet de déterminer « le sort des plantations et constructions sur le terrain d'autrui et […] les droits du propriétaire du terrain23 ». La solution apportée par la Cour de cassation en date du 15 avril 2021 affirme, dans la continuité des arrêts antérieurs24, que la qualification de bonne foi qui figure dans l’article 555 du Code civil ne peut être attribuée qu’à celui qui possède comme un propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Elle met fin à des doutes jurisprudentiels concernant l’incidence sur la qualification de bonne foi de l’accord du propriétaire autorisant un tiers à effectuer des constructions sur son terrain. En effet, l’arrêt du 15 avril 2021 affirme désormais que le constructeur autorisé par le propriétaire à édifier sur le terrain de ce dernier, ne peut pas prétendre être de bonne foi en raison de l’obtention de ladite autorisation. Seule la détention d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, permet de prouver la bonne foi. Cette solution peut paraître très sévère, mais est pourtant en accord avec la jurisprudence traditionnelle qui tend vers une restriction de la notion de bonne foi en admettant la définition stricte de l’article 550 du Code civil25 bien qu’il s’agisse d’une « conception technique de la bonne foi qui diffère du sens général26 ».
B. Cass. 3e civ., 30 juin 2021, F‑B, n° 20‑14.74327
En 1983, deux propriétaires avaient vendu une parcelle à deux acquéreurs. L’un des deux vendeurs avait continué d’occuper le bien sans contestation de la part des acquéreurs. Ceux‑ci revendirent la parcelle en 2010, toujours occupée par le premier vendeur.
Les acheteurs successifs ont alors été assignés par le vendeur‑occupant, lequel revendiquait la propriété de la parcelle. La cour d’appel déboute ce dernier de ses prétentions. Le vendeur‑occupant forme alors un pourvoi en cassation.
Un vendeur peut‑il revendiquer la propriété d’un bien, qu’il a lui‑même vendu mais qu’il occupe toujours, en se fondant sur la prescription acquisitive ?
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 30 juin 2021, considère que le vendeur se doit de garantir l’acquéreur contre toute éviction provenant de son fait personnel et que l’action en usucapion pour détention trentenaire constitue une telle éviction28. Le vendeur ne peut pas s’en prévaloir contre son acquéreur pour se faire reconnaitre la propriété du bien qu’il a vendu. Les juges évoquent également le caractère perpétuel de la garantie d’éviction du fait personnel. Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme sa position antérieure29, admise depuis plus d’un siècle.
En définitive, il ressort de l’arrêt commenté que la protection perpétuelle de la garantie d’éviction apportée à l’acquéreur prime sur la finalité de sécurité juridique qui justifie le mécanisme de l’usucapion, instituée dans un but d’intérêt général30. Conformément à l’adage « qui doit garantie ne peut évincer », il apparaît logique qu’un vendeur, tenu par la garantie d’éviction, ne puisse se faire reconnaître la propriété d’un bien qu’il a lui‑même vendu et dont il a conservé la possession en invoquant la prescription acquisitive.
En réaction à cet arrêt, certains auteurs émettent l’idée d’une reconnaissance de l’usucapion en faveur d’un vendeur, en cas d’inaction de l’acquéreur pendant une durée d’au moins trente ans31. Dans un tel cas, le comportement passif d’un acquéreur pendant ledit délai de trente ans devrait s’apparenter à la volonté dudit acquéreur d’aliéner le bien ou s’analyser comme une confirmation de l’usucapion32, ce qui, in fine, permettrait l’aboutissement de la demande du vendeur‑occupant fondée sur la prescription acquisitive. Dans un tel cas, l’acquéreur ne serait pas en mesure d’opposer le caractère perpétuel de la garantie d’éviction du fait personnel.
Cet arrêt apparaît par ailleurs surprenant compte tenu de la qualité inhabituelle du demandeur, le vendeur‑possesseur. En effet, il est plus courant que celui‑ci soit le propriétaire véritable du bien qui cherche à évincer l’occupant des lieux. Cela s’explique par le fait que la prescription acquisitive n’est qu’un moyen de défense33, utilisé pour repousser la prétention juridique du demandeur et faire échec à l’action en justice qu’il intente34. Il n’existe pas d’action en reconnaissance de prescription acquisitive. Ainsi, l’acheteur se défend de l’action exercée par le vendeur‑possesseur qui invoquerait l’usucapion35.
IV. Droit rural
A. Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19‑26.34336
En vertu des articles 1719 4° du Code civil et L. 415‑8 du Code rural et de la pêche maritime, le propriétaire doit assurer « la permanence et la qualité des plantations ». Quel est, de ce fait, le devenir des plantations financées et entretenues par le preneur, à la fin du bail ?
Dans cet arrêt de la Cour de cassation, deux époux avaient pris à bail des parcelles de terres à vigne pour une durée de vingt‑cinq ans de 1968 à 1993. En 1977, le bail avait été cédé à leur fille et son époux, les bailleurs étant intervenus à l'acte pour consentir la cession et proroger le bail pour deux ans, ce qui donnait un nouveau terme au bail pour 1995. Par la suite, les bailleurs avaient consenti un nouveau bail à long terme de dix‑huit ans aux preneurs en place, de 1995 à 2020. L’un des époux avait cédé son droit au bail à son fils en 1999, lequel avait informé le bailleur en 2008 de la mise à disposition des terres à une exploitation agricole à responsabilité limitée. En 2016, un congé fut délivré aux preneurs en place, prenant effet au terme du bail en cours.
Les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé et en revendication de la propriété des plantations. La demande ayant été rejetée par la cour d’appel de Reims, dans son arrêt rendu le 10 juillet 2019, les preneurs en place ont formé un pourvoi en cassation où ils ont fait valoir qu’il résultait clairement du bail initial que le bailleur renonçait à la propriété immédiate des plantations réalisées par les preneurs.
La Cour de cassation vient affirmer que le bailleur devient propriétaire des plantations à la fin du bail ou au moment de son renouvellement. Puisque le contrat du bail renouvelé ne contenait aucune clause ou renonciation de la part des propriétaires à exercer leur droit d’accession sur les vignes plantées au cours du bail, les bailleurs étaient devenus propriétaires des plantations à la date initialement prévue dans le bail initial, soit le 31 octobre 1995. En outre, elle retient que la revendication d’une propriété temporaire des plants de vignes par le preneur pendant la durée du nouveau bail, de 1995 à 2020, est impossible puisqu’aucune clause expresse des bailleurs de renonciation à leur droit d’accession n’avait été formulée dans ce bail.
En matière de baux ruraux, la solution d’une accession immédiate des plantations viticoles était retenue jusqu’en 2017, afin d’éviter que le preneur arrache les plantations en fin de bail. Ainsi, les plants de vignes avaient vocation à devenir la propriété du bailleur dès leur plantation. La jurisprudence a toutefois modifié cette solution en opérant un revirement. Désormais, la règle est celle de l’accession différée pour tout type de plantation ; sauf convention contraire, toute construction effectuée par le preneur lui appartient pendant la durée du bail en cours, l’accession du bailleur à leur propriété se produisant au jour du renouvellement du contrat37. Le présent arrêt confirme cette position en matière viticole. Cette solution affirmée par la cour, découlant des textes et de la jurisprudence antérieure, n’est pas absolue. Elle ne s’applique qu’en l’absence d’une clause conventionnelle entre les parties, lesquelles peuvent tout à fait convenir entre elles d’une indemnisation du preneur en raison des améliorations effectuées sur la terre louée, voire l’arrachage des vignes au terme du bail souscrit, afin que le preneur puisse replanter ailleurs en sollicitant une autorisation administrative à FranceAgriMer. Il reste cependant possible de protéger les intérêts du bailleur en prévoyant que l’arrachage nécessite une autorisation préalable de sa part.
En pratique, les rédacteurs de baux ruraux doivent veiller à prévoir des clauses spécifiques dans les contrats, afin de régler le sort des améliorations du fonds dans lesquelles s’inscrivent les plantations. Il peut s’agir d’un transfert de propriété des constructions au profit du preneur aussitôt l’accession par le bailleur faite, ou d’un report du transfert de propriété au profit du bailleur à la date de la sortie du fonds par le preneur, voire de toute autre modalité de transfert38.
B. Cass. 3e civ., 4 mars 2021 n° 20‑14.14139
Copreneurs : savoir partir pour mieux rester40.
Tel est le titre d’un article de Monsieur Crevel paru il y a quelques mois. C’est ici tout l’enjeu de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2021, qui concerne une nouvelle cause de résiliation du bail.
En l’espèce, des bailleurs avaient consenti à trois copreneurs, dont un groupement foncier agricole, transformé depuis en exploitation agricole à responsabilité limitée, un bail rural à long terme d’une durée de dix‑huit ans. En cours de bail, l’un des copreneurs décida de cesser l’exploitation du bien loué sans que les autres prennent soin d’en informer le bailleur, comme il est désormais requis par la loi. Le bailleur s’en est rendu compte et a demandé la résiliation du bail en cours pour méconnaissance de l’obligation d’information incombant aux copreneurs restants. La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 9 janvier 2020, a répondu favorablement à cette demande et les copreneurs ayant poursuivi l’exploitation des biens loués ont formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation vient affirmer que le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information du propriétaire, en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs, constitue un manquement aux obligations nées du bail, ainsi qu’une violation de l’article L. 411‑35 du Code rural, passible de la résiliation du contrat sur le fondement de l’article L. 411‑31, II, 1°.
Dans le cadre d’un GFA, lorsque l’un des copreneurs cesse de participer à l’exploitation du bien loué, il convient, pour le ou les copreneur(s) qui continue(nt) à exploiter le fonds, de demander au bailleur, dans un délai de trois mois à compter de cette cessation, que le bail se poursuive à leur seul nom. À défaut, le bailleur peut exiger la résiliation de plein droit du bail au titre d’un manquement à cette obligation d’information. La Cour de cassation s’est attachée à préciser qu’aucun préjudice du bailleur ou montage frauduleux de la part des copreneurs n’est nécessaire pour pouvoir exiger cette résiliation. Il est vrai qu’une lecture stricte des textes permet de considérer la violation de l’article L. 411‑35 comme une contravention, dans la mesure où l’obligation d’information est expressément prévue par ce dernier et sanctionnée par la nullité. La solution retenue s’inscrit dans l’évolution jurisprudentielle récente qui sanctionne la cessation d’activité d’un copreneur au profit d’une mise à disposition des terres louées à une société dans laquelle les preneurs n’étaient pas associés « en une cession prohibée, entraînant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur41 ». En l’espèce, le départ du copreneur peut en ce sens être perçu comme une cession de sa part du fonds loué aux autres copreneurs. Toutefois, au regard de la volonté protectrice du législateur à l’égard du fermier, cette interprétation qui se borne à appliquer les textes est discutable au regard de l’insécurité contractuelle qu’elle vient créer à son sujet, puisque même sans mauvaise foi, le contrat de bail peut facilement être remis en cause et résilié. À ce titre, dès lors que l’un des copreneurs cesse de travailler sur l’exploitation, le ou les autre(s) fermier(s) restant exploitant(s) doi(ven)t impérativement solliciter auprès du bailleur la continuation du contrat, et ce dans le délai de trois mois impartis par la loi, à défaut de quoi la résiliation du bail pourra être prononcée.
Dans cet arrêt, les juges de la Cour de cassation ont donc implicitement créé une nouvelle cause de résiliation du bail, et une nouvelle éventuelle porte de sortie pour les bailleurs. De fait, cet arrêt appelle à une grande vigilance de la part des copreneurs lors de la sortie de l’un d’eux, mais également du notaire, dans son devoir de conseil, qui ne devra pas omettre de préciser cette cause de résiliation du bail rural42.
V. Droit des affaires
A. Cass. 3e civ., 15 décembre 2021, n° 20‑14.42343
Dans son arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur les obligations du bailleur propriétaire d’un local commercial.
Une SCI avait consenti à une société commerciale, un bail commercial sur un local situé dans un centre commercial. Mécontente de la commercialité du centre, la société locataire a délaissé les lieux et demandé une résiliation du bail ainsi qu’une indemnisation de son préjudice résultant des manquements, par la bailleresse, à son obligation de délivrance et à ses engagements contractuels. Elle estimait que la bailleresse n’avait pas assuré une commercialité du centre permettant l'exploitation pérenne de son fonds.
La cour d’appel de Paris44, s’inscrivant dans une continuité jurisprudentielle45, a débouté la société locataire de sa demande et prononcé la résiliation du bail à ses torts en affirmant que la bailleresse, à défaut de stipulation au contrat, n’avait pas l’obligation d’assurer la bonne commercialité du centre. Toutefois, la cour a reproché à cette dernière un manquement à son obligation de délivrer un local dans un centre commercial haut de gamme présentant une décoration soignée et la condamne à verser une somme au locataire en réparation de sa perte de chance d’assurer la pérennité du fonds.
La société locataire ainsi que la bailleresse se sont pourvues en cassation. La première affirme que le bailleur d’un centre commercial est tenu à une obligation de délivrance et doit assurer au locataire un environnement commercial qui lui permette l’exercice de son activité dans des conditions normales. La seconde affirme qu’à défaut de stipulation au contrat, elle n’avait aucune obligation légale quant à la fréquentation du centre, et donc qu’aucun manquement à son obligation contractuelle ne pouvait lui être reproché.
Un bailleur est‑il tenu d’assurer la commercialité du local commercial en l’absence de stipulation dans le contrat de bail ?
La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel. Elle affirme, sur le fondement de l’article 1719 du Code civil, que le bailleur est obligé, par la nature du contrat de bail, de délivrer la chose louée au preneur et de l’entretenir pour qu’elle puisse servir à l’usage pour lequel elle a été louée et approuve l’arrêt d’appel, en ce que le bailleur ne peut pas être tenu, en l’absence de clause particulière, d’assurer la commercialité du local. Toutefois, elle censure la condamnation de la bailleresse propriétaire à verser à la société locataire des dommages‑intérêts pour manquement à son engagement contractuel en retenant que les clauses du bail interdisaient au locataire « d’adopter une enseigne de moindre notoriété en cours de bail et d’axer sa communication sur la vente de produit à bas prix » et le rendaient responsable financièrement des aménagements luxueux. Pour la Cour de cassation, ces clauses n'engendraient d'obligations qu'à la charge du preneur mais aucune à la charge de la bailleresse.
Cet arrêt, conforme à la jurisprudence, met en exergue l’absence d’obligation pour le bailleur d’assurer la commercialité d’un local commercial situé dans un centre commercial au locataire. S’il doit délivrer la chose louée au preneur et l’entretenir pour qu’elle puisse servir à l’usage pour lequel elle a été louée, il n’est pas tenu, en l’absence de clause dans le contrat de bail, d’assurer la commercialité du local commercial. Cela témoigne de la liberté des parties d’insérer ou non dans le contrat une clause de maintien de commercialité du centre à la charge du bailleur. Ce n’était pas le cas en l’espèce. Cette décision est justifiée car les juges appliquent le contrat à la lettre, mais elle peut être critiquée du fait qu’ici, c’est le locataire qui s’était engagé à maintenir une activité de standing alors qu’une telle obligation s’impose habituellement au bailleur. Et souvent, ce sont les bailleurs qui s’occupent de rédiger les contrats, ce qui signifie que la locataire était libre de ne pas y adhérer et de ne pas s’engager. Il est donc normal que la bailleresse ne soit pas mise en cause. Toutefois, si la locataire souhaitait s’implanter dans un endroit prisé et attractif, elle n’avait pas d’autre choix que d’adhérer au contrat. C’est donc cette difficulté qui persiste.
B. Cass. com., avis, 1er décembre 2021, n° 20‑15.16446 et Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20‑16.164 FS‑B47
Dans son avis du 1er décembre 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualité d’associé de l’usufruitier. Une SCI familiale avait été constituée par une mère et deux de ses enfants. Sa fille avait été désignée gérante. En 2010, la mère avait cédé la totalité de ses parts à cette dernière et à son fils. En janvier 2018, la cession de l’usufruit d’une partie des parts sociales était intervenue au profit des parents et une augmentation du capital social avait eu lieu en mai de la même année. Le troisième enfant du couple a acquis des parts dans la société. L’usufruit des parts fut attribué aux parents. Par lettre recommandée, les parents ont demandé à la gérante de la SCI de provoquer la délibération des associés concernant sa révocation. Ils ont également demandé qu’une cogérance soit mise en place en remplacement de cette dernière.
La gérante ne répondant pas à la lettre recommandée, les usufruitiers l’ont assignée en justice sur le fondement de l’article 14 des statuts de la SCI pour que soit désigné un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés en vue de prévoir la révocation de la gérante de ses fonctions et de permettre la mise en place du système de cogérance et des cogérants. La cour d’appel de Bordeaux a rejeté leur demande dans son arrêt du 11 février 2020 aux motifs que les parents n’avaient pas la qualité d’associés car ils n’étaient qu’usufruitiers.
Les usufruitiers ont alors formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que l'usufruitier de parts sociales a la qualité d'associé. La troisième chambre civile saisie du pourvoi a sollicité l’avis de la chambre commerciale sur cette question.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son avis du 1er décembre 2021, affirme que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu‑propriétaire. L’usufruitier a tout de même le droit de provoquer une délibération de l’assemblée générale des associés, en application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération a une incidence directe sur son droit de jouissance de ses propres parts sociales, en particulier il peut provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co‑gérants, si cette délibération est susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. La troisième chambre civile a repris cette solution pour rejeter le pourvoi des usufruitiers.
Alors qu’on aurait pu penser que la décision viendrait consolider la protection des nus‑propriétaires en leur reconnaissant, à eux seuls, la qualité d’associé, l'avis de la Chambre commerciale renforce plutôt la protection de l'usufruitier. En effet, la loi permet déjà d'octroyer l'intégralité du droit de vote aux usufruitiers en aménageant les statuts, même si l'on pourrait soutenir qu'il existe un risque d'altérer la substance de la chose, ce qui nuirait ainsi au nu‑propriétaire. Dans cet avis, la Chambre commerciale s'oppose certes à la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier, mais elle lui permet d'exercer certains droits qui lui sont réservés (ici, le droit de provoquer la délibération de l'associé), à condition que l'exercice de ce droit soit suffisant et affecte directement sa jouissance. C’est sur cette base que la troisième chambre civile48 va se prononcer.
VI. Droit international privé
A. CJUE, 9 septembre 2021, UM c/ HW, aff. C‑277/2049
En l’espèce, un homme de nationalité allemande avait consenti par contrat conclu (avant le 17 août 2015 date d’entrée en vigueur du règlement UE « Successions » du 4 juillet 2012) en faveur de son fils et de sa belle‑fille, une donation dont les effets devaient intervenir à son décès. La donation portait sur un terrain situé en Autriche et les constructions effectuées sur le terrain jusqu’au décès dudit donateur. Le donateur avait soumis l’exigibilité du transfert de propriété à plusieurs conditions, notamment que les gratifiés soient toujours vivants au jour de son décès et qu’ils demeurent mariés ; le fils donateur resterait seul bénéficiaire si cette condition venait à défaillir. Le contrat autorisait le ou les gratifié(s) à effectuer l’inscription du transfert de propriété dans le livre foncier autrichien sur présentation au tribunal autrichien d’un acte officiel du décès et des documents prouvant le respect des conditions susvisées au contrat. Le droit autrichien fut désigné comme loi applicable au contrat, et lors de sa conclusion toutes les parties avaient leur résidence habituelle en Allemagne. Les époux gratifiés divorcèrent. Le donateur décéda par la suite, le 13 mai 2018. Par conséquent, la succession fut ouverte postérieurement au 17 août 2015 (donc après l’entrée en vigueur du règlement « Successions »).
La procédure de succession fut d’ailleurs ouverte devant le juge allemand, lieu de la dernière résidence du de cujus. Dès lors, le règlement européen avait bien vocation à régir les règles attenantes au règlement de la succession. Le fils du défunt a demandé l’inscription sur le livre foncier de son droit de propriété en invoquant le fait qu’il était seul bénéficiaire du contrat au jour du décès de son père. Le tribunal de district autrichien a cependant rejeté la demande au motif que la loi applicable au contrat était la loi autrichienne et que les conditions de preuve n’étaient pas réunies, décision ensuite validée par le juge régional Autrichien.
L’enfant du de cujus a intenté un recours en révision devant la Cour suprême autrichienne qui a sursis à statuer et posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, relatives à la définition du pacte successoral au sens du règlement européen sur les successions de l’Union européenne ; et à l’interprétation de l’article 83 paragraphe 2 de ce même règlement.
La première question portait sur la qualification de pacte successoral. Dans son arrêt du 9 septembre 2021, la première chambre de la Cour de justice affirme que l’article 3, paragraphe 1, sous b) du règlement « successions » du 4 juillet 2012 définit le pacte successoral comme étant :
Un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre‑prestation, des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes parties au pacte.
Cette interprétation revêt un caractère autonome et uniforme selon la Cour.
Il en découle que :
Lorsqu’une disposition figurant dans un accord relatif à une succession consiste, à l’instar d’une libéralité, au sens dudit article 1er, paragraphe 2, sous g), en une donation, mais ne prend effet qu’au décès du de cujus, elle relève du champ d’application du même règlement.
Dès lors, l’exclusion du champ d’application du règlement opérée par son article 1er, paragraphe 2, g), qui place en dehors du champ d’application du règlement les droits et biens transférés autrement que par succession comme les libéralités, doit s’interpréter très limitativement50.
Par donation, le de cujus prévoyait le transfert futur de la propriété d’un immeuble lui appartenant, lors de son décès, à son fils et sa belle‑fille, d’autres parties au contrat de donation. Il a donc réalisé un pacte successoral au sens du règlement « successions ».
Quant à l’applicabilité de l’article 83 du règlement, subordonnant la validité du choix de la loi applicable à la succession au respect de diverses conditions au titre des dispositions transitoires, la Cour a déclaré que cet article ne régissait que la validité du choix de la loi applicable à l’ensemble de la succession.
En l’espèce, le de cujus avait décidé, avant le 17 août 2015, de soumettre à la loi autrichienne le pacte successoral portant sur l’un de ses biens, et non l’ensemble de sa succession. Ainsi, l’article 83, paragraphe 2, du règlement ne s’applique pas aux faits de l’espèce51.
B. Cass. 1re civ., 15 septembre 2021, FS‑B, n° 20‑19.64052
En l’espèce, un couple de nationalités tunisienne et française s’était marié en Tunisie le 4 août 1988. En 2010, l’époux tunisien a saisi les juridictions tunisiennes d’une demande de divorce. Or, avant même qu’une décision ne soit rendue par ces juridictions, l’épouse française a elle aussi saisi, le 11 avril 2011, le juge français, d’une requête en divorce. L’époux a soulevé l’exception de litispendance, les juridictions tunisiennes ayant déjà été saisies de la demande en divorce. L’ordonnance de non‑conciliation rendue le 20 juin 2011 par le juge français a écarté l’exception de litispendance. En 2012, les juridictions tunisiennes ont rendu un jugement de divorce qui a acquis force de chose jugée en 2019.
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 juin 2020 a fait droit à la demande de l’époux, estimant que le jugement de divorce tunisien devait être reconnu en France. En effet, pour la cour d’appel, l’ordonnance de non‑conciliation ne statue pas sur le fond du litige, mais fait partie de la phase de conciliation. La compétence pour écarter l’exception de litispendance appartient exclusivement au juge statuant sur le fond de la demande de divorce. L’épouse mécontente s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si l’exception de litispendance est possible lorsqu’elle est invoquée devant le juge français saisi d’une demande d’ordonnance de non‑conciliation, alors même que cette ordonnance ne statue pas sur le fond du litige. L’intérêt de cette question est de savoir quel est le juge compétent : le juge statuant en premier sur le fond du litige ou le juge qui rend en premier une décision (ici une ordonnance de non‑conciliation) ayant acquis force de chose jugée ?
La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. D’une part, sur le fondement de l’ancien article 1110 du Code de procédure civile, elle rappelle qu’en France l’exception de litispendance doit être invoquée avant le prononcé de l’ordonnance de non‑conciliation. D’autre part, au visa de l’article 15 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions juridiques du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, elle rappelle qu’une décision judiciaire tunisienne doit être reconnue en France s’il n’existe pas d’ores et déjà une décision française rendue sur le même objet, et ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, pour la Cour de cassation, l’exception de litispendance peut être valablement invoquée devant le juge français saisi d’une demande d’ordonnance de non‑conciliation. Par conséquent, le juge compétent pour l’intégralité du jugement de divorce est celui qui rend en premier un jugement ou une ordonnance valablement rendue et qui a acquis force de chose jugée. Son critère est bien la date d’acquisition de force de chose jugée du jugement et non la date du premier jugement sur le fond du litige.
La Cour de cassation avait déjà jugé en ce sens, dans un arrêt du 12 juillet 201753 relatif à cette affaire. Et malgré la résistance de la cour d’appel de Paris, après renvoi par la Cour de cassation, la Haute juridiction réaffirme sa décision. Elle s’appuie pour cela sur la jurisprudence antérieure relative à la possibilité pour le juge français qui rend une ordonnance de non‑conciliation de statuer sur la « régularité internationale d’un jugement étranger54 ». La solution est cependant critiquable en raison du caractère « provisoire » de l’ordonnance de non‑conciliation55 56.