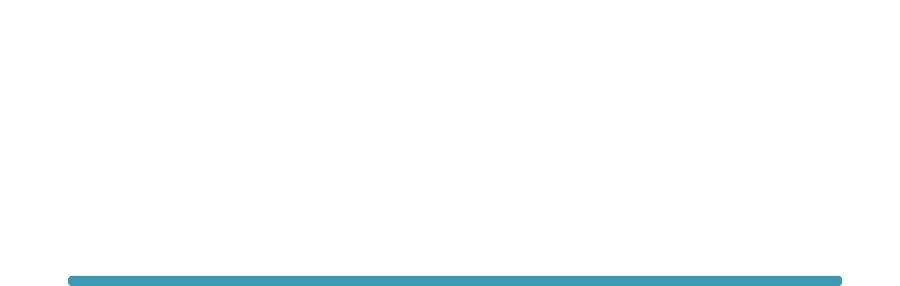I Droit immobilier
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-18.2131
Dans cette affaire, la Cour de cassation apporte des indications utiles sur la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur lié par un contrat de louage d’ouvrage. Cette garantie permet au maître de l’ouvrage d’être protégé pendant dix ans, à compter de la réception de l’ouvrage, contre les désordres non apparents qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En 2004, une société avait fait procéder à des travaux de rénovation et de réhabilitation d’un immeuble lui appartenant. Elle avait notamment conclu un contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage avec un professionnel. En 2009, des dysfonctionnements sont survenus. Le maître de l’ouvrage, après avoir recouru à une expertise, a décidé d’assigner le professionnel en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt rendu le 23 avril 2019, a déclaré l’action recevable. En conséquence, l’installateur s’est pourvu en cassation. Il soutenait tout d’abord que les travaux d’installation d’un système de climatisation ne constituent pas des travaux de construction d’un ouvrage ; ensuite que les juges du fond ne pouvaient pas retenir la réception tacite de l’ouvrage par le propriétaire, critère essentiel entre autres de la mise en œuvre de la garantie décennale.
Les juges du quai de l’Horloge ont rejeté le pourvoi, retenant, selon une interprétation extensive des conditions de l’article 1792 du Code civil, que non seulement les conditions relatives à l’ouvrage immobilier étaient réunies, mais qu’en plus l’étaient également celles afférentes au dommage. Le maître de l’ouvrage pouvait donc se prévaloir de la garantie décennale2.
En principe, des travaux légers ne sauraient relever de cette garantie, bien que le législateur n’ait pas pris soin de définir ce qu’est la construction d’un ouvrage immobilier. Cette action peut au contraire être valablement exercée en ce qui concerne des travaux conséquents de réhabilitation et de rénovation3. Et justement, l’installateur avait procédé à la pose d’un système de climatisation qui nécessitait d’agir de manière conséquente sur la structure du bien immobilier. Dès lors, les juges ont pu déclarer que cette installation relevait de la construction d’un ouvrage immobilier.
Par ailleurs, il faut souligner que le dommage doit rendre le bien impropre à sa destination pour permettre la mise en œuvre de la garantie décennale. Ainsi, il a été décidé qu’un dommage affectant un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage en portant atteinte à sa solidité remplissait cette condition4. En l’espèce, l’installation de la climatisation manquait de puissance. Par une interprétation large, les juges ont pu affirmer que le dommage de nature décennale était caractérisé.
En outre, pour pouvoir être exercée, l’action en garantie décennale nécessite une réception de l’ouvrage immobilier selon certaines conditions de l’article 1792-6 du Code civil. Cette réception se manifeste par une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La jurisprudence a notamment eu l’occasion de préciser que la réception tacite pouvait être caractérisée par le paiement total du prix, doublé par la prise de possession de l’ouvrage5.
Cet arrêt démontre à nouveau la souplesse dont la Cour de cassation fait preuve dans l’appréciation des conditions d’exercice de l’action en garantie décennale.
Louis Guichard et Rayan Lassalle
Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.1046
La Cour de cassation réaffirme et précise sa position sur l’articulation et le cumul de l’action en responsabilité pour dol et de l’action fondée sur la garantie des vices cachés. En l’espèce, l’acquéreur d’un immeuble avait découvert des désordres à l’issue des travaux de rénovation de son bien. Il avait assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il s’était cependant heurté à la prescription de l’article 1648 du Code civil. Il a alors exercé une action en réparation du préjudice sur le fondement de la réticence dolosive en application de l’ancien article 1382 (devenu article 1240) du Code civil.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas fait droit à sa demande, considérant que seule l’action en garantie des vices cachés pouvait être invoquée. L’acquéreur a formé un pourvoi en cassation conduisant la Cour de cassation à se demander si l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés interdit d’agir ensuite en réparation sur le fondement du dol.
Dans son arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation décide au double visa des articles 1240 et 1641 du Code civil que « l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat ». Cette solution vient confirmer une jurisprudence initiée en 2002. En effet, le 6 novembre 20027, la Cour de cassation avait déjà admis que « l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en nullité pour dol ». Il en a été de même dans ses arrêts rendus le 9 octobre 2013 et le 18 avril 20198.
L’enjeu de ces interrogations tient au court délai de prescription de deux ans de l’action en garantie des vices cachés auquel les parties essaient d’échapper. L’acquéreur peut-il invoquer la responsabilité délictuelle du vendeur pour obtenir réparation du préjudice subi dans le délai de prescription de droit commun ? La réponse est affirmative. En effet, ces deux actions ne poursuivent pas la même finalité et se placent à deux moments contractuels différents. L’une sanctionne une faute qui réside dans le silence portant sur une information majeure pour la conclusion du contrat, l’autre cible un vice rendant la chose impropre à son usage et empêchant son utilisation9. Le cumul est donc possible.
En l’espèce, l’information était déterminante du consentement de l’acquéreur, elle aurait ainsi dû lui être délivrée. Ainsi, en présence d’une réticence dolosive, le contractant victime peut demander la nullité du contrat et/ou une réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour sanctionner le comportement déloyal du cocontractant, même si par ailleurs le défaut relève de la garantie des vices cachés.
On se demande alors pourquoi la cour n’admet toujours pas le cumul entre les actions en garantie des vices cachés et en nullité pour erreur10. Peut-être admet-elle plus facilement de sanctionner la fraude dans le cadre du dol. Cela pourrait expliquer la solution dudit arrêt, mais ne justifie pas les décisions qui admettent le cumul avec l’action en nullité. Il est primordial de se demander si les faits peuvent relever à la fois du vice caché et de l’erreur. Dans l’affirmative, le cumul devrait être possible. La solution de la cour pourrait présager d’un changement de position de la troisième chambre civile sur le concours entre les actions en garantie des vices cachés et en nullité pour erreur puisque le dol suppose une erreur provoquée.
Hélène Daval et David Judaïque
II. Droit de la famille
Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-14.42111
Claire décède en laissant pour lui succéder son époux Antoine et leur fille unique Madeleine. Les époux s’étaient mariés en 1922 et avaient adopté par contrat de mariage le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils s’étaient consenti réciproquement dans le contrat de mariage une donation de biens à venir, portant sur l’usufruit de tous les biens qu’ils laisseraient au jour de leur décès. Parmi les biens appartenant à Claire figuraient des sommes d’argent, déposées sur des comptes bancaires, sur lesquelles Antoine a par conséquent bénéficié d’un quasi-usufruit. Madeleine est ensuite décédée en laissant Rudolf son époux et Antoine son père. Rappelons qu’avant la loi du 23 juin 2006 les ascendants étaient héritiers réservataires et primaient le conjoint survivant. C’est donc Antoine qui a seul hérité de sa fille. Il est décédé à son tour, en l’état d’un testament désignant en qualité de légataires universels Marie-Thérèse et son époux Louis. Rudolf, conjoint survivant de Madeleine, est lui aussi décédé, en laissant pour lui succéder comme unique héritière Anna sa sœur.
Anna a assigné Marie-Thérèse et Louis pour qu’ils lui restituent, au titre de la succession de Madeleine, les sommes qui correspondaient aux montants des comptes bancaires dont elle avait hérité en tant que nue-propriétaire. Louis est décédé, Anna a alors assigné en intervention forcée les deux filles du couple. Elle invoquait l’article 587 du Code civil. Le quasi-usufruit portant sur l’argent s’étant éteint au décès d’Antoine, une somme équivalente devait lui être restituée. La cour d’appel reconnaît l’existence d’une créance de restitution et, faisant ainsi droit à la demande d’Anna, elle condamne Marie-Thérèse et les deux filles de Louis à restituer les sommes d’argent de la succession de Madeleine.
Marie-Thérèse et ses deux filles forment un pourvoi selon le moyen que l’on ne peut hériter que des biens présents au jour du décès. Or, le droit du quasi-usufruitier s’était éteint à son décès, mais après le décès de la nue-propriétaire d’origine (Madeleine). Par conséquent, la créance de restitution n’avait pas pu intégrer la succession de la nue-propriétaire défunte puisque le quasi-usufruit subsistait encore au jour du décès de celle-ci. Ainsi, Anna ne pouvait pas prétendre à une créance de restitution dont elle n’avait pas pu hériter.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’héritier d’un quasi-usufruitier est tenu d’une créance de restitution à l’égard de l’héritier du nu-propriétaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle en effet qu’au décès de Claire, Antoine avait reçu le quasi-usufruit des liquidités, tandis que leur fille (Madeleine) en avait hérité en nue-propriété. Par principe, elle avait vocation à retrouver la pleine propriété des biens au décès de son père : elle bénéficiait d’ores et déjà d’une créance de restitution à faire valoir contre la future succession de son père12. Cependant, comme elle est décédée avant son père, cette créance de restitution s’est transmise à son propre héritier (Rudolf), puis à la sœur de celui-ci (Anna).
Ainsi, la demande d’Anna était légitime. Marie-Thérèse et ses filles, en qualité de légataires universels d’Antoine étaient tenues d’une créance de restitution13 qui s’est transmise aux héritiers de Rudolf envers la succession sur les comptes bancaires objet du quasi-usufruit14. La créance de restitution est inévitable, et le contraire aurait été choquant. Au premier abord, il peut paraître étrange qu’à travers une succession de décès l’héritage bénéficie à une personne éloignée au détriment de la famille du sang15. Toutefois la créance née est exigible, peu importe entre les mains de qui elle se trouve.
Lucie Lacan et Coralie Saubatjou
Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-15.35316
Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont décidé de mettre fin à leur union. Un jugement a prononcé leur divorce. Cependant, un différend est apparu quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ce cadre, un appel a été formé par l’ex-épouse qui réclamait le paiement d’une créance entre époux. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 20 février 2019, a accueilli sa demande. Les juges du fond condamnent l’ex-époux au paiement de la créance au titre du financement, par des deniers personnels à madame, de la construction du logement familial sur un terrain appartenant à monsieur.
Pour motiver sa décision, la cour d’appel reconnaît le caractère irréfragable de la présomption prévue par la clause insérée dans leur contrat de mariage ainsi rédigé : « les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ». Cependant, la présence de cette clause n’empêche pas un époux de rapporter la preuve qu’il a outrepassé ses facultés contributives sinon la clause suscitée est dépourvue d’effet.
L’ex-époux forme donc un pourvoi en cassation : il fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes de le condamner au paiement de la créance entre époux en mettant en avant la portée logique d’une présomption irréfragable ; selon lui, une telle présomption empêche les époux de rapporter la preuve d’une surcontribution ou d’une sous-contribution. De plus, un époux ne peut se prétendre créancier de l’autre au titre du remboursement d’un emprunt bancaire contracté pour la construction du logement familial, lequel participe de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : une présomption conventionnelle irréfragable de contribution aux charges du mariage, empêche-t-elle un époux de démontrer qu’il a contribué au-delà de son obligation de contribution ?
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans l’arrêt rendu le 18 novembre 2020, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 20 février 2019 au double visa des articles 214 et 1537 du Code civil. Elle estime que les juges du fonds ont violé les textes en retenant, après avoir apprécié souverainement que la présomption conventionnelle concernant la contribution aux charges du mariage prévue dans le contrat de mariage des époux était irréfragable, qu’un époux pouvait apporter la preuve contraire, en démontrant qu’il avait excessivement contribué aux charges du mariage au regard de ses facultés afin d’obtenir une créance entre époux. Selon elle, « un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution ».
Dans cette décision, la Cour de cassation réaffirme qu’une présomption conventionnelle de contribution aux charges du mariage peut être irréfragable17. En cas de divorce, les effets sont les suivants : il est impossible de prouver la surcontribution ou la sous-contribution de son ex-conjoint. Cette solution paraît pourtant contraire au caractère d’ordre public de l’article 214 du Code civil et à la prohibition des présomptions conventionnelles irréfragables de l’article 1356, alinéa 2 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit que les contrats sur la preuve « ne peuvent… établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ». Elle réaffirme également une décision rendue par la Cour de cassation le 1er avril 201518 dans laquelle la Haute Juridiction prévoit qu’un époux ne peut bénéficier d’une créance entre époux au titre du financement de l’acquisition du logement de la famille lorsque le contrat de mariage des époux séparés de biens stipule une présomption de contribution des époux aux charges du mariage.
Elena Guezennec et Marie Nicolaï
III. Droit des biens
Cass. 3e civ., 19 décembre 2019, n° 18-25.11319
Une servitude conventionnelle de passage avait été constituée au profit d’un fonds C appartenant à une indivision et grevant les fonds A et B appartenant à un indivisaire et à sa fille. Cette dernière avait édifié sur les parcelles grevées une maison d’habitation qui empiétait sur l’assiette de la servitude. Les bénéficiaires de la servitude l’ont assignée en démolition de la construction.
La Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir fait droit à la demande au motif que le passage avait été réduit de moitié et qu’un déplacement de l’assiette de la servitude ne saurait être imposé au propriétaire d’un fonds dominant autrement que dans les conditions de l’article 701 du Code civil, dernier alinéa. La Cour de cassation casse la décision au visa de l’article 8 de la Conv. EDH estimant que les juges du fond auraient dû rechercher si la démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile.
La Conv. EDH prévoit que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens »20. Traditionnellement, l’empiètement par une emprise irrégulière, aussi minime soit-elle, est sanctionné rigoureusement par la jurisprudence qui ordonne, sur le fondement de l’article 545 du Code civil, la démolition de l’immeuble – du moins de la partie qui empiète. Le droit de faire cesser l’empiètement est même considéré comme un droit discrétionnaire insusceptible d’abus. Cette solution ne laisse a priori aucune place à un contrôle de proportionnalité. « L’absolutisme de la propriété l’emporte en principe sur le relativisme des droits »21. La Cour de cassation a d’ailleurs refusé, par deux fois22, de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC sur l’interprétation de l’article 545.
Pourtant, alors même qu’en 2017, la Cour de cassation avait précisé que « l’auteur d’un empiètement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnait le droit au respect des biens de la victime de l’empiètement »23, en 2019 elle répond pour la première fois à l’injonction faite par la CEDH aux juges français d’« écarter le caractère général de la norme conduisant à la destruction de l’immeuble pour procéder à une mesure in concreto des droits fondamentaux de chacun »24. En effet, la CEDH dans son arrêt Winterstein avait reproché aux juges français de ne pas avoir effectué d’examen de proportionnalité.
Il ressort de l’arrêt commenté que l’auteur de l’empiètement, condamné à démolir sa maison d’habitation empiétant sur l’assiette d’une servitude de passage, peut invoquer l’article 8 de la Conv. EDH. Les juges semblent ici confronter deux droits pourtant bien distincts : le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour de cassation ici semble chercher un équilibre entre ces droits puisqu’elle accepte que le juge effectue un contrôle de proportionnalité dès lors que l’article 8 de la Conv. EDH est soulevé. Toutefois, il semble que cet article ne pourrait être invoqué que dans l’hypothèse où le bâtiment litigieux constituerait le domicile de l’auteur de l’empiètement. En dehors de cette seule hypothèse, la démolition semble rester la solution en vigueur. Ainsi, il serait désormais demandé aux juges du fond de se prononcer sur le conflit opposant le rétablissement de la servitude et l’atteinte au droit au respect de la vie privée25.
Certains auteurs26 soulignent le fait que cette décision est susceptible de porter atteinte au droit de propriété. Néanmoins, dans cet arrêt, il était question de l’empiètement d’une servitude de passage, et non pas directement du fonds d’autrui. La solution n’aurait sans doute pas été la même dans une pareille hypothèse et le juge aurait probablement prononcé la démolition, sans qu’un contrôle de proportionnalité n’ait à être opéré.
Cass. 3e civ., 24 septembre 2020, n° 19-19.17927
Dans cette affaire, les propriétaires de deux parcelles avaient vendu l’une d’elles à un couple en 1997. Dans l’acte de vente, une servitude de passage avait été constituée au profit du fonds des acquéreurs. La parcelle conservée par les vendeurs avait ensuite été divisée en deux nouvelles parcelles dont l’une avait fait l’objet, en 2010, d’une promesse de vente qui contenait également la constitution d’une servitude de passage sur la nouvelle parcelle cédée au profit de la nouvelle parcelle conservée. La promesse donna lieu à un jugement en exécution forcée de la vente. En 2012, la parcelle ayant fait l’objet de la vente en exécution forcée fut vendue aux acquéreurs de la première parcelle en 1997. À la suite de ces opérations, les acquéreurs ont assigné les propriétaires initiaux en démolition d’un muret construit sur l’assiette de la première servitude et en dénégation de la seconde servitude de passage contenue dans la promesse de vente. Déboutés en appel, les acquéreurs forment un pourvoi dans lequel ils font grief à l’arrêt d’indiquer que la première servitude est éteinte et que la seconde servitude leur est opposable.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation traite notamment de l’opposabilité d’une servitude conventionnelle portée personnellement à la connaissance de l’acquéreur. Cette question est primordiale puisque l’opposabilité aux tiers permet au propriétaire d’un fonds dominant de se prévaloir de la servitude afin d’obliger le propriétaire du fonds servant à respecter cette servitude.
Sur la question de l’opposabilité, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la haute juridiction réaffirme une solution qu’elle avait déjà formulée dans un arrêt précédent28 en indiquant « qu’une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d’acquisition en fait mention, ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition ». Elle estime donc que la servitude conventionnelle est opposable aux acquéreurs dès lors qu’ils en ont eu connaissance d’une manière ou d’une autre. La servitude était ici constituée dans une promesse de vente sous seing privé ayant donné lieu à un jugement en exécution forcée de la vente. Elle avait en outre été mentionnée dans le jugement et reprise dans le titre de propriété des acquéreurs. En l’espèce les juges du fonds avaient pu en conclure que le jugement reprenant la servitude avait été publié et que par conséquent la servitude avait bien été portée à la connaissance des acquéreurs. Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi et souligne que la servitude est bien opposable aux acquéreurs alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mention de publicité comme le prévoit le décret du 4 janvier 1955. Deux enseignements sont à tirer de cet arrêt29. L’acquéreur d’un fonds qui a connaissance de l’existence d’une servitude, même non publiée, doit s’y soumettre. En revanche, l’acquéreur d’un fonds ne peut subir la charge d’une servitude dont il n’a pas connaissance.
Sahra Bichet, Mehdi Fettah, Camille Lenfantin et Laurine Tribolet-Thibert
IV. Droit rural
Cass. 3e civ., 6 février 2020, n° 18-25.46030
En mars 2001, un bail rural avait été conclu entre un propriétaire et un couple d’exploitants. Il y était notamment prévu que les terres seraient cultivées « dans le cadre des contraintes agroenvironnementales et selon des méthodes agrobiologiques ». La loi du 5 janvier 2006 a créé le bail rural à clause environnementale (BRE), bail soumis au statut du fermage où des clauses respectueuses de l’environnement sont insérées avant cette date. Avant la loi de 2006, rien n’était expressément prévu quant à la possibilité d’insérer de telles clauses dans un bail. En l’espèce, le bail ayant été conclu avant 2006, il n’était pas soumis au régime du BRE.
En 2016, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de résiliation du bail pour non-respect de la clause contractuelle par les preneurs. Le tribunal a rejeté leur demande. À la suite de l’arrêt rendu en appel, les preneurs à bail se sont pourvus en cassation. Ils ont notamment fait valoir l’impossibilité d’introduire des clauses environnementales dans un bail puisque ce dernier avait été conclu avant l’instauration des baux dits « environnementaux ».
La Cour de cassation, contre toute attente, a rejeté le pourvoi en se fondant sur le principe de la liberté contractuelle et a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu « à bon droit, sans procéder à une application rétroactive des dispositions de l’ordonnance du 13 juillet 2006 […] que le preneur s’expose à la résiliation s’il emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée, de sorte qu’une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l’environnement n’est pas contraire à l’ordre public statutaire ». Comme le souligne Mme Bouchard31, il est étonnant qu’une décision qui semble si importante « ne soit pas promise aux honneurs du bulletin ».
D’une part, en effet, cet arrêt reconnaît la validité des clauses environnementales dans les baux ruraux contractés avant la loi de 2006. Jusqu’alors, tant la doctrine que la jurisprudence étaient divisées sur la possibilité pour le bailleur d’y insérer des clauses environnementales. La tendance doctrinale était donc de réputer cette clause nulle ou non écrite en vertu de l’article L. 415-12 du Code rural. Les syndicats d’exploitants avaient aussi mis un frein à cette possibilité en rapportant que « les clauses environnementales mettent en péril le statut du fermage » et que « tous les agriculteurs sont contre »32. Or la loi de 2006, modifiée par celle de 2014, a ouvert cette possibilité avec la création du BRE, mais uniquement dans des conditions précises. Chemin faisant, la Cour de cassation nous laisse penser rétroactivement que ces lois, au lieu de promouvoir le BRE, ont au contraire réduit son rayonnement par rapport à la nouvelle jurisprudence, en limitant son champ d’application à certaines situations (cf. C. rur. art. L. 411-27).
D’autre part, un autre apport ressort de l’arrêt sur le droit de résiliation judiciaire du bailleur énoncé à l’article L. 411-31 du Code rural. L’élargissement du caractère obligatoire de la clause environnementale au profit de tous les bailleurs a permis d’étendre le champ d’application de la résiliation judiciaire aux agissements compromettant la bonne exploitation du fonds. Cette décision permet de mieux comprendre l’élan que souhaite donner le législateur à la notion d’agissement de nature à compromettre la bonne exploitation des biens.
Louise Fournier et Marie Rodrigue
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-20.85633
Le statut du fermage, défini à l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, a pour vocation d’assurer la pérennité des droits du fermier. Ce régime d’ordre public connait cependant plusieurs exceptions. L’une d’entre elles, importante en pratique, vise la situation où un propriétaire exploitant souhaite exercer son activité dans un cadre sociétaire. Afin d’éviter l’application du statut du fermage, la loi prévoit que la convention de jouissance conclue entre le propriétaire et la société se trouve exclue de statut du fermage, à la condition toutefois que le propriétaire participe directement et effectivement aux travaux au sein de la société (C. rur., art. L. 411-2, in fine). Dès que cette condition n’est plus respectée, le statut du fermage retrouve son emprise. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 septembre 2020 illustre à nouveau la règle.
En l’espèce, conformément à l’article L. 411-2, in fine, le 3 juin 2010, un propriétaire avait mis à disposition des terres agricoles au profit d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA) au sein de laquelle il exploitait ces terres avec d’autres associés. En janvier 2011, il cesse son activité et reste dans la société en tant qu’associé non exploitant. La SCEA revendique l’application du statut du fermage devant les juridictions, affirmant qu’il existait un bail rural verbal entre elle et le propriétaire.
Les conditions de la reconnaissance de l’existence d’un tel bail étaient-elles réunies ? La Cour de cassation répond par l’affirmative en considérant que la condition de fond permettant l’exclusion du statut du fermage n’était plus remplie. En effet, dès le départ à la retraite de l’auteur de la mise à disposition, la condition d’exploitation par l’associé apporteur n’était plus réalisée.
La Cour de cassation rappelle très clairement que « l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage ». La Cour de cassation s’appuyant sur les motifs de la cour d’appel, ajoute en outre, d’une part, que le propriétaire n’avait pas fait état de son intention de mettre fin à la mise à disposition concomitamment à son départ à la retraite34 et, d’autre part, qu’il avait continué à percevoir le prix convenu dans la convention en contrepartie de l’exploitation des terres. Par conséquent, le bail rural devait être reconnu au profit de la SCEA.
Un ultime argument a été soutenu par le demandeur pour s’assurer de l’exclusion du statut, consistant à dire que le délai de prescription, pour se prévaloir d’une requalification de la convention de mise à disposition en bail rural verbal, d’une durée de cinq ans était éteint au jour où les parties se sont présentées devant le juge. La Cour de cassation, soucieuse de respecter la lettre du texte répond à ce dernier argument en indiquant qu’il ne s’agit pas là d’une action en requalification au sens de l’article 2224 du Code civil, mais bien d’une action visant à reconnaître l’existence d’une nouvelle relation contractuelle autonome des relations en cours35, dépourvues, à défaut de participation du propriétaire, de tout encadrement juridique. Le propriétaire aurait vraisemblablement dû anticiper les conséquences de son départ à la retraite et prévoir avec l’aide d’un conseil avisé, la meilleure manière de sortir librement de cette relation contractuelle36.
Frédérique Domanska et Mona Revault
V. Droit des sociétés
Cass. 1re civ., 2 septembre 2020, n° 19-14.60437
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 septembre 2020, présente les conséquences de la qualité d’hériter non associé sur la distribution des dividendes de la société.
Deux époux mariés sous le régime de la communauté légale ainsi que les deux frères de Monsieur avaient constitué une SCI. Le mari décède en ayant réparti par testament les parts sociales entre ses frères et sa femme. Cette dernière décède à son tour et laisse pour lui succéder son neveu, non associé, qui ne pourra intégrer la société qu’en obtenant l’agrément des autres associés. Par un testament olographe, elle désigne les frères de son défunt mari légataires particuliers de ses parts dans la SCI.
Le neveu héritier non agréé assigne les deux associés de la SCI pour obtenir le paiement des dividendes versés entre le décès de sa tante et la délivrance du legs des parts sociales de la SCI aux frères du défunt mari. La cour d’appel de Versailles rejette sa demande. Le neveu forme alors un pourvoi en cassation.
La question était donc de savoir si l’héritier d’un associé défunt d’une SCI peut prétendre au versement des dividendes au titre de la période située entre le décès de l’associé et la délivrance du legs des parts sociales.
La Cour de cassation affirme que l’héritier qui n’est pas associé n’a droit qu’à la valeur des parts sociales et par conséquent n’a pas droit aux dividendes.
L’arrêt illustre la distinction entre la qualité d’associé et la valeur des parts sociales, c’est-à-dire entre le titre et la finance, bien connue en droit des régimes matrimoniaux. La Cour de cassation avait tranché pareillement à propos d’un GAEC38 dans l’arrêt Gelada de 199139, puis en 2004, où elle avait affirmé qu’en l’absence de la qualité d’associé, les dividendes ne peuvent être perçus par l’héritier. L’arrêt de 2020 est important puisqu’il reconnaît cette distinction pour les sociétés civiles, en soulignant que seuls les associés ont vocation à percevoir les dividendes distribués après le décès. La solution aurait été toute autre si les dividendes avaient été distribués avant le décès de l’associé, puisque cela aurait créé une créance de dividende appartenant à l’actif successoral. Par conséquent, l’héritier, même non associé, aurait pu bénéficier de ces dividendes40.
En l’espèce, la Cour de cassation ne conteste pas la nature de dividendes des loyers. Par principe, l’article 1014 du Code civil prévoit que les fruits doivent revenir à l’héritier, et puisque la jurisprudence reconnaît la qualification de fruits pour les dividendes, l’héritier devrait recevoir ces sommes41. Cependant, il faut confronter l’article 1014 à l’article 1870-1 du Code civil qui prévoit que l’héritier, non associé, ne peut recevoir de dividendes, car seuls les associés le peuvent. Par conséquent, le neveu héritier non associé ne peut percevoir de dividendes. La solution serait que ce dernier reçoive l’accord unanime des autres associés, conformément à la clause d’agrément prévue, afin qu’il devienne associé.
En revanche, la Cour de cassation refuse la qualification de dividende au résultat de la cession d’actifs, que le neveu estimait être des fruits lui revenant en tant qu’associé, afin de retenir la qualification de produit. La décision aurait été différente si la cession d’immeubles faisait partie de l’objet social de la SCI puisqu’il s’agirait alors d’un fruit42. Cependant, que la qualification retenue soit celle de produit ou de fruit, les bénéfices ne peuvent revenir au neveu héritier en raison de sa qualité de non associé.
Cass. com. 18 novembre 2020 (n° 18-21.797)43
Dans cet arrêt rendu le 18 novembre 2020, la Cour de cassation s’est prononcée sur la revendication de la qualité d’associé par l’époux commun en biens.
En l’espèce, des époux mariés initialement sans contrat de mariage ont adopté en cours de mariage le régime de la communauté universelle. Auparavant, les époux avaient constitué une société en nom collectif dont les parts étaient détenues pour moitié par le mari et l’autre moitié par un tiers associé.
L’épouse a d’abord notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception sa volonté d’être personnellement associée de ladite société à hauteur de la moitié des parts détenues par son époux, sur le fondement de l’article 1832-2 du Code civil.
Elle a ensuite assigné le second associé de la société ainsi que la société elle-même afin que la qualité d’associée lui soit reconnue.
Les juges du fond ayant rejeté la demande de l’épouse, un pourvoi en cassation a été formé par cette dernière. Elle invoque plusieurs moyens dont seul le dernier a retenu l’attention des juges. Elle soutenait que l’accord unanime des associés, prévu par L. 221-13 du Code de commerce et nécessaire pour la cession de parts sociales, ne peut tenir en échec l’article 1832-2 du Code civil selon lequel, en l’absence de clause d’agrément, la reconnaissance de la qualité d’associé a lieu de plein droit au profit du conjoint qui a l’intention d’être personnellement associé.
La haute juridiction apporte une réponse claire à la question posée : « il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du Code civil et L. 221-13 du Code de commerce que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». La Cour souligne que l’associé n’avait jamais été informé de la revendication de l’épouse et n’avait ainsi pas pu convoquer d’assemblée générale portant sur cette demande. Ainsi, la lettre officielle du conseil de l’associé adressé au conseil de l’épouse ne pouvait être considérée comme un consentement satisfaisant aux exigences de l’article L. 221-13. La qualité d’associé ne pouvait donc être accordée à l’épouse.
On peut s’étonner de cette solution. En effet, la revendication de la qualité d’associé ne constitue pas une cession au sens de l’article L. 221-13 du Code de commerce, l’accord unanime des associés ne devrait donc pas être exigé. Néanmoins, la Cour vient élargir le champ d’application du texte afin de protéger les associés en nom collectif qui répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales, l’objectif étant de prévenir le risque qui résulte de l’entrée d’un nouvel associé44. Malgré tout, le fait de reconnaître la qualité d’associé à l’épouse n’aurait pas changé grand-chose puisque cette dernière était mariée sous le régime de la communauté universelle. Ainsi, tous les biens du couple pouvaient être offerts au droit de gage des créanciers sociaux, comme le rappelle M. Mortier45. La protection reste donc tout de même limitée.
Par ailleurs, la Cour de cassation s’attarde sur l’idée du consentement unanime des associés au sens de l’article L. 221-13 du Code de commerce, puisqu’en l’espèce il n’y a que deux associés dans la société. Il en résulte que le second associé de la société doit donner son accord également, mais il s’agirait alors d’un consentement unanime « esseulé »46. La décision serait en quelque sorte prise par un associé unique.
Chloé Donard, Mathilde Richet et Maxime Ségura
VI. Droit international privé
CJUE, 16 juillet 2020, C-80/1947
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt important du 16 juillet 2020 s’est prononcée sur l’interprétation du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
Une citoyenne lituanienne avait épousé un ressortissant allemand et s’était installée en Allemagne où elle est décédée quelques années plus tard. Devant un notaire lituanien, elle avait désigné son fils, lituanien également, comme son héritier universel. Elle était propriétaire d’un appartement en Lituanie. À son décès son fils s’est adressé à un autre notaire lituanien, en vue du règlement de la succession et afin d’obtenir un certificat d’hérédité. Ce notaire refusa d’établir le certificat, au motif que la défunte avait son domicile en Allemagne. L’héritier a alors engagé une action en justice pour contester la décision du notaire. L’affaire étant parvenue jusqu’en cassation devant la Cour suprême de Lituanie, celle-ci a sursis à statuer afin de poser à la CJUE plusieurs questions préjudicielles sur l’interprétation du règlement n° 650/2012 précité, laquelle apporte plusieurs précisions intéressantes.
La première question posée à la CJUE était de savoir à quelles conditions une succession peut être considérée comme ayant une incidence transfrontière48 et si la résidence habituelle doit être fixée uniquement dans un État membre pour répondre aux conditions du règlement n° 650/2012.
La CJUE répond d’abord que la dernière résidence habituelle du défunt doit être fixée dans un seul État membre, celui qui est saisi de la succession, pour que le règlement n° 650/2012 soit applicable. D’après la Cour, ensuite, la succession de l’espèce a une incidence transfrontière et relève du champ d’application du règlement, car la femme de nationalité lituanienne résidante allemande n’avait pas rompu ses liens avec la Lituanie dès lors que ses successibles et les biens composant sa succession se trouvaient dans ce pays différent de celui de sa résidence49.
La deuxième question était de savoir dans quelles conditions les notaires peuvent être qualifiés de « juridictions » et les certificats d’hérédité de « décisions » au sens du règlement n° 650/2012.
Il appartient à la juridiction de renvoi, ici la Cour suprême lituanienne qui statuera au regard des précisions apportées par la CJUE, de qualifier la situation. La CJUE donne des indications utiles. D’abord, pour qu’ils puissent être qualifiés de « juridiction », il faut que les notaires statuent sur des questions controversées, des faits contestés ou établissent des faits non clairs. Ils peuvent être qualifiés comme tels lorsqu’ils « agissent par délégation ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire ».
Ensuite, si la juridiction de renvoi qualifie les notaires de « juridiction », le certificat national d’hérédité a la qualification de « décision ». Le notaire doit alors appliquer les règles de compétence du règlement n° 650/2012 qui désignent en principe l’autorité de la résidence habituelle du défunt, mais peuvent dans certaines hypothèses, comme l’indique la Cour, prévoir la compétence d’autres autorités en vertu des articles 5 et 7 du règlement. La décision doit alors circuler conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions.
Mais, si la juridiction de renvoi ne qualifie pas les notaires de « juridiction », ces derniers peuvent, sans appliquer les règles de compétence du règlement, délivrer des certificats nationaux d’hérédité qui seront alors qualifiés non pas de « décisions », mais d’« actes authentiques » au sens du règlement et exécutoires dans tous les États membres.
Solène Nolot et Justine Ribeiro
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-11.57350
La question du mariage par procuration en matière internationale n’est pas nouvelle. Dans un arrêt du 15 juillet 1999, la Cour de cassation avait déjà précisé que la présence des époux est une condition de fond du mariage51 régie par leur loi personnelle. L’arrêt du 18 mars 2020 en est une parfaite illustration.
En l’espèce, un Français avait épousé une Marocaine pourtant absente à la cérémonie. Celle-ci avait mandaté son père pour conclure le mariage par procuration, conformément au droit marocain alors applicable. Ce mariage, célébré au Maroc en 2002, avait été transcrit sur les registres de l’état civil français. Une fois la famille rentrée en France, l’épouse a entamé en 2015 une procédure de divorce pour faute contre son mari, qui a rétorqué par une demande en annulation du mariage.
La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 décembre 2018, décide de ne pas accéder à la demande de l’époux. Ce dernier forme un pourvoi en cassation en invoquant le fait que son épouse n’ayant pas été présente physiquement au jour du mariage, son absence contrevenait à l’ordre public international français.
La haute juridiction devait donc répondre à la question de savoir si un mariage célébré à l’étranger sans la présence de l’épouse est contraire à notre ordre public international.
Par cette décision du 18 mars 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’époux sur le fondement des articles 4 et 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, et des articles 146 et 146-1 du Code civil. Selon ces textes le mariage est valable, dès lors que les époux donnent leur consentement exprès. Le consentement est régi par la loi nationale de chaque époux. De plus, la présence des époux est une condition de fond du mariage52. Toutefois, l’époux invoquait une contrariété à l’ordre public international français. Or le Code civil n’impose qu’aux ressortissants français d’être présents à leur mariage. L’épouse étant marocaine, cette exigence ne s’appliquait pas à son égard. L’exception d’ordre public ne pouvait donc pas jouer, car il n’y avait aucune contrariété à l’ordre public international français.
Si ce mariage par procuration était valable au regard du droit marocain, sa conformité aux exigences de notre ordre public international français posait un problème. L’exception d’ordre public est un mécanisme qui permet d’écarter la loi étrangère normalement applicable à une situation dont le contenu est considéré comme inadéquat au regard de nos principes fondamentaux. La mise en œuvre de ce mécanisme peut être moins rigoureuse lorsque la situation est constituée à l’étranger, afin de lui laisser produire ses effets. L’ordre public international est ainsi atténué. Dans cette affaire, l’appréciation des juges s’est faite in concreto, sans s’arrêter à une application stricte des textes. Les juges relèvent que ce mariage durait depuis plus de dix ans53, et surtout, que l’époux ne contestait pas la réalité du consentement de sa femme. Ces éléments, complétés par la validité sur le fond du mariage par procuration, ont amené les juges à se prononcer en faveur d’un effet atténué de l’ordre public international français. Reconnaître ce mariage permettait d’entamer valablement une procédure de divorce pour l’épouse.
On peut penser que la solution aurait été différente si le mariage avait été célébré peu de temps avant la demande en annulation, ou s’il avait été célébré sur le sol français entre un ressortissant français et un étranger dont la loi nationale autorise le mariage par procuration.
Sabine Napo et Juliette Sauvain