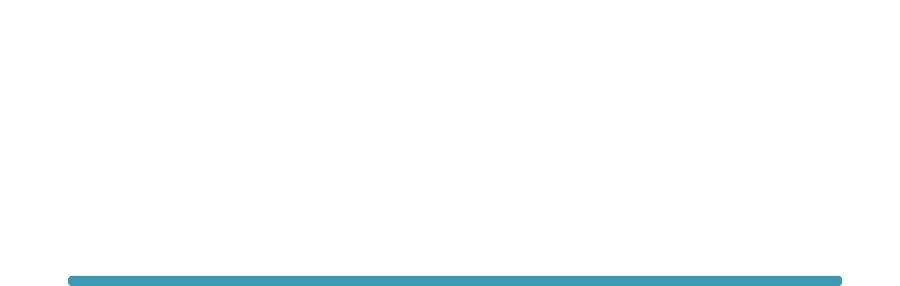La formation de la libéralité
A. La capacité du disposant
Cass. 1re civ., 16 septembre 2020, n° 19-15.818
L’incapacité de recevoir de l’infirmière légataire
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se trouve confrontée à la nécessité de préciser les contours de l’incapacité de certaines professions. Dans une décision rendue par la première chambre civile le 16 septembre 2020, la Cour de cassation a confirmé les limites des legs consentis par des patients à des aides-soignants.
En l’espèce, la de cujus avait laissé pour lui succéder son frère, en l’état d’un testament olographe sur lequel était inscrit un legs à une infirmière libérale.
La défunte avait rédigé ce testament peu de temps après qu’elle eut subi une batterie d’examens médicaux ayant permis de déceler un syndrome incurable. En effet, ce n’est que quelque temps après la rédaction du testament que le diagnostic a pu être établi.
Après le décès de la de cujus, le legs fut délivré mais le frère de la défunte, en se basant sur l’article 909 du Code civil, avait assigné le légataire en restitution de l’ensemble des biens légués et en paiement des intérêts aux taux légal depuis le jour de la délivrance.
Aux termes d’un arrêt du 15 février 2019, la cour d’appel de Versailles a affirmé que les conditions de l’article 909 du Code civil n’étaient pas réunies étant donné que le testament avait été rédigé avant que la maladie eût été diagnostiquée.
Le frère a ainsi formé un pourvoi en cassation, en reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article 909 du Code civil en rejetant la demande malgré le constat que la défunte était déjà malade au jour de la rédaction du testament.
Par une décision du 16 septembre 2020, la Cour de cassation s’est montrée catégorique en censurant l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 909 du Code civil. Elle affirme que l’incapacité de recevoir est conditionnée à l’existence au jour de la rédaction du testament de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic. Ainsi, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir ajouté une condition à la loi en exigeant, pour pouvoir appliquer l’article 909 du Code civil, que le testament soit rédigé après que le diagnostic a été posé. Cette décision se justifie en raison du fait que la défunte avait déjà pu prendre connaissance d’un certain nombre d’examens médicaux lui permettant d’anticiper le diagnostic à venir.
La Cour de cassation avait déjà dû étendre les conditions de l’article afin d’assurer une plus grande efficacité. En effet, elle avait étendu son application en reconnaissant l’incapacité de recevoir à titre gratuit au contrat d’assurance-vie dans une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 juillet 2003 (Civ. 1re, 1er juillet 2003, n° 00-15.786, D. 2003.2404). L’intérêt visé par cette interprétation est d’éviter les captations étant donné que les personnels soignants connaissent l’état des malades qu’ils soignent. En l’espèce, la de cujus et l’aide-soignante étaient unies par un lien affectif, ce qui a un impact dans les libéralités. En effet, dans une décision rendue par la première chambre civile le 15 janvier 2014, la Cour de cassation avait reconnu une différence entre la prohibition du legs consenti au médecin, et l’autorisation du legs consenti en faveur de « l’ami médecin ». (Civ. 1re, 15 janvier 2014, n° 1 222 950, Bull. civ, I, n° 2). En l’espèce, le rapprochement des dates entre le diagnostic et la libéralité semblait suspect, ce qui a permis d’écarter le lien affectif entre les deux parties.
Pour conclure, la Cour de cassation affirme que pour interdire le legs, il suffit que le testament ait été rédigé au cours de la maladie ayant provoqué le décès et que le légataire ait prodigué des soins au cours de cette maladie, peu important la date de son diagnostic. Cet arrêt de principe consacre donc une interprétation stricte de l’article 909 du Code civil.
Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-12.351
En l’espèce, les enfants du défunt issus d’une première union, ont assigné devant le tribunal de première instance de Nouméa la veuve de leur père, qu’il avait épousée en secondes noces, aux fins de voir prononcer le rapport à la succession des donations consenties par leur père au profit de leur belle-mère, de voir juger un recel successoral et la voir priver de ses droits sur la succession.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le tribunal a fait droit à la demande de rapport successoral de deux immeubles de la succession. Dès lors, les demandeurs ont été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire, entre les mains de toute personne pouvant détenir des sommes, deniers ou valeurs au profit ou pour le compte de la défenderesse, pour sûreté et conservation d’une certaine somme.
Ladite ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Nouméa et a ainsi autorisé les enfants du défunt à pratiquer une saisie conservatoire à l’égard de leur belle-mère. La cour a également débouté la veuve de ses demandes tendant à l’annulation de la procédure de saisie pratiquée entre les mains des établissements bancaires, à la mainlevée de la saisie et à la condamnation des enfants de l’époux défunt à lui verser des dommages-intérêts pour abus de procédure de saisie. La veuve s’est alors pourvue en cassation.
La veuve expose que grâce à la souscription d’une donation entre époux de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession du premier époux décédé, elle disposait, de fait, de l’usufruit sur l’intégralité de l’actif successoral de son époux.
Dès lors, elle estime que le rapport de donations à la succession ne pouvait avoir d’incidence sur l’exercice de ses droits d’usufruitière, que les enfants du défunt ne disposaient donc que de droits théoriques en nue-propriété et que, quelle que soit la consistance de l’actif net successoral, l’appréhension des fonds compris dans l’usufruit portait atteinte à ses droits. Elle précise également que le recouvrement de la créance ne pouvait intervenir qu’à son décès, lors de l’extinction de l’usufruit, et que la saisie pratiquée, en ce qu’elle emporte dépossession des fonds dont elle a le droit de jouir, constitue une violation de ses droits d’usufruitier.
Par une décision du 10 décembre 2020, la Haute Juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa. Elle précise que compte tenu du droit d’usufruit portant sur l’universalité des biens composant la succession appartenant à la veuve, « l’exercice de ce droit ne saurait dépendre de la décision sur le rapport des donations et que, quelle que soit la consistance de l’actif net successoral, l’appréhension des biens en pleine propriété ne pourrait intervenir qu’à son décès, par l’extinction de l’usufruit ».
Cass. 1re civ., 18 décembre 2020, n° 20-40.060
La Cour de cassation a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’incapacité de recevoir à titre gratuit des auxiliaires de vie à domicile présentait « un caractère sérieux en ce que, ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d’inaptitude du disposant, l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles pourrait être de nature à porter atteinte aux articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ».
En l’espèce, un défunt a, au terme de son testament olographe, désigné ses cousins comme légataires universels. L’acte contient également un legs à titre particulier d’un appartement et de son contenu au bénéfice de son employée de maison. Les légataires universels ont assigné la légataire à titre particulier en nullité de son legs devant le tribunal judiciaire de Toulouse. La défenderesse estime que l’article L. 116‑4 du Code de l’action sociale et des familles, disposition au fondement de la demande, est contraire aux articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Le tribunal judiciaire de Toulouse avait transmis à la Haute Juridiction une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles. La demande était formulée dans les termes suivants : « l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles méconnaît-il les droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »
Par une décision intervenue le 18 décembre 2020, la Haute Cour précise dans un premier temps que l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles « est applicable au litige, relatif à la nullité d’une disposition testamentaire consentie à une personne qui, en sa qualité d’employée de maison de la testatrice, est frappée par une incapacité de recevoir ». En effet, cet article prévoit l’incapacité de certaines personnes de recevoir des donations ou legs provenant de personnes qu’ils prennent en charge.
La Cour ajoute que cette disposition n’a pas déjà fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, et n’a, de ce fait, pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision de cette juridiction.
Enfin, la Haute Cour estime que la question prioritaire de constitutionnalité adressée par l’employée de maison du défunt « présente un caractère sérieux en ce que, ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d’inaptitude du disposant, l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles pourrait être de nature à porter atteinte aux articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 28 août 1789 ». En effet, cet article prévoit une atteinte à la liberté de disposer du futur défunt en faveur de la personne de son choix. Cette atteinte justifiait donc, selon les Juges du quai de l’Horloge, un renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
En conséquence, la Cour de cassation renvoie la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cet arrêt rejoint et précède donc la décision rendue par les Sages le 12 mars 2021, n° 2020-888 selon laquelle Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 166-4 du Code de l’action sociale et des familles portant interdiction générale et absolue, pour le personnel des services d’aides et d’accompagnement à domicile, de profiter des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires consenties par les personnes accompagnées.
Cass. 1re civ., 2 septembre 2020, n° 19-14.604
Refus de versement des dividendes à l’héritier non associé
L’héritier d’un associé de SCI, qui n’est pas lui-même agréé comme associé, ne peut prétendre aux dividendes versés entre le décès et la délivrance du legs au légataire institué par testament.
Dans cette décision rendue par la première chambre civile le 2 septembre 2020, la Cour de cassation a clarifié la situation de l’héritier de parts sociales non associé d’une société civile immobilière.
L’héritier n’a droit qu’à la valeur des parts mais n’a aucun droit sur les dividendes.
En l’espèce, une personne avait légué ses parts d’une SCI à un tiers. À son décès, son unique héritier sollicita le versement de dividendes distribués par la société entre la date du décès et celle à laquelle les parts avaient été attribuées au légataire. Parallèlement, les deux frères associés ont assigné le neveu héritier testamentaire afin d’obtenir la délivrance du legs des parts sociales conformément à l’alinéa 2 de l’article 1014 du Code civil. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 février 2019 (CA Versailles, 22 février 2019, n° 16/00692) qu’une clause statutaire prévoyait que les héritiers ou légataires ne deviendraient associés qu’à la suite d’un agrément.
La cour d’appel de Versailles rejette la demande de l’héritier légal d’appréhension des dividendes, car l’héritier n’ayant pas été agréé, il ne saurait percevoir le dividende attribué entre le décès et la délivrance du legs. Ce dernier forme ainsi un pourvoi en cassation afin de faire qualifier de dividende la distribution du prix de vente des actifs sociaux.
Par une décision du 2 septembre 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur les articles 1870 et 1870-1 du Code civil et approuve donc la décision de la cour d’appel. En effet, elle rappelle les dispositions de l’article 1870 alinéa 1 du Code civil selon lesquelles la société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. De plus, la Cour de cassation invoque également l’article 1870-1 du Code civil qui prévoit que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur.
Ainsi, seule la qualité d’associé permet de participer aux résultats, la seule qualité d’héritier n’étant pas suffisante. Le troisième moyen se doit également d’être remarqué. En effet, entre le décès et l’agrément, la société a cédé deux actifs sociaux et, par une décision en assemblée générale, il a été voté une répartition du prix de vente au profit des associés à hauteur de leurs droits dans le capital social. Le demandeur sollicitait donc, en sa qualité d’héritier, son droit aux dividendes. Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur conformément à l’article 1870-1 du Code civil. De plus, l’héritier non associé d’une société civile ne peut prétendre à aucune fraction des dividendes sociaux distribués après le décès.
La Cour de cassation rejette le moyen au motif que le prix de cession d’un actif est un produit, peu importe qu’il soit réparti par la suite.
Le fait que l’assemblée générale ait décidé la répartition du prix de cession de ces éléments d’actifs de la société n’est pas de nature à conférer aux sommes distribuées la nature de dividende. Ainsi, l’héritier évincé par l’exécution du testament ne peut prétendre ni aux dividendes ni aux produits de la vente des actifs sociétaires. Toutefois, le neveu était en droit d’agir en fixation d’une indemnité de réduction à l’encontre des légataires particuliers étant un ayant droit de l’épouse qui est réservataire dans la succession de son mari, et ce conformément à l’article 924 du Code civil.
Cette solution s’inscrit dans la distinction classique entre le titre et la finance. Cette décision peut sembler insatisfaisante si la de cujus souhaitait que son héritier prenne part à la société en devenant associé. De plus, cette solution peut être critiquée, car elle continue de faire prévaloir le droit des sociétés sur le droit des successions en méconnaissant la règle posée par l’article 1014 du Code civil.
Conseil constitutionnel, QPC, 12 mars 2021, n° 2020-888
L’interdiction de disposer de ses biens en faveur de prestataires de services est déclarée inconstitutionnelle.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel a bouleversé l’état du droit en la matière. En effet, les articles 912 et suivants du Code civil permettent à tout individu, sous réserve de sa capacité, de transmettre librement ses biens à toute personne de son choix, de son vivant, par donation ou, après sa mort, grâce à un testament, sous réserve ne pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires.
En l’espèce, une femme est décédée sans laisser d’héritier réservataire. Toutefois, elle avait consenti un legs à titre particulier de son appartement et des meubles meublants à ses 6 cousins légataires universels et à son employée de maison. Les cousins légataires universels entendent contester ce legs consenti à l’employée de maison.
Les cousins ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande en annulation du legs. La défenderesse estime que l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, disposition au fondement de la demande, est contraire aux articles 2, 4 et 17 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
La question posée au juge constitutionnel était de savoir si l’interdiction contenue dans le Code de l’action sociale et des familles porte ou non atteinte au droit de propriété du disposant.
Le tribunal judiciaire soumet la question à la Première chambre civile de la Cour de cassation qui la transmet au Conseil constitutionnel par un arrêt du 18 décembre 2020.
Saisi par la Cour de cassation le 18 décembre 2020, le Conseil constitutionnel rappelle que le droit de propriété des personnes privées est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prévoient que les limitations doivent être justifiées par l’intérêt général et il ne doit pas en résulter d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
La question prioritaire de constitutionnalité a donné lieu ladite décision du Conseil constitutionnel susmentionnée le 12 mars 2021 qui affirme, après avoir effectué un contrôle de proportionnalité entre l’intérêt général et l’atteinte portée à la liberté de disposer, que les dispositions qui limitent la capacité de toutes les personnes âgées ou handicapées bénéficiant d’une aide à domicile à disposer librement de leur patrimoine constituent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Par sa décision, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 166 ‑4 du Code de l’action sociale et des familles portant interdiction générale et absolue, pour le personnel des services d’aides et d’accompagnement à domicile, de profiter des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires consenties par les personnes accompagnées, et ce au nom de la protection du droit de propriété. Pour renforcer ces propos, le Conseil constitutionnel ajoute qu’il n’est pas possible de rapporter la preuve « de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste ».
Cette décision est justifiée par la protection constitutionnelle dont est doté le droit de propriété qui figure aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le droit de disposer de ses biens, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, est consubstantiel à l’exercice du droit de propriété, comme l’a affirmé auparavant le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 29 juillet 1998 (Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403). Ainsi, le Conseil constitutionnel affirme que le législateur peut apporter des limitations au droit de propriété « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ».
Cependant, cette décision peut être critiquée aux vues des faiblesses auxquelles peuvent être confrontées les personnes vulnérables, qui sous réserve de la protection constitutionnelle du droit de propriété, peuvent subir des captations d’héritages.
Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-17.350
Des lacunes dans l’irrecevabilité.
La contestation lors du partage et de la liquidation de la succession sur le fondement de l’article 837 du Code civil est irrecevable (en sa version antérieure à 20071).
En l’espèce, un indivisaire de la succession conteste un montant relatif à la succession, les honoraires notariés, devant le tribunal de grande instance de Vienne le 3 août 2017. Par ailleurs, l’article 837 du Code civil disposait2 :
Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
Or, il n’avait pas été établi de procès-verbal recensant la contestation visée. Par la suite, la cour d’appel de Grenoble, le 22 janvier 2019, déclare irrecevable, sur la base de l’article 837 du Code civil, toute contestation relative à l’honoraire transactionnel faute de procès-verbal établi par notaire.
L’indivisaire forme un pourvoi en cassation au moyen que la disposition susvisée ne porte pas de caractère d’ordre public et donc ne peut être un motif d’irrecevabilité de sa demande en contestation des honoraires notariés.
La première chambre civile est saisie sur le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 837. La Cour adopte une approche novatrice en considérant que l’intérêt purement formel de cette disposition et l’absence de sanction en cas de manquement à celle-ci font qu’elle ne revêt pas un caractère d’ordre public. Alors que jusqu’à présent, la Haute Cour se contentait d’appliquer strictement l’article 1373 du Code de procédure civile qui reprend le formalisme de l’ancien article 837 du Code civil3. Les juges du quai de l’Horloge se retournent vers l’interprétation extensive qu’ils avaient observée en 20 164. En effet, dans l’arrêt du 31 mars 2016 la Cour répond, non pas aux contestations inexistantes dans le procès-verbal, mais aux sommes contestées établies dans celui-ci pour déclarer recevable les contestations litigieuses.
Le visa n’étant pas le même, la Cour de cassation s’autorise une interprétation presque audacieuse de l’ancien article 837 en le déclarant extérieur à l’ordre public et autorisant les contestations sur un montant lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Il est important de noter qu’elle accorde une place prédominante au fond sur la forme bien que les successions soient des affaires grandement encadrées par les professionnels du droit. La substance, à savoir les montants de la succession, prime sur les oublis éventuels d’un formalisme qui sanctionne de manière disproportionnée les droits des héritiers.
Cass. 1re civ., 5 novembre 2020, n° 20-16.879
Exécuter tu feras mais des libéralités tu ne recevras pas.
L’incapacité de recevoir du médecin traitant le de cujus s’étend au conjoint de ce dernier. L’incapacité au sens de l’article 909 du Code civil (en sa version antérieure à 20 075) ne doit s’entendre uniquement pour les transferts patrimoniaux et ne s’applique pas à la désignation en qualité d’exécuteur testamentaire.
En l’espèce une femme est suivie par un médecin pour la maladie qui causera sa mort. Elle fut soignée par celui‑ci de 1993 à 1999, date à laquelle elle décédera des suites de cette maladie. Pendant la durée du traitement, elle a recours à des codicilles le 20 et 22 février 1994 et du 3 décembre 1995 dans lesquels elle décide de nommer son médecin comme exécuteur testamentaire. Par ailleurs, le de cujus avait consenti un legs particulier de bijoux à l’épouse de son médecin. Ainsi, les héritiers de la patiente décédée saisissent le tribunal de grande instance de Paris le 20 octobre 2016 pour contester les codicilles et en demander la nullité. Le TGI annule les actes sur la base des articles 909 et 911 du Code civil en leur version antérieure à 2007. Le médecin et son épouse interjettent appel et la cour d’appel de Versailles, le 12 mai 2020, confirme la décision prise en première instance.
Le médecin et son épouse forment un pourvoi en cassation au moyen qu’il existait un lien affectif entre les consorts et le de cujus faisant que cette situation excédait le cadre de l’article 909 du Code civil. La Cour de cassation était amenée à déterminer si les liens médicaux ou les liens affectifs devaient être pris en compte afin de déterminer le champ d’application de l’article 909 du Code civil et ainsi annuler ou non les codicilles susmentionnés.
La Cour procède à un examen en deux temps. D’abord en ce qui concerne le legs consenti à l’égard de l’épouse du médecin, la haute juridiction déclare que l’incapacité frappant le médecin ayant traité le défunt pour sa maladie mortelle à recevoir don ou legs s’étend au conjoint de ce dernier puisque l’esprit de la loi a pour objet de prohiber le médecin de bénéficier pour tout ou partie du patrimoine du de cujus. Il faut entendre ici que le législateur avait pour ambition de protéger un patient à la santé déclinante de sa propre vulnérabilité pouvant entraîner des libéralités au profit du corps médical l’encadrant. Il fallait protéger légalement le patient vulnérable et en fin de vie contre lui-même. En effet, faute de pouvoir toujours démontrer un abus de faiblesse, le risque de potentielles libéralités impulsives ou provoquées était présent.
Par conséquent, cette disposition couvre également les dons et legs consentis au profit de l’épouse du médecin contournant ainsi l’appréciation in globo de l’article 909 du Code civil. Les juges du quai de l’Horloge confirment la décision prise en appel et conservent la nullité des legs de bijoux au profit de la femme du médecin.
Dans un second temps, il convient de savoir si l’incapacité dont est frappé le médecin à l’égard de la succession du de cujus est seulement d’ordre patrimonial ou bien si elle doit s’entendre plus largement, id est comme l’ensemble des stipulations se rapportant à la répartition du patrimoine du défunt. En effet, le de cujus ayant choisi comme exécuteur de la succession le médecin ayant traité la pathologie mortelle, la validité du legs au profit de la femme de ce dernier soulève de réelles questions. Or la première chambre civile explique que la disposition testamentaire en l’espèce ne consentait aucune libéralité à l’égard du médecin et qu’il était imposé de respecter la lettre de la loi stricto sensu. À noter également que les codicilles pour entrer dans le cadre de l’article 909 du Code civil doivent avoir une temporalité commune avec la période du traitement de la maladie. À supposer que ces modifications testamentaires aient eu lieu avant le 8 décembre 1993, elles n’auraient pas été susceptibles d’annulation. Donc l’épouse aurait pu être la bénéficiaire du legs.
Ainsi la Cour de cassation confirme la décision prise par la cour d’appel de Versailles en ce qui concerne la libéralité consentie au profit de l’épouse du médecin. Néanmoins, elle insiste sur le fait que les dispositions des articles 909 et 911 du Code civil ne s’attachent qu’aux seules libéralités et elle reçoit la désignation du médecin en tant qu’exécuteur testamentaire comme non susceptible de nullité.
B. L’intention libérale du disposant
Cass. 1re civ., 10 février 2021, n° 19-20.026 & Cass. 1re civ., 16 décembre 2020, n° 19-13.701
Sujet souvent problématique, l’intention libérale du disposant est une question récurrente présentée aux tribunaux. Elle demeure, de plus, difficile à prouver. Concernant cette notion, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est montrée constante et précise dans ses derniers arrêts. Elle est venue censurer les juges du fond qui ne s’attachent pas sérieusement à l’étude de cette notion. En effet, l’intention libérale est la notion centrale en matière de donation qui en conditionne l’existence et les conséquences.
Ainsi dans son arrêt du 10 février 2021 (n° 19-20.026), la première chambre civile censure les juges du fond qui ne recherchent pas l’intention libérale pour déterminer s’il s’agit d’une donation. En l’espèce, une défunte laisse à sa succession son époux, commun en biens, et deux enfants. Leur fille a bénéficié de l’aide financière de ses parents pour acquérir un appartement et un garage à Marseille. Suite à l’assignation en justice pour le partage judiciaire de la succession, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 avril 2019, considère que les sommes versées pour ces acquisitions constituent des donations qui sont alors rapportables à la succession, sans toutefois s’attarder à rechercher si les parents avaient fourni ces sommes dans une intention libérale. Le père et sa fille forment alors un pourvoi en cassation, contestant la qualification de donation rapportable. La première chambre civile vient censurer la décision de la cour d’appel en cassant l’arrêt sur ce point et vient rappeler aux juges du fond qu’en application de l’article 843 du Code civil, pour que l’appauvrissement du disposant soit caractérisé de donation, il faut caractériser l’intention libérale.
En complément de ce premier arrêt, il faut également noter un arrêt du 16 décembre 2020 n° 19-13.701. En l’espèce un couple divorce et des difficultés liées à la liquidation apparaissent. Monsieur désire notamment récupérer les sommes versées à celle qui était son épouse, en vertu de la révocabilité des donations, telle qu’elle était prévue à l’alinéa 1er de l’article 1096 du Code civil, dans sa version antérieure à la loi du 26 mai 2004 et applicable au cas d’espèce. Aussi le litige s’est-il noué notamment sur la qualification de donation desdits versements. L’épouse soutient l’absence d’intention libérale pour que ces sommes soient qualifiées de libéralités rémunératoires, non révocables, mais dans son arrêt du 3 avril 2018 la cour d’appel de Lyon déboute l’épouse de sa demande. Bien que l’époux ne rapporte pas la preuve de son intention libérale, la cour d’appel présume celle-ci et qualifie le versement de ces sommes de donation. Mais la première chambre civile de la Cour de cassation vient casser cet arrêt. Elle rappelle que les transferts d’argent entre époux peuvent avoir diverses causes, et que pour qualifier un transfert de donation, il faut donc arriver à démontrer l’intention libérale.
À travers ces deux arrêts, la première chambre civile de la Cour de cassation vient donc rappeler deux choses aux juges du fond en matière de donations et de libéralités : l’importance de la notion d’intention libérale pour retenir la qualification de libéralité. Bien que cet exercice soit délicat pour les juges, ils doivent s’y atteler, car la Cour de cassation leur rappelle une fois de plus (depuis 1re Civ, 14 février 1989, pourvoi n° 87-14.205) que l’intention libérale ne se présume pas.
CA de Versailles, 21 avril 2020 RG, n° 19/00288
L’intention libérale pour la requalification du testament-partage en testament ordinaire et l’intégration d’un capital d’assurance-vie dans la succession.
En l’espèce, la défunte avait effectué certaines attributions, afin de remercier sa fille pour s’être occupée d’elle depuis le décès de son mari. Ainsi au moment de la rédaction de ses dernières volontés elle avait manifesté une volonté claire et non équivoque d’avantager sa fille par rapport aux autres héritiers. Il y eut, toutefois, un problème quant à la qualification du testament.
Les juges ont ainsi rappelé à bon droit que le testament-partage permet au de cujus d’opérer la répartition anticipée de ses biens entre les bénéficiaires qu’il désigne dans son testament. De plus, le de cujus opère le partage de lui-même, ce dernier s’imposant aux héritiers, la réduction éventuelle s’effectuant en valeur. Il n’y a dès lors ni indivision ni partage successoral. Ainsi, la volonté de l’auteur de l’acte doit être recherchée pour savoir s’il a voulu réaliser un testament-partage.
Il convient alors de noter qu’une distribution inégalitaire des biens n’est pas en soi contraire à la qualification de testament-partage. Cependant, il faut alors que cette inégalité ne résulte pas de la volonté du testateur d’avantager un de ses héritiers en le gratifiant. Si l’inégalité résulte de la volonté propre du testateur, il faudra requalifier le testament-partage en testament ordinaire.
La cour d’appel de Versailles a donc dû rechercher la volonté de la défunte. Ainsi, en se fiant à certains indices, notamment dans le fait que la défunte souhaite remercier sa fille pour s’être occupée d’elle contrairement à sa sœur, cela montre une volonté claire d’avantager sa fille au détriment de l’autre. C’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la qualification de testament-partage au profit d’un testament ordinaire. La cour relève, en outre, qu’elle avait employé les termes « Je lègue » et non ceux de « J’attribue » selon elle, l’emploi du verbe « léguer » corroborerait l’intention libérale qui l’animait à l’instant de la rédaction de son testament.
Ainsi, cette affaire, qui n’a rien apporté de nouveau dans notre droit, montre tout de même l’importance et la primauté de l’intention libérale, faisant de celle-ci un élément central dans les successions.
Dans la même affaire , il était question d’inclure un contrat d’assurance-vie dans la succession il a donc fallu rechercher la volonté du de cujus.
La seule désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie par voie testamentaire n’est qu’une modalité de désignation de celui-ci et ne permet pas de qualifier son bénéfice de libéralité, toutefois, un tel contrat peut être intégré à la succession par la volonté du souscripteur exprimée dans son testament.
Pour retenir que, par la volonté de la défunte, le capital du contrat d’assurance-vie faisait ainsi partie de la succession, les juges d’appel ont ainsi procédé à une recherche concernant la volonté de la défunte. Selon la cour, quelle que soit la nature du placement effectué au titre de l’assurance-vie, le contrat litigieux était donc expressément inclus dans les actifs financiers. En léguant à sa fille « les actifs financiers gérés » par la banque et regroupés sous cette appellation, la défunte a donc entendu lui léguer le contrat d’assurance-vie.
C’est donc en exécution du testament que les fonds qui auraient dû revenir à chacune des sœurs par moitié avaient été remis dans leur intégralité à la légataire. En effet, ce testament ne comprenait aucune clause spécifique au contrat d’assurance-vie, ainsi, la de cujus n’avait nullement désigné expressément sa fille comme bénéficiaire du seul contrat d’assurance-vie. De facto, le legs à son profit regroupait l’ensemble des actifs financiers gérés par la banque et regroupés sous l’appellation contrat Panorama.
In fine, le contrat d’assurance-vie est une partie intégrante de la succession au même titre que les actifs financiers puisque ce fut les dernières volontés de la défunte. La cour d’appel de Versailles a donc bien recherché l’intention libérale qui résultait des dernières volontés de la défunte.
C. Le formalisme requis
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18.25.30
Dans cet arrêt, la Cour de cassation tend à affirmer sa position concernant les donations de sommes d’argent en présence d’une société, source de difficultés quant aux rapports entretenus entre les acteurs en présence.
En l’espèce, Mme X lors de son vivant fit don de plusieurs sommes d’argent et remboursa différents organismes de banques pour le compte d’une société dont elle était associée pour le compte de l’un de ses enfants. Lors de son décès, elle institua ses deux enfants légataires aux termes d’un testament olographe par lequel elle lègue divers biens, dont un à son fils aîné à charge pour son fils cadet bénéficiaire des dons de sommes d’argent de verser une soulte à son frère.
Le fils aîné fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2018 de rejeter sa demande tendant au rapport à la succession de ces dons de sommes d’argent en justifiant sa décision que ces dons ne peuvent s’assimiler à un appauvrissement tendant à avantager un de ses héritiers, en raison de son implication au sein de la société qualifiant donc ces dons d’obligation professionnelle.
Par un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, justifie sa décision, que les juges d’appel n’avaient pas recherché suffisamment si Mme X n’avait pas artificiellement soutenu l’activité professionnelle de son fils cadet en se substituant à lui dans les paiements des dettes sociales de sorte à avantager ce dernier.
Par cet arrêt, la Cour de cassation soutient et motive sa position qui est celle de placer au centre de tout, l’intention libérale du donateur. En l’espèce, il est vrai que les faits de Madame auraient pu s’apparenter comme professionnels, mais son implication dans les diverses sociétés de son fils et également ses remboursements des cautions auprès de divers organismes de crédit pouvaient en réalité être perçus comme des signaux d’alerte d’une réelle intention libérale ayant pour vocation à avantager un héritier au détriment d’un autre.
Cass. 1re civ., 16 septembre 2020, n° 19.15.818
Dans cet arrêt, la Cour de cassation est amenée à redéfinir les contours du formalisme encadrant l’incapacité des professionnels du monde médical à recevoir des dons ou legs de leur patient, suivant l’article 909 du Code civil.
En l’espèce, Madame X de cujus légua par testament olographe partie de ses biens à Madame Y infirmière libérale qui s’était occupée d’elle avant sa mort. Après sa mort, Madame Y assigna le frère (seul héritier) de la défunte, Monsieur Z en délivrance du legs.
Monsieur Z fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 février 2019 d’avoir accédé aux demandes de Madame Y justifiant sa décision que le testament fut rédigé avant le diagnostic de la dernière maladie de Madame X, entraînant son décès.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en justifiant sa décision que : « l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ».
En somme, cet arrêt du 16 septembre 2020 revêt une très grande importance, puisque les juges de la haute juridiction posent de nouveau l’interdiction de recevoir un legs pour les professionnels du monde médical.
La date du diagnostic de la dernière maladie du disposant n’a pas et ne doit pas trouver une influence chez les juges du fond pour apprécier la validité d’un legs au médecin ou à l’infirmier. En effet, ce qui reste le fondement de l’article 909 du Code civil c’est la notion de dernière maladie du disposant et non la date du diagnostic. Peu importe donc que le professionnel médical entretienne de bonnes relations avec le disposant avant le jour du diagnostic pour justifier de la validité du testament.
Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 19.12.296
Dans cet arrêt, la haute juridiction redéfinit les contours de l’article 928 du Code civil, remaniant totalement son leitmotiv « Les fruits augmentent l’hérédité ».
Dans les faits, des époux parents de sept enfants avaient légué à deux d’entre eux trois parcelles de terre. À la suite du décès des parents, les cinq autres enfants assignèrent les deux donataires afin d’obtenir la réduction de cette libéralité.
Aux termes d’une longue et fastidieuse procédure judiciaire, la cour d’appel d’Aix-En-Provence dans son arrêt du 5 décembre 2018 confirme cette donation et dispense les donataires de la restitution des fruits générés par les biens objets de la libéralité. Pour cause, les revenus modestes des donataires conduisent à cette dispense de restitution. Les cinq héritiers lésés contestent alors cette décision reprochant aux juges une incompatibilité sur la déclaration des revenus des donataires et les investissements réalisés par eux au fil du temps.
Un pourvoi est alors formé et part un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation rejette le pouvoir selon le motif que :
L’obligation imposée au donataire par l’article 928 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. Il en résulte que la valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduite des fruits qu’il doit restituer sur le fondement de ce texte.
Ainsi, les fruits augmentent-ils toujours l’hérédité ?
La haute juridiction répond par la négative. Alors que l’on considérait comme acquis la lettre de l’article 928 du Code civil, cet arrêt nous apporte une nouvelle grille de lecture, incluant donc en cas de réduction d’une libéralité d’un bien frugifère, la prise en compte du travail effectué par le donataire dans la mise en valeur du bien.
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-16.392
Dans cet arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation vient rappeler l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis en matière de succession.
En l’espèce, une personne décédée ne laissant aucun héritier réservataire. Cependant, la défunte avait rédigé plusieurs testaments olographes successifs, un en date du 30 janvier 2012 désignant M M. en qualité de légataire universel et un autre en date du 24 février 2013, désignant en tant que légataire universelle Mme V., fille de son époux prédécédé. Ces deux légataires ont été envoyés en possession de leurs legs et par un acte du 3 août 2015, le légataire dont le titre est le plus récent assigne le second en demandant l’annulation du plus ancien des testaments au motif que le plus récent le révoquait de droit.
Dans son arrêt du 6 février 2019, la cour d’appel de Paris donne raison au demandeur et annule le testament en date du 30 janvier 2012. Dans cet arrêt, la cour retient que les deux testaments litigieux sont incompatibles du fait que le plus récent comporte la mention suivante : « en conséquence, après mon décès, je lui léguerai tous mes biens mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession ». Pour la cour, l’utilisation du terme « tous » par la défunte souligne sa volonté que soit désignée comme légataire universel la personne citée dans le testament en date du 24 février 2013 et que lui soit ainsi octroyée l’intégralité de ses biens.
Par un arrêt du 13 janvier 2021, la haute juridiction vient infirmer l’analyse de la cour d’appel de Paris. En effet, pour la Cour de cassation, la cour d’appel par adjonction du mot « tous » est venue dénaturer l’écrit qui lui était soumis. Effectivement l’acte mis en cause était initialement : « En conséquence, après mon décès, je lui léguerai mes biens mobiliers et immobiliers qui composent ma succession ».
En définitive, cet arrêt vient rappeler le principe selon lequel l’interprétation des testaments relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, à condition que ces derniers n’en dénaturent pas le contenu. En effet, il était question dans cet arrêt de savoir si les deux testaments étaient compatibles ou si le testateur avait eu la volonté de révoquer le premier testament par la rédaction d’un second. Cependant, faute de révocation expresse au sein du plus récent, le legs universel consenti aux termes du premier testament ne pouvait être révoqué.
CA de Nîmes, 29 octobre 2020 RG, n° 18-00822
Il est vrai que l’interprétation de la volonté du défunt peut donner lieu à contentieux. Seul le juge a le pouvoir de rechercher l’intention véritable de ce dernier à travers la rédaction de ses libéralités. Nombreux sont les contentieux concernant la rédaction des volontés du testateur. Cet arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 29 octobre 2020 reprend le principe d’interprétation du juge dans le cas d’un testament litigieux. On reconnaît ici un certain pouvoir attribué au juge. En outre, il revient à ce dernier la mission d’interpréter les textes à l’occasion de l’application de la loi.
En l’espèce, un défunt par un testament authentique institua pour légataire universel l’Association Société Protectrice des Animaux sans apporter plus de précision s’agissant du lieu d’exercice de ladite association. De ce fait, le notaire chargé du règlement de la succession informa cette société parisienne de l’existence d’un legs à son profit, qu’elle accepta. Mais par un acte d’huissier, l’Association protectrice des animaux du lieu de résidence du défunt vauclusien assigna l’association parisienne afin d’être désignée comme seule destinataire du legs susmentionné au motif d’une confusion dans l’utilisation de certains termes impliquant alors une ambiguïté dans la réelle volonté du défunt. Pour l’Association vauclusienne, la réelle volonté du défunt était de désigner en son testament, « une association locale située à quelques kilomètres de son domicile ». Par un jugement du 6 février 2018, les juges du tribunal de grande instance d’Avignon ont interprété le testament litigieux au profit de l’Association vauclusienne. L’association parisienne interjeta appel et demanda que soit annulée cette décision au motif que son siège étant à Paris, son rayon d’activité était national et qu’elle seule pouvait utiliser l’appellation générique de « Société Protectrice des Animaux » précisément employée dans le testament du défunt.
Le 29 octobre 2020, la cour d’appel de Nîmes confirme la décision attaquée. La cour indique que :
L’identification de la volonté du testateur doit s’effectuer en recourant à la fois aux éléments intrinsèques et extrinsèques du testament. En l’espèce, à défaut d’éléments intrinsèques permettant d’apporter un éclairage sur l’identification du légataire désigné par le recours à la seule expression générique Société Protectrice des Animaux, c’est à bon droit que les premiers juges ont recherché des éléments de preuve dans les éléments extrinsèques.
La volonté du testateur peut être prouvée par tous les moyens. Par conséquent, en apportant la preuve d’un don effectué en 2002 au profit de l’association vauclusienne, d’une promesse de don établie en 2006 et de témoignages de proches, les attaches nouées par le défunt auprès de cette association vauclusienne ont pu être établies.
À travers l’interprétation de ce testament litigieux, on remarque l’importance d’un travail rédactionnel rigoureux dans l’établissement d’une libéralité. En cas de contentieux, on se réfère au pouvoir d’interprétation du juge qui permet d’identifier formellement la volonté du testateur.
CA de Paris, 3 février 2021 RG, n° 20/06356
Dans cet arrêt du 3 février de la cour d’appel de Paris, il est question de l’établissement d’un legs universel au profit d’une association non dénommée. Cette décision rappelle les règles en matière de délais de recours par application de l’article 538 du Code de procédure civile.
En l’espèce, aux termes d’un testament olographe une défunte ne laissant ni descendant, ni ascendant, ni héritier à réserve, a désigné deux personnes destinataires d’une somme d’argent, le reste attribué à la lutte contre le cancer. Un notaire désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession de la défunte a informé le 1er mars 2019 une association, l’Association France lymphome espoir de l’existence d’un legs universel dont elle pouvait se prévaloir. Aux termes de son testament, la volonté de la défunte de léguer pour le cancer était caractérisée : « le reste pour le cancer ». Par conséquent, par requête en date du 27 décembre 2019, l’Association France lymphome espoir a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu’elle soit formellement désignée comme destinataire du legs universel. L’association invoque le fait qu’elle a précisément pour objet de lutter contre les lymphomes caractérisant ainsi une parfaite adéquation avec la volonté exprimée de la défunte. De plus, au vu de la désignation non précise du légataire universel, l’association en demande une interprétation de la part des juges.
Par une ordonnance en date du 24 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris rejette ladite requête au motif que « l’envoi en possession ne pouvait s’appuyer sur des éléments extrinsèques au testament ». Dans le but que soit révisée cette ordonnance, l’association interjette appel devant la cour d’appel de Paris. L’association demanderesse souhaite que les juges du fond interprètent le testament pour que lui soit envoyé en sa possession, l’ensemble des biens composant le legs universel.
Le 3 février 2021, la cour d’appel de Paris rejette l’appel formé par l’Association France lymphome espoir du fait du non-respect des délais de recours autorisés provoquant ainsi l’irrecevabilité de l’appel. Par application de l’article 538 du Code de procédure civile : « le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse ». De plus l’article 950 du même Code indique que : « l’appel contre une décision gracieuse est formé par un avocat par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ». En l’espèce, l’association a omis d’appliquer ces dispositions dans le cadre de son appel. En effet, en ne respectant pas la forme du recours susmentionné dans un délai imparti, la cour d’appel de Paris déclare « irrecevable » l’appel formé par l’Association France lymphome espoir contre l’ordonnance du 24 janvier 2020. Dans cet arrêt, la cour d’appel ne se prononce pas sur l’interprétation du testament mais seulement sur le non-respect des règles spécifiques de l’appel.
Ainsi, malgré un devoir de rechercher l’interprétation utile et précise d’un testament sans en dénaturer la teneur de la part du juge, en l’espèce, l’appel est déclaré irrecevable au vu du non-respect des règles spécifiques de l’appel. Par conséquent, même si l’association peut être désignée comme bénéficiaire du legs si l’intention du testateur est recherchée, ici il n’en est rien du fait du recours trop tardif.
En définitive, on reconnaît à travers l’étude de ces différents arrêts, l’importance d’un travail rédactionnel méticuleux en matière de libéralités. En effet, nombreux sont les contentieux en lien avec l’interprétation du testament et dans ce cas, le juge joue un rôle primordial. Parallèlement à cette rigueur rédactionnelle, d’autres règles spécifiques doivent être appliquées.
II. Le rapport et la réduction des libéralités et des assurances-vie
A. Le cas des libéralités
Cass. 1re civ., 2 septembre 2020, n° 19-55.955
Toute demande de rapport de donation, même en cas de recel, doit être formée concomitamment à une demande en partage successoral.
En l’espèce, un homme décède en 2004, laissant sa femme et deux fils, fils auxquels il avait consenti une donation-partage d’un bien immobilier.
L’épouse et l’un des fils renoncent à la succession, alors que l’autre fils l’accepte sous bénéfice d’inventaire. En 2007, le fils renonçant assigne son frère en partage du bien objet de la donation. En 2013, le fils acceptant assigne à son tour son frère, pour recel, et demande ainsi le rapport des donations déguisées faites par le défunt à la succession. En effet, le demandeur estime que, conformément à l’article 792 ancien du Code civil, l’héritier receleur est déchu de la faculté de renoncer à la succession et doit donc, en vertu de l’ancien article 843 du même Code, rapporter les donations reçues par le de cujus. Sa demande est reçue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le défendeur forme un pourvoi en cassation, affirmant que l’action était irrecevable, sans demande de partage concomitante.
Les juges de la Cour de cassation cassent l’arrêt de la cour d’appel et donnent raison au demandeur au pourvoi. Toute demande de rapport de donation déguisée en application de la sanction du recel doit être formée à l’occasion d’une instance en partage successoral. En l’espèce la demande est irrecevable.
Cette solution n’est pas nouvelle, mais cet arrêt permet de la réaffirmer et de la préciser. En effet, ici la situation était particulière, puisque le fils condamné pour recel, et à qui il était demandé de rapporter une donation, avait initialement renoncé à la succession. Néanmoins, la sanction de sa condamnation pour recel fait qu’il devient alors acceptant pur et simple et doit donc le rapport. Cette demande de rapport de la donation par le frère, même si elle est une application de la sanction du recel, doit être formée lors de l’instance en partage successoral.
Cass. 1re civ., 16 décembre 2020, n° 19-18.472
Pour demander le rapport d’une donation, il est nécessaire pour le demandeur de prouver l’existence de cette libéralité, puisque la charge de la preuve lui incombe. Celle-ci se caractérise par un appauvrissement du donateur et son intention libérale.
En l’espèce, un homme décède, laissant pour lui succéder deux filles, son épouse étant prédécédée. L’une des héritières estime que sa sœur doit rapporter à la succession une somme équivalente à la valeur locative d’un appartement, appartement appartenant à son père, et qu’elle a occupé privativement plusieurs années.
Les juges de la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 17 juillet 2018, donnent raison à la demanderesse, et condamnent sa sœur au rapport d’une somme équivalente à la valeur locative du bien. Les juges estiment en effet que la défenderesse a occupé gratuitement le bien, puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’un paiement de loyer à son père, ce qui constitue alors une donation soumise à l’obligation de rapport.
La sœur défenderesse forme un pourvoi en cassation, affirmant tout d’abord que, conformément à l’article 843 du Code civil seules les libéralités sont rapportables. Ces dernières se caractérisent par un appauvrissement du donateur et son intention libérale. De plus, en vertu de l’article 1353 nouveau du même Code, la charge de la preuve incombe au demandeur. C’est donc, selon elle, à sa sœur de rapporter la preuve de l’existence de cette donation.
Or, les juges la condamnant au rapport, en constatant seulement l’absence de preuve du paiement d’un loyer, ne donnent donc pas de base légale à leur décision et violent l’article 1353 du Code civil, en opérant un renversement de la charge de la preuve.
Les juges de la Cour de cassation cassent l’arrêt d’appel et donnent raison à la demanderesse au pourvoi. En effet, seule une libéralité, supposant un appauvrissement du donateur et une intention libérale, est rapportable à la succession. De plus, la charge de la preuve de l’existence de cette libéralité repose sur la personne qui demande le rapport. L’héritier demandant le rapport d’une libéralité à la succession doit donc démontrer son existence.
Cass. 1re civ., 8 juillet 2020, n° 19-12.485
En l’espèce, une parcelle de terre avait été donnée par le père de famille à l’un de ses enfants en 1993. Après le décès du donateur, des difficultés liquidatives surviennent et retardent ainsi les opérations de partage. En 2012, le notaire en charge de la succession a fixé la valeur de ce bien à 154 000 euros. Les héritiers estimant que la valeur du bien avait été mal évaluée ont intenté une action en justice.
Par une décision rendue en 2018, la cour d’appel de Rennes a, néanmoins, repris ce montant. Soutenant que les juges du fond avaient violé les dispositions de l’article 860 du Code civil, les héritiers ont alors formé un pourvoi en cassation.
La question qui se posait devant la Cour de cassation était celle de savoir si les juges du fond pouvaient, pour déterminer le montant du rapport, s’appuyer sur une estimation datant de 6 ans.
Par son arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation précise que lorsque le partage n’a pas encore eu lieu, il incombe aux juges du fond de statuer à la date la plus proche de celui-ci, soit celle à laquelle ils se prononcent. Néanmoins, elle donne raison aux juges du fond en retenant qu’il n’existait, en l’espèce, aucun élément de nature à diminuer la somme fixée par le notaire. Ainsi, selon la première chambre civile de la Cour de cassation, les juges du fond pouvaient s’appuyer, pour fixer le montant du rapport, sur l’estimation datant de 6 ans.
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-19.650
En l’espèce, un fils exploitant un fonds de commerce appartenant à son père l’avait vendu et avait conservé le prix de vente, sans que son père n’exprime aucune réclamation. Après le décès des parents, le frère du vendeur, découvrant la cession du fonds de commerce, demanda qu’il soit tenu compte de cet avantage dans le règlement de la succession.
La Cour de cassation, statuant sur renvoi, n’a pas fait droit à cette demande au motif que l’intention libérale du donateur n’avait pas été constatée par la cour d’appel. En outre, elle rappelle que les juges du fond doivent préciser pour quel motif les sommes rapportables sont retenues, afin de satisfaire à l’exigence de motivation des décisions de justice imposée par l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision de la Cour de cassation est sans surprise. En effet, depuis une série d’arrêts du 18 janvier 2012 opérant un revirement de jurisprudence, celui qui prétend au rapport d’une libéralité doit prouver l’existence des éléments qui la constituent. Si la preuve de l’élément matériel pose moins de difficulté, la preuve de l’intention libérale est parfois difficile à rapporter.
Dans cette affaire, la décision de la cour d’appel encourt nécessairement la cassation. D’une telle décision, il conviendra de retenir que l’intention libérale ne saurait se déduire du seul appauvrissement définitif du donateur et de l’enrichissement corrélatif du donataire. Ainsi, celui qui invoque l’existence d’une donation doit également rapporter la preuve de l’intention libérale du donateur, à défaut l’opération ne pourra être qualifiée de libéralité rapportable à la succession.
Enfin, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en ce que les juges du fond n’avaient pas indiqué pour quel motif ils avaient retenu les sommes qu’ils avaient estimées rapportables. Si cette précision paraît avoir des conséquences moindres dans l’affaire en cause, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation rappelle aux juges du fond que l’évaluation des sommes rapportées doit être motivée.
Cass. 1re civ., 12 février 2020, n° 18-23.573
En l’espèce, un héritier est condamné au rapport, dans la succession de sa mère, d’une somme correspondant à un prêt qu’elle lui aurait consenti. S’il en reconnaît l’existence, il prétend l’avoir déjà remboursé. Il reproche alors à la cour d’appel d’avoir fait peser sur lui la charge de la preuve du remboursement de ce prêt pour échapper au rapport, alors que selon lui, il appartenait aux cohéritiers de rapporter la preuve que cette dette existait toujours au jour de l’ouverture de la succession.
La Cour de cassation a ainsi dû se prononcer sur la question de savoir sur qui, de l’emprunteur ou de ses cohéritiers, pesait la charge de la preuve de l’obligation au rapport.
Afin de répondre à cette question, la haute juridiction a opéré une distinction entre le rapport des libéralités et le rapport des dettes. Elle a ainsi rappelé que le rapport des libéralités constituait une opération de liquidation préalable au partage, tandis que le rapport des dettes concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. C’est alors qu’elle a pu en déduire l’applicabilité du droit commun de la preuve en ce qui concerne le partage des dettes des copartageants. Se fondant sur l’article 1353 du Code civil, elle fait dépendre la charge de la preuve de son objet : s’il s’agit de démontrer l’existence de la dette, la charge pèse sur le créancier et s’il s’agit de démontrer l’extinction de la dette, la charge pèse sur le débiteur.
Cet arrêt constitue pour beaucoup d’auteurs un revirement de jurisprudence. En 2013, la Cour de cassation avait en effet retenu l’inverse et censuré le raisonnement des juges du fond qui avaient retenu que l’héritier débiteur devait rapporter la preuve du remboursement de sa dette à l’égard du défunt.
Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-10.179
En l’espèce, deux époux avaient consenti des libéralités à leurs trois enfants. À leur décès, des difficultés sont apparues entre les héritiers quant au partage des successions. L’objet du litige concernait notamment les indemnités de réduction. Pour les calculer, le notaire avait retenu les valeurs des immeubles donnés à l’ouverture de la succession. Or certains de ces immeubles ont bénéficié d’une augmentation conséquente de leur valeur depuis l’ouverture des successions. L’un des héritiers forma un pourvoi en cassation au moyen que la cour d’appel aurait violé l’ancien article 868 du Code civil.
Il s’agissait pour les juges du droit de déterminer si la valeur des biens donnés devait être retenue au moment de l’ouverture de la succession ou au moment du partage pour le calcul de l’indemnité de réduction.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en affirmant que le calcul de l’indemnité de réduction devait s’établir au partage et non à l’ouverture de la succession. Après avoir rappelé que « l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage », les juges du droit ont indiqué que l’article 868 du Code civil doit s’articuler avec l’article 922 du Code civil. En effet, si ce dernier article permet de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, l’article 868 lui permet de calculer l’indemnité de réduction en retenant la valeur des biens donnés à l’époque du partage.
B. Le cas de l’assurance-vie
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-21.420
Une assurance-vie peut être considérée comme une donation, notamment si certaines conditions sont réunies : en cas de volonté de se dépouiller de manière irrévocable.
Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, d’ici 2030, plus de 100 000 nouvelles personnes vivront en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) par rapport à 2019. Ainsi de plus en plus d’établissements pouvant accueillir des publics dépendants voient le jour actuellement.
Si la question des places disponibles est une interrogation importante, celle des coûts l’est tout autant. En effet ces établissements sont une charge financière considérable pour la personne dépendante et son entourage. Pour éviter un maintien à domicile contraint par des raisons financières, des aides sont mises en place notamment par les départements : l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH).
En réalité, l’ASH est une avance versée par le Conseil départemental, et celle-ci peut être récupérée au décès du bénéficiaire : sur la succession, de son vivant si sa situation financière s’améliore, et même sur une donation qu’il aurait faite.
C’est l’articulation de cette avance réalisée par le Conseil départemental, et d’une assurance-vie qui est au centre de l’arrêt n° 19-21.420 rendu le 3 mars 2021 par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation.
En l’espèce, le Département de l’Allier a ouvert une action en récupération des aides sociales versées au de cujus à l’encontre de la succession, mais surtout à l’encontre du bénéficiaire d’une assurance-vie. En effet, celui-ci avait bénéficié d’aides sociales récupérables sur la succession pendant sa vie.
Le défunt de son vivant avait souscrit un contrat d’assurance-vie au profit d’un bénéficiaire avant d’avoir bénéficié de cette aide du département.
Au décès du bénéficiaire de ces aides, le Conseil général de l’Allier demande la récupération des aides versées auprès du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Pour le Conseil général, ce contrat est une donation indirecte. Une action en récupération est donc valable, cette action étant possible à l’encontre du bénéficiaire d’une donation.
En effet l’Art L 132-8 du Code de l’action sociale et des familles dispose :
« Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire. »
La cour d’appel rejette la demande du département, et celui-ci décide donc de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation reçoit le pourvoi et casse la décision d’appel.
La Cour de cassation estime qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, ce qui in concreto était le cas au regard de l’âge et de la somme en jeu. En effet le de cujus n’avait aucun intérêt à conclure ce contrat à part celui de réaliser une donation.
En réalité, la Cour prévoit qu’un contrat d’assurance-vie peut être une donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné témoignent de la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Il est nécessaire de faire une appréciation in concreto de différents éléments. Par principe l’assurance-vie n’est pas traitée comme une donation, mais cette règle de principe souffre d’une série d’exceptions. La frontière entre ces deux notions est poreuse.
Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 19-11.187
La question se pose de la définition d’héritier, la Cour confirme son idée : l’acception du mot « héritier » peut rassembler les notions d’héritier légal, mais aussi d’héritier testamentaire. Plus qu’une définition rigide, la Cour rappelle la nécessité de chercher et suivre la volonté du testateur.
L’article L. 132-8 du Code des assurances nous dit que « la rente garantie peut être payable lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ». C’est cette désignation du bénéficiaire qui dans certaines affaires crée le litige. En effet, certaines clauses usent de termes nébuleux, tel est le cas de la notion « d’héritier ».
Toutefois, l’usage de cette notion est admis par le Code des assurances et, plus qu’être simplement admis, l’utilisation de ce terme a été systématisée. Cela s’explique, car l’usage de ce mot peut sembler pour les assurés, comme étant plus simple. Il permet par exemple d’englober tous les héritiers, même ceux n’existant pas au moment de la conclusion du contrat.
Ainsi, si le contrat venait à prendre effet après la naissance de nouveaux enfants, ceux-ci seraient concernés et englobés par cette désignation.
Dans le cas où une assurance-vie a été conclue, cette clause revêt une importance certaine, la clause désignant les bénéficiaires du contrat.
Dans l’arrêt en date du 30 septembre 2020 (n° 19-11.187), c’est bien cette désignation dont il est question et qui est au cœur du litige. Avec cette décision on peut se demander si la Cour a évolué quant à sa conception de la définition d’héritier.
En effet selon la matière (droit des assurances ou droit des successions) la définition peut être légèrement différente.
En l’espèce, dans cet arrêt, une défunte avait rédigé un testament, qui instituait légataire de la moitié de la quotité disponible sa fille et pour la seconde moitié sa petite fille. La testatrice a ensuite été placée sous tutelle de sa fille. Cette dernière a alors souscrit une assurance-vie pour le compte de sa mère après avoir obtenu l’accord du juge des tutelles. C’est autour de ce contrat d’assurance-vie qu’est né le conflit. En effet, la clause désignant les bénéficiaires dudit contrat faisait simplement apparaître la mention « mes héritiers » sans autres précisions.
Au décès de la testatrice, l’assureur partage le contrat d’assurance-vie et verse notamment 1/6 e à la petite fille du de cujus (somme correspondant à la moitié de la quotité disponible).
Le fils saisit alors la justice reprochant à l’assureur d’avoir donné la qualification d’héritier à un légataire à titre universel (la petite fille). Pour lui, l’assureur a commis une faute.
La cour d’appel de Rennes dans un arrêt rendu le 31 octobre 2018 (n° 16/00758) a débouté l’héritier ayant saisi la justice. La cour a considéré que le terme héritier prévu par la clause bénéficiaire était suffisamment défini pour identifier les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie. De plus, pour la cour, cette notion peut désigner les héritiers légaux mais aussi testamentaires.
Le fils forme alors un pourvoi en cassation estimant qu’un légataire à titre universel n’est pas héritier. Celle-ci va rejeter son pourvoi.
La haute juridiction affirme qu’en application de L. 132-8 du Code des assurances, le capital ou la rente garantie peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l’assuré.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
Elle précise ensuite que pour identifier le bénéficiaire désigné par le terme d’« héritier », il appartient aux juges du fond d’interpréter la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament. Or ici, un testament a été rédigé avant la conclusion du contrat d’assurance.
Ainsi la Cour estime que les juges du fond dans leur décision ont apprécié souverainement la volonté de la défunte, celle-ci ayant désigné par testament ses héritiers en précisant la part revenant à chacun.
Cette décision ne donne donc pas de définition du terme héritier. En réalité, plus qu’une définition immuable, pour la Cour de cassation l’important est et reste la volonté du souscripteur. Celle-ci est déterminante.
Sur ce point, cette décision n’est pas une nouveauté. La Cour par exemple dans sa décision du 14 décembre 2017 (Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 16-27.206) avait déjà eu l’occasion de souligner la prépondérance de l’appréciation des juges du fond.
Ainsi loin de donner une définition ferme de la notion d’héritier, la Cour confirme et réaffirme son idée d’une nécessaire appréciation in concreto. La recherche de la volonté, et le respect de cette dernière reste le principe.
Néanmoins on peut se demander si cette décision ne vient pas modifier l’appréhension que l’on a d’un contrat d’assurance-vie : contrat par nature hors de la succession.
Effectivement par cette définition au cas par cas du terme héritier, on peut se demander si les juges n’amoindrissent pas la différence et la frontière entre la succession et l’assurance-vie.
Par ailleurs on peut supposer que c’est justement quand les bénéficiaires de l’assurance-vie ne sont pas les héritiers légaux qu’un litige va naître.
Dans le cas d’un litige sur le terme héritier, l’assurance-vie perd sa spécificité, on reprend la répartition prévue dans la succession et on l’applique à l’assurance-vie. Or le principe de l’assurance-vie est de justement sortir du carcan appliqué aux successions.
Conclusion de ces deux arrêts
On peut se demander si ces deux décisions ne viennent pas restreindre le caractère à part de l’assurance-vie. En effet, depuis la série d’arrêts rendus en chambre mixte, le 23 novembre 2004, la Cour de cassation considère que les assurances-vie s’analysent comme des contrats aléatoires ; l’aléa portant sur la durée de la vie. Ainsi le Droit ne considère pas une assurance-vie comme une libéralité.
Alors que celle-ci est de droit, hors succession, ces deux décisions viennent par différents moyens, supprimer cette distinction. Ces décisions semblent s’inscrire dans des exceptions de plus en plus nombreuses, s’ajoutant à l’exception légale.
Dans un cas, elle est requalifiée comme étant une donation et réintègre donc le patrimoine de la succession et dans le second arrêt on calque la répartition de la succession, alors que justement l’assurance-vie permet de prévoir une autre répartition que celle prévue (voire forcée) par la loi.
Ces deux décisions semblent donc amoindrir voire évincer les particularités propres au contrat d’assurance-vie.
Ainsi certains auteurs, face à ces décisions, plaident pour une réforme du Droit de l’assurance-vie, en le plaçant sous le régime du droit commun des successions.
Cass. 1re civ., 16 décembre 2020, n° 19-17.517
En ce qui concerne les primes relatives à un contrat d’assurance-vie, la Cour de cassation précise dans une décision du 16 décembre 2020 que la totalité de la prime manifestement exagérée doit être réintégrée dans la liquidation civile de la succession et qu’elle doit être sujette à rapport lorsque le bénéficiaire est un enfant.
Faits : Un époux marié sous le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution au conjoint survivant, avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie, pour un montant s’élevant, selon les pièces justificatives à 2 066 860,85 euros, voire à 3 104 887 euros.
En l’espèce les primes furent versées, entre 1995 et 1998, alors que le souscripteur était âgé de moins de 70 ans. À son décès survenu en août 2009 après la mort de son épouse, la valeur de ces primes fut évaluée à 61 % de l’actif successoral. En exécution des clauses bénéficiaires, toutes ces valeurs furent délivrées par les compagnies d’assurances entre les mains d’un de ses enfants, désigné seul bénéficiaire des garanties. Or, le défunt laisse également à sa succession des petits-enfants venant par représentation de leur parent prédécédé, mort une année avant son auteur. Ceux-ci assignent alors leur tante en partage de la succession et en réintégration de la valeur des contrats dont elle était bénéficiaire.
Les juges du fond firent droit à leur demande. Les juges d’appel estiment que les primes versées par le de cujus étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés, de sorte que l’enfant bénéficiaire devait le rapport à la succession des sommes et des intérêts perçus par elle au dénouement de ces contrats. L’enfant se pourvoit en cassation.
Solution : Bénéficiant de primes d’assurance-vie, fille du défunt, est condamnée à rapporter à la succession, sur la demande de ses neveux venant en représentation de l’autre enfant du défunt la totalité des primes versées. Primes d’une particulière importance : plus d’un million d’euros a été versé entre les années 1995 et 1998, soit dix ans avant la survenance du décès de l’assuré, âgé de moins de 70 ans lors de ces versements.
La Cour de cassation compte tenu des circonstances dans lesquelles les primes ont été versées partage la conclusion des juges de la cour d’appel de Douai qui considèrent que ces primes sont « exagérées », tout en critiquant les juges du fond d’avoir exigé le rapport non pas des primes mais des capitaux issus des contrats dénoués au jour du décès.
III. La révocation de la libéralité pour ingratitude
Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-18278
Le légataire universel a qualité pour agir, sur le fondement de l’article 957, al. 2 du Code civil, en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude.
En l’espèce, par acte authentique du 10 octobre 1981, une femme a consenti une donation à sa fille. Cependant, cette dernière a été condamnée par un arrêt définitif du 1er juillet 2016 pour avoir commis des violences volontaires sur sa mère le 23 juillet 2014. La mère décède par la suite laissant pour lui succéder sa fille et son petit-fils institué légataire universel.
Invoquant sa qualité d’héritier, le légataire universel a assigné la fille de la défunte en révocation de la donation pour cause d’ingratitude, en application de l’article 957 alinéa 2 du Code civil.
Le légataire universel reproche à la cour d’appel d’avoir admis qu’il n’a pas la qualité pour agir en révocation de la donation en jugeant qu’il faut être un héritier légal.
Un légataire universel a-t-il qualité pour agir en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude ?
La Cour de cassation renvoie les parties devant la cour d’appel de Montpellier. Ainsi, en retenant que l’action en révocation pour cause d’ingratitude est une nature très particulière, à la fois patrimoniale et personnelle justifiant qu’on ne puisse donner la qualité d’héritier au légataire universel, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a violé le texte susvisé.
CA Aix-en-Provence, 16 décembre 2020 RG, n° 17/15507
En ce qui concerne la révocation, donation pour cause d’ingratitude, un arrêt du 27 avril 1988 illustre parfaitement le mécanisme de révocation pour cause d’ingratitude prévu par la loi.
En l’espèce, par un acte en date du 27 avril 1988, les époux Z ont acquis un bien immobilier consistant en une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et cave.
Selon un acte notarié reçu par maître Raybaudo, notaire à Aix-en-Provence le 27 décembre 2005, les époux Z ont donné à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, O Z et G Z, la nue-propriété de ladite maison représentant une valeur de 200 000 euros.
Par la suite un arrêt en date du 22 mars 2017, la cour d’assises des mineurs des Bouches-du-Rhône a condamné l’époux Z à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de viols commis sur des mineurs de 15 ans, atteintes sexuelles et exhibitions sexuelles imposées à des mineurs de moins de 15 ans. Du fait que leur fille, G Z, avait tenu des propos injurieux notamment à l’égard de M. F L E Z, et que leur fils, M. O Z, avait été condamné à une peine infamante, les époux Z ont, par acte d’huissier en date du 4 mai 2017, assigné à jour fixe leurs deux enfants aux fins de révocation pour cause d’ingratitude la donation à titre de partage anticipé qui leur avait été faite.
Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a annulé la donation à titre de partage anticipé consenti par les époux au profit de leurs deux enfants M. O Z et Mme G Z.
Mme S Q, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur T Q, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur W A, Mme X YY, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures N et J YY, ont formé appel de ce jugement.
Solution : Or, en l’espèce, ni M. O Z, assigné à personne et défaillant, ni Mme G Z, qui n’a pas même été assignée, n’ont interjeté appel du jugement rendu le 6 juillet 2017, ayant révoqué la donation à titre de partage anticipé consentie à leur profit par M. F L E Z et Mme C H épouse Z. Il convient, en conséquence, de déclarer Mmes A, Q et YY, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentantes légales de leurs enfants mineurs, irrecevables en leur appel.
Cour d’appel de Basse-Terre, 2e civ., 11 janvier 2021, n° 18/01462
Au titre des articles 953, 954 et 1046, il est possible de révoquer un legs pour cause d’inexécution des charges.
En l’espèce, un homme est décédé le 22 août 2009 laissant pour lui succéder ses parents et ses dix frères et sœurs. Par un testament authentique du 25 avril 2007, il avait consenti des legs immobiliers en faveur de ses frères et sœurs à charge pour eux de louer lesdits biens pendant cinq années consécutives à compter de son décès pour le premier et quatre années consécutives pour le second. Le 28 décembre 2011, le père de famille décède laissant pour lui succéder son épouse et ses dix enfants.
Par un premier acte d’huissier du 29 juin 2015, deux enfants ont assigné leur mère et leurs huit frères et sœurs devant le tribunal judiciaire de Basse Terre afin de voir ordonner la liquidation et le partage des successions. Ils ont également sollicité la révocation des legs pour inexécution des charges et le retour du bien dans la succession de ce dernier pour y être partagé.
Par un second acte d’huissier du 9 août 2016, un des enfants a assigné son frère devant le tribunal judiciaire de Basse Terre afin d’obtenir sa condamnation à exécuter la charge grevant le legs dont il était bénéficiaire et à lui verser à ce titre la somme de 120 000 euros. Les deux instances ont ensuite été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2017.
Par une décision du 13 septembre 2018, le tribunal judiciaire a rejeté la première demande, ordonné la liquidation-partage des deux successions et déclaré recevable la demande en révocation des deux legs. Ils ont donc interjeté appel au motif qu’ils étaient dans l’incapacité financière d’exécuter les charges, car des travaux coûteux étaient nécessaires.
Peut-on révoquer un legs pour inexécution des charges ?
Les déclarants n’ayant pas démontré que leur situation financière à cette époque les aurait empêchés de financer les travaux, ni qu’ils auraient sollicité des prêts qui leur auraient été refusés, la cour d’appel les déboute de leurs demandes et déclare recevable la demande de révocation des deux legs pour inexécution des charges par application des articles 953, 954 et 1046 du Code civil.