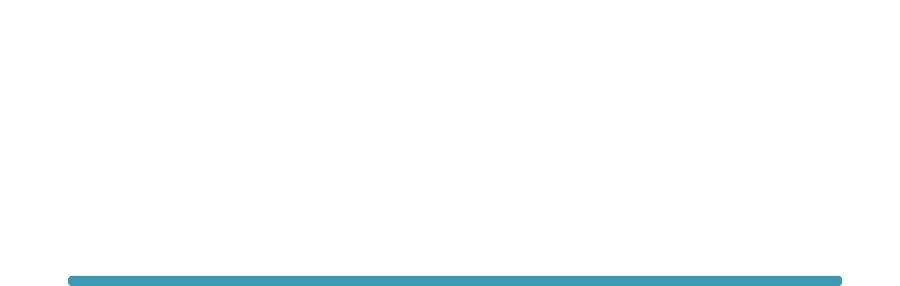I. Mariage
Le consentement au mariage
Cass. 1re civ. 19 septembre 2019 n° 18-19.665, publié au bulletin/AJ Famille (11/2019)
Dans les faits, après 15 ans de mariage, des époux déposent chacun une requête en divorce. L’époux soutenant qu’il a découvert que son épouse a précédemment été mariée à Las Vegas en 1981 avec un autre homme, soit 14 ans avant leur mariage. L’époux ne demande donc plus le divorce, mais assigne son épouse en nullité de leur mariage. L’argument avancé étant la situation de bigamie, interdite en droit français. L’épouse, elle, invoque que ce mariage à Las Vegas n’est en rien valable et demande la reconnaissance de la nullité de ce premier mariage.
La problématique ici étant de savoir si un mariage célébré à l’étranger sans véritables consentement et volonté au mariage est valable en France. De plus, une seconde problématique concernant la question de la prescription trentenaire de l’action en nullité du mariage a été abordée par la Cour.
En ce qui concerne la validité en France du mariage célébré à l’étranger et en l’espèce à Las Vegas, il est retenu par les juges du fond, et cela est confirmé par la Cour de cassation, que ce mariage est inopposable en retenant que l’épouse avait présenté ce « mariage » à ces amies comme un simple « rite sans conséquence » ; qu’en aucun cas leur voyage n’avait pour but ce mariage. De plus, les bans n’avaient jamais été publiés en France et le couple « marié » à Las Vegas n’avait « entrepris aucune démarche en vue de sa transcription à leur retour en France ». D’autre part, les enfants nés de ce couple ne s’étaient pas vus octroyer la qualité d’enfants légitimes, car ils ont été reconnus sans aucune allusion à l’acte de mariage de Las Vegas. De ce fait, il résulte de tous ces éléments que l’un des éléments de la validité du mariage en France manquait : le consentement.
En ce qui concerne la prescription trentenaire de l’action en nullité du premier mariage, il faut noter que ce moyen n’avait pas été relevé en première instance. Ce qui est reproché ici au juge du fond est de ne pas avoir relevé d’office la prescription, qui est de plus d’ordre public. En l’espèce, le premier mariage a bien été célébré plus de 30 ans avant la demande en nullité, cependant la Cour de cassation vient dire qu’aux termes de l’article 2247 du Code civil « les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ». Ainsi, les juges ne pouvaient pas relever d’eux-mêmes la prescription trentenaire de l’action en nullité et la Cour vient préciser que cette impossibilité est aussi vraie dans le cas d’une prescription qui serait d’ordre public.
En définitive, il y a deux éléments qui concernent le premier mariage : d’une part, il n’était pas valable pour défaut de consentement, il était donc « inopposable » selon les juges ; d’autre part, la prescription de l’action en nullité de ce premier mariage ne pouvait être soulevée d’office. Finalement si le premier mariage est nul ou « inopposable », le second ne peut être annulé pour bigamie.
En soi, visiblement pour la Cour de cassation, l’adage « ce qui se passe à Vegas reste à Vegas » prend tout son sens en ce qui concerne le mariage.
II. Régimes matrimoniaux
Cass. 1re civ. 11 juillet 2019, n° 18-20.235, non publié au bulletin
En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont adopté le régime de la séparation de biens, par une convention notariée homologuée par un jugement. Lors du partage, l’épouse s’est vu attribuer une maison édifiée sur deux parcelles réunies, l’une appartenant en propre à l’époux et l’autre acquise durant le mariage à l’aide de deniers communs. L’époux, de son côté, a obtenu les liquidités de la communauté.
Le fils de l’époux, après le décès de ce dernier, met en avant l’ignorance du juge de l’homologation de son existence et dénonce une fraude de ses droits dans le partage de la communauté. Il assigne donc l’épouse et les enfants de celle-ci en nullité de la convention de changement de régime matrimonial et du jugement de l’homologation. Il agit aussi subsidiairement en action en retranchement.
La Cour de cassation rejoint la cour d’appel lorsque celle-ci fait valoir que la maison constitue un acquêt de communauté. Plus précisément, elle énonce que « la contiguïté de deux immeubles ne suffit pas à elle seule à caractériser que l’un est l’accessoire de l’autre », conformément à sa jurisprudence antérieure (Cass. Civ. 1, 11 janvier 2005, n° 02-11.875). Par ailleurs, pour décider que la maison est un acquêt, la Cour se fonde certainement sur la part de la maison construite sur la parcelle commune à savoir deux tiers ici. En conséquence de quoi, le partage issu du changement de régime matrimonial était égalitaire.
Pour exclure la fraude, la cour d’appel énonce que le partage de la communauté s’est fait de manière égalitaire. Cependant, les biens allotis à chacun des époux sont de différente nature : l’épouse a reçu les biens immobiliers, tandis que l’époux a reçu les liquidités de la communauté, ce qui pourrait traduire leur volonté d’évincer l’enfant non commun (C. Rieubernet, « Changement de régime matrimonial et fraude dans le partage de la communauté », Gaz. Pal. 26 nov. 2019, n° 364h3, p. 58). La Cour casse donc cet arrêt non pas du fait que le partage ne serait pas égalitaire, mais en ce qu’il n’a pas tenu compte, recherché, si la fraude ne s’inférait pas du partage lui-même.
III. Divorce
A. Aspects pécuniaires du divorce
1. Prestation compensatoire
Cass. 1re civ. 20 mars 2019 n° 18-13.663
Essentiel : Le débiteur d’une prestation compensatoire peut, en tout état de cause demander au juge une substitution intégrale ou partielle en capital indépendamment de la nature – viagère ou temporaire – de la rente.
En l’espèce, une convention de divorce des époux, homologuée par le juge en date du 5 novembre 2001, avait fixé une prestation compensatoire attribuée à l’épouse dans le cadre du divorce.
Elle était ainsi constituée par la jouissance gratuite et viagère du domicile familial, ainsi que par le versement d’un capital et d’une rente mensuelle jusqu’au décès de son ancien époux.
Ce dernier a alors sollicité la substitution d’un capital à la rente, mais s’est vu débouté par la cour d’appel qui a retenu la nature de la rente dans son arrêt du 17 janvier 2018. Celle-ci n’étant étrangement ni viagère ni temporaire, il paraissait impossible de déterminer un capital, et ce sur le fondement de l’article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
La Haute Juridiction devait donc se prononcer sur la question de la nature de la rente : celle-ci peut-elle justifier le rejet d’une telle demande de substitution ?
La Cour de cassation censure ce raisonnement en retenant la violation de l’article 276-4 du Code civil qui dispose notamment que le débiteur puisse saisir le juge afin de voir la prestation compensatoire sous forme de rente être convertie en capital. De surcroît, les juges du quai de l’Horloge soulèvent également la violation du décret n° 2004-1157 prévoyant les modalités de calcul de la rente.
L’apport de cet arrêt consacre alors cette faculté offerte au débiteur. Elle ne peut être limitée par la nature de la rente et le rejet de sa demande ne peut donc être retenu sur le fondement d’une distinction dans la nature de la rente, qu’elle soit temporaire ou viagère.
2. Liquidation
Cass. 1re civ. 11 juillet 2019 n° 18-21.574, non publié au bulletin
Essentiel : La haute juridiction rappelle que le conjoint qui a le pouvoir d’administrer et de disposer seul des biens communs en vertu de l’article 1421 du Code civil doit, néanmoins, informer son conjoint de leur affectation, qu’il soutient avoir été fait dans l’intérêt de la communauté.
Faut-il réellement faire une confiance aveugle à son conjoint, et ce, même lorsque des sommes d’argent sont en jeu ? Rien n’est moins sûr. Dans cette affaire, un couple s’est marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts en 1988. Après le prononcé de leur divorce, des difficultés se font jour lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. À cet égard, l’ex-épouse reproche à son ex-mari d’avoir détourné des deniers communs et de l’avoir caché au moment des opérations de liquidation. La somme s’élevait à 177 528,29 euros et figurait sur un compte épargne en 2000. Logiquement, l’ex-épouse a intenté une action en justice pour réclamer la réintégration de cette somme dans l’actif communautaire et que soient appliquées, à l’égard de son ex-époux, les peines du recel sur ladite somme.
Malheureusement pour elle, la cour d’appel de Rouen, dans son arrêt rendu le 17 mai 2018, répond en rejetant toutes les demandes de la requérante. Plus précisément, la cour d’appel considère que les opérations réalisées par ce compte épargne avaient été faites du temps de la communauté et n’avaient donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que l’ex‑épouse démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu’elle n’était pas en mesure de rapporter aux débats.
Le dilemme est de taille pour la haute juridiction : le pouvoir d’administrer et de disposer seul des biens communs reconnus à tout époux est-il absolu en vertu de l’article 1421 du Code civil ? Le principe de libre administration des biens communs doit-il être contrebalancé par l’obligation d’information des époux lors des opérations de liquidation ?
Dans un souci d’équité et de transparence, la première chambre civile de la Cour de cassation a choisi de considérer que le principe de libre administration des biens communs doit être contrebalancé par l’obligation d’information des époux lors des opérations de liquidation, et ce, au visa de l’article 1421 du Code civil. Le 11 juillet 2019, la première chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel. Une piqûre de rappel ne fera pas de mal : « Si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employé dans l’intérêt commun ». La solution n’est pas nouvelle, elle est régulièrement rappelée notamment dans un arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 septembre 2014 n° 13-17.593.
3. Enrichissement injustifié
Cass. 1re civ. 17 avril 2019 n° 18-15486, publié au bulletin
Un arrêt riche d’enseignements a été rendu par la Cour de cassation le 17 avril 2019 : la jurisprudence affirme la distinction fondamentale à opérer selon que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ou la séparation de biens, et ce, sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Dans cette affaire, des époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, le divorce de Mme J. et M. Y a été prononcé le 1er février 2009. L’épouse a travaillé pendant les 18 années de mariage au sein de l’agence d’assurance et de courtage appartenant en propre à son époux sans avoir été payée ni déclarée. En conséquence, l’épouse a agi sur le fondement de l’enrichissement injustifié pour obtenir une compensation financière.
La question juridique est la suivante : dans le cadre de la communauté légale réduite aux acquêts, l’époux qui a collaboré gratuitement à l’activité professionnelle de son conjoint peut-il obtenir une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié ?
Alors qu’il est de jurisprudence constante que sous le régime de la séparation de biens, le fait pour l’époux ayant collaboré gratuitement à l’activité professionnelle de son conjoint peut lui ouvrir droit à une indemnité, lorsque sa collaboration est allée au-delà d’une simple contribution aux charges du mariage (Civ, 1re, 18 novembre 1997 n° 96-10.990), la position de la Cour de cassation se révèle différente pour le régime de la communauté. En effet, la première chambre civile a déclaré irrecevable le fondement de l’enrichissement injustifié. Selon les magistrats du quai de l’Horloge, l’époux qui a collaboré gratuitement à l’activité professionnelle de l’autre ne peut pas se prévaloir d’un quelconque appauvrissement, puisque les revenus perçus par son conjoint sont des biens communs dont il a vocation à bénéficier.
À cet égard, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 6 mars 2019 (n° 18 — 11 819, inédit) a rejeté les prétentions d’un ex-époux se fondant sur l’enrichissement injustifié pour tenter de se soustraire à des engagements pris dans leur convention de divorce respective. Il est aussi intéressant de noter que l’indemnité perçue par l’époux, agent d’assurance, en réparation du préjudice résultant de la baisse du commissionnement fixé au titre des risques automobile, habitation et santé, sont des biens communs. Son utilisation afin d’acquérir un cabinet d’assurance donne lieu à récompenses dans le cas où le cabinet serait propre.
4. Indemnité d’occupation
Cass. 1re civ. 11 juillet 2019 n° 18-20.831
Essentiel : La présence d’un enfant au domicile conjugal est susceptible d’affecter le montant de l’indemnité d’occupation due par le coïndivisaire.
Dans cette affaire, un jugement a déclaré le divorce entre M. I. et Mme F. qui étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts et des difficultés se sont élevées concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Alors que la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt en date du 3 mai 2018, a retenu que la présence d’un enfant au domicile conjugal n’affecte pas le montant de l’indemnité d’occupation due par le coïndivisaire, la haute juridiction casse le pourvoi sur ce point au visa de l’article 815-9 du Code civil.
La Cour de cassation affirme que le montant de l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux coïndivisaire peut faire l’objet d’une réduction. Les juges auraient dû rechercher si, en l’absence d’une contribution à l’entretien de l’enfant, la fixation de la résidence de l’enfant au domicile conjugal ne constituait pas une modalité de cette obligation d’entretien.
B. Aspects procéduraux et internationaux du divorce
1. Procédure
Cass. 1re civ. 11 juillet 2019 n° 17-31.091, publié au bulletin
Essentiel : Au visa des articles 1361, 1364 et 1375 du Code de procédure civile, le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas fait l’objet d’une désignation en justice.
En l’espèce, un jugement de divorce d’un couple a été prononcé, mais, sans surprise, des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
D’un point de vue procédural, la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt rendu le 27 octobre 2017, a condamné l’ex-épouse au versement d’une indemnité d’occupation pour avoir occupé le logement du ménage et a homologué l’état liquidatif établi par le notaire mandaté par l’ex-époux. En effet, la cour d’appel de Bordeaux relève que l’ex-épouse a eu la jouissance à titre privatif du bien indivis entre l’ordonnance de non-conciliation et la vente dudit bien. Plus justement, cette jouissance n’a aucunement été accordée à titre gratuit, de sorte que l’ex-conjointe est débitrice d’une indemnité d’occupation.
De son côté, après avoir formé un pourvoi en cassation, l’ex-épouse reproche à l’arrêt de la cour d’appel d’affirmer que celle-ci est débitrice d’une indemnité d’occupation sans véritablement rechercher si une telle occupation a causé une perte avérée de jouissance à l’indivision postcommunautaire pour l’occupation du logement. Surtout, l’ex-conjointe conteste fermement l’homologation de l’état liquidatif dans la mesure où le notaire n’a pas été désigné par le juge, mais par son ex-époux.
La haute juridiction doit répondre, sans détour, à la problématique juridique suivante : l’homologation d’un état liquidatif établi par un notaire mandaté par l’une des parties est-elle valable juridiquement ?
Dans son arrêt rendu le 11 juillet 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, seulement en ce qui concerne l’homologation de l’état liquidatif. Eu égard à la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du Code de procédure civile, le tribunal saisi d’une demande en partage n’a pas la faculté d’homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice. Voici une précision importante apportée par la haute juridiction sur un point procédural.
2. Demande reconventionnelle
Cass. 1re civ. 29 mai 2019 n° 18-18.338
Essentiel : La demande reconventionnelle fondée sur l’altération du lien conjugal et formée par la voie d’appel ne peut être recevable si la demande initiale s’avère être sur le fondement du divorce pour faute.
Dans les faits, une épouse a assigné son mari en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Le défendeur forme alors une demande reconventionnelle sur le même fondement, c’est-à‑dire les torts exclusifs de l’épouse.
Cependant, une fois l’appel interjeté, l’épouse maintient sa demande devant la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, alors que son mari souhaite faire prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
La décision de la cour d’appel fut de rejeter la première demande de l’épouse pour divorce aux torts exclusifs de son conjoint et a ainsi retenu que, la première demande étant rejetée, celle de l’époux pour altération du lien conjugal se trouvait être, automatiquement retenue.
La cour d’appel pouvait-elle retenir à bon droit la demande de l’époux, celle-ci ayant été modifiée une fois l’appel interjeté ?
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui retient que seules les demandes de modification encadrées par les articles 247 à 247-2 du Code civil peuvent être retenues en cours d’instance.
Le juge peut prononcer le divorce lorsqu’il existe un accord entre les époux et peut modifier le fondement du divorce. Cette modification au titre du divorce pour faute intervient lorsque la preuve de la faute est rapportée par le défenseur. À défaut, l’article 247-2 du Code civil prévoit que la demande initiale doit être maintenue, en l’espèce, il s’agit d’un divorce fondé sur l’altération définitive du lien conjugal.
La réponse de la Cour de cassation se trouve alors dans l’application de l’article 1077 du Code de procédure civile qui dispose qu’une « demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable ».
La réponse apportée est de valeur constante dans la jurisprudence : une telle demande ne peut être reçue si elle a été modifiée en cours d’instance.
Or, en recevant la demande de l’époux, la cour d’appel a violé les articles précédemment énoncés, la demande subsidiaire sur un autre fondement étant irrecevable. Attention toutefois, les textes cités sont antérieurs à la réforme du 13 mars 2019.
3. Droit international privé
Cass. 1re civ. 3 octobre 2019 n° 18-22945, non publié au bulletin
Essentiel : La loi applicable au régime matrimonial des époux mariés avant le 1er septembre 1992 sans contrat est celle de leur premier domicile matrimonial, stable et durable. Cette présomption ne saurait être mise à mal par des faits intervenus plus de 12 années après leur union.
En l’espèce, en 1982, deux personnes se sont mariées, sans contrat de mariage préalable, en Algérie. De cette union sont nés trois enfants. En 1995, les époux, installés en France, ont acquis la nationalité française. Malheureusement, les époux ont divorcé et des querelles se sont élevées quant à la détermination de leur régime matrimonial.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles considère que les époux ont, tout au long de leur mariage, établi leurs intérêts tant personnels que pécuniaires en France. À cet égard, les époux ont travaillé en France, ils ont élevé leurs trois enfants en France, ils ont pu acquérir des biens immobiliers en France et enfin, ils se sont toujours présentés, aux yeux des tiers, comme mariés sous le régime français de la communauté légale réduite aux acquêts. Les juges du fond déclarent que les époux ont eu, au moment de leur union, la volonté d’adopter le régime légal français et non celui de la séparation de biens prévue par la loi algérienne.
Par le présent arrêt, la haute juridiction nous offre une illustration rigoureuse et pragmatique des règles de droit international privé français de droit commun applicables aux époux mariés avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14/03/1978, soit le 1er septembre 1992.
La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant l’entrée en vigueur de ladite convention doit être faite en considération de la fixation du premier domicile matrimonial des époux. Cette présomption peut toutefois être détruite par tout autre élément de preuve pertinent. En l’espèce, les circonstances retenues par les juges du fond sont inopérantes pour révéler la volonté des époux de soumettre leur régime matrimonial à la loi française. Plus exactement, la haute juridiction considère que la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi algérienne eu égard à la fixation de leur premier domicile conjugal de manière stable et durable en Algérie. La première chambre civile se fonde sur le premier domicile matrimonial pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés avant le 1er septembre 1992.
La haute juridiction va encore plus loin en rappelant que la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés est fixée au jour du mariage. Dès lors, des présomptions tirées de faits ultérieurs à l’union peuvent, à terme, éclairer la volonté des époux au jour du mariage, mais sans pour autant aller jusqu’à remettre en cause la présomption simple de l’élection du premier domicile conjugal (en ce sens, Cour de cassation, 1re chambre civile, 5/11/1996 n° 94-21.603 et Cour de cassation, 1re chambre civile, 2/12/1997 n° 95 — 20 308).
En définitive, dans cet arrêt, la haute juridiction accorde une place prépondérante à l’indice fondé sur le premier domicile matrimonial des époux tout au long de cette quête de la volonté implicite des époux mariés sans contrat de mariage.
IV. Concubinage
Cass. 1re civ. 13 février 2019, n° 17-26.712
Essentiel : Dans le cadre d’un concubinage, la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation du bien qui doit être supportée proportionnellement au droit des indivisaires du bien. De même, les quotes-parts de propriété prévues ne résultent pas d’un financement effectif du bien, mais de ce qui a été prévu dans le titre d’acquisition. Enfin, une créance d’indemnisation ne peut être octroyée à un indivisaire, par l’indivision, en cas de dépense d’entretien du bien ; il faut nécessairement que la dépense ait permis d’améliorer ou de conserver le bien indivis.
Dans cette affaire, deux concubins ont acquis une maison d’habitation en indivision à concurrence de 30 % et 70 % inscrits sur le titre d’acquisition. Lors de la liquidation-partage de l’indivision, des oppositions sont survenues.
La question principale que devait se poser la première chambre civile de la Cour de cassation était de savoir si la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation du bien ou une dépense de la vie commune des concubins.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence du 10 septembre 2015 et considère que la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation du bien indivis et non une dépense de la vie commune des concubins qui serait liée à l’occupation privative du bien indivis comme le soutenait la requérante. Par conséquent, cette dépense doit être supportée par les indivisaires, et ce proportionnellement à leur droit dans l’indivision. Ainsi, une indemnité, due par l’indivision, doit être octroyée à l’égard du concubin.
Par ailleurs, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en ce que les juges du fond avaient retenu le financement effectif du bien pour fixer les quotes-parts de propriété à 18 % et 82 % et la fixation d’une créance d’indemnité au concubin ayant financé des travaux dans les biens indivis. En effet, les quotes‑parts de propriété doivent être appréciées au regard de ce qui avait été prévu dans l’acte d’acquisition du logement et non au regard du financement effectif. Ainsi, les parts de propriété retenues s’élèvent à 30 % et 70 % et correspondent alors à celles inscrites dans le titre d’acquisition. Enfin, la Cour de cassation rappelle qu’une indemnité due par l’indivision à un indivisaire ne peut être octroyée dans le cas de dépense d’entretien du bien. Les juges du fond auraient dû rechercher si les dépenses en question constituaient une dépense d’amélioration ou de conservation du bien, à défaut, les dépenses en question constituent des dépenses d’entretien. In fine, la Cour de cassation rappelle qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
V. Minorité
A. Autorité parentale
Cass. 1re civ. 26 juin 2019, n° 18-17.767 et n° 18-18.548
Essentiel : En matière de droit de visite et d’hébergement du beau-parent, l’intérêt de l’enfant prime. Lors de la séparation d’un couple de même sexe, l’ex-conjoint ou concubin qui n’est pas le parent biologique de l’enfant peut vouloir maintenir des relations avec lui. La Cour de cassation rejette les demandes formulées par les ex-conjoints portant sur l’établissement d’un droit de visite et d’hébergement au regard de circonstances appréciés in concreto.
B. Résidence de l’enfant
Cass. 1re civ. 19 septembre 2019, n° 18-18.200
Essentiel : Le juge doit donc, lorsqu’il statue sur les modalités du droit de visite d’un parent, utiliser la plénitude de son pouvoir et fixer un cadre clair, sans jamais déléguer ses prérogatives. Et pour cause, il en va de l’intérêt de l’enfant. La haute juridiction fait un utile rappel des obligations qui incombent au magistrat lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice du droit de visite d’un parent.
En l’espèce, l’arrêt du 19 septembre 2019 concerne la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement après le divorce des époux. La cour d’appel de Douai prévoit que le droit de visite s’exercera à l’amiable.
Faute de constatation d’un accord entre les parents, il incombe au juge de fixer lui-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement dû.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui interdit au juge toute délégation de son pouvoir en matière de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à un tiers.
VI. Filiation
Cass. assemblée plénière. 4 octobre 2019, n° 10-19053, Bulletin n° 648
En droit français, selon l’article 310-1 du Code civil, la filiation ne peut être établie que par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou la possession d’état. Elle peut encore l’être via un jugement, par le biais de l’adoption simple ou de l’adoption plénière. Pourtant, le droit français ne reconnaît pas les conventions de gestation pour autrui et la réalité qui en résulte est bien différente des attentes du législateur.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 4 octobre 2019, deux enfants sont nés à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui. Les actes de naissance étrangers désignent le père biologique et son épouse comme parents et sont transcrits par le consulat général de France. Le Procureur de la République a assigné les parents en annulation de cette transcription. Un jugement du 13 décembre 2005, puis un arrêt de cour d’appel de Paris le 25 octobre 2007, déclarent irrecevable son action, avant que la Cour de cassation ne vienne casser l’arrêt de cour d’appel. Par la suite, la transcription des actes de naissance est annulée, faisant l’objet d’un second pourvoi en cassation devant la haute juridiction qui suivra sa position initiale. Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour violation du droit au respect de la vie privée au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette dernière rend un avis consultatif à la demande de la Cour de cassation (CEDH, Avis consultatif relatif de la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention, 10 avril 2019). Ce n’est pas en statuant en droit que la Cour de cassation va casser l’arrêt de la cour d’appel de renvoi. En effet, afin d’assurer l’intérêt de la bonne administration de la justice et la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant, elle statue au fond.
Il s’agit de reconnaître la filiation de la « mère d’intention » lorsqu’une GPA est pratiquée à l’étranger. La Cour précise que celle-ci peut se faire par la voie de l’adoption. En l’espèce, la Cour de cassation prononce directement l’adoption dans cette affaire compte tenu de la longueur de la procédure. Il se déduit de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, que les circonstances de la naissance d’un enfant à l’étranger ne peuvent à elles seules faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance en ce qui concerne le père biologique, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention.
VII. Droit des successions et des libéralités
Cass. 1re civ. 29 mai 2019, n° 18-13.383
Le préambule du Règlement « Successions » du 4 juillet 2012 donne des clés au juge pour déterminer la résidence habituelle du défunt et permettre un rattachement à un État pour que celui-ci règle la succession du défunt. Il convient de se pencher sur cet arrêt qui est l’une des premières applications jurisprudentielles en la matière.
En l’espèce, une personne est décédée à New York en laissant trois enfants dont l’un d’eux était exhérédé par un testament. Ce dernier, arguant que son père avait sa résidence habituelle à Paris, a assigné ses collatéraux en partage de la succession. L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation qui, en application de l’article 4 du Règlement de 2012, a utilisé le critère de la résidence habituelle du défunt afin de déterminer la compétence des juridictions. Relevant que le défunt avait plus de liens avec les États-Unis, la Cour de cassation a statué en faveur d’une résidence habituelle aux États-Unis.
La Cour de cassation reste fidèle au Règlement « Successions » du 4 juillet 2012 en reprenant les considérants 23 et 24 du préambule. Elle rappelle les éléments à prendre en compte tels que les éléments de fait pertinents à la fin de la vie du de cujus comme la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné et les conditions et raisons de cette présence, le but étant de démontrer un lien étroit et stable avec cet État. Lorsque la détermination est plus délicate, il faut alors se pencher sur la nationalité du défunt ainsi que le lieu de situation de ses principaux biens qui constituent dans ce cas « un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait ». Pour décider que la dernière résidence habituelle du défunt était aux États-Unis, la Cour a relevé sa nationalité (américaine), ses lieux de naissance et de décès (les deux étant à New York), le lieu de situation de ses biens principaux (New York encore), l’endroit où se situent ses centres d’intérêt familiaux et sociaux (le défunt avait ses amis majoritairement aux États-Unis), son adresse fixe aux États-Unis et son domicile fiscal. Le raisonnement de la Cour de cassation est celui du Règlement du 4 juillet 2012, car les étapes sont exactement celles conseillées par les considérants 23 et 24.
L’enfant exhérédé avait soulevé un second moyen selon lequel le bien successoral localisé en France pouvait permettre d’asseoir la compétence du juge français. La Cour de cassation précise qu’il existe une exception en matière immobilière. Si des biens immobiliers se trouvent sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, alors il faudra appliquer la loi du for. Sur cette question, la Cour de cassation a suivi la cour d’appel de Paris en disant notamment « qu’en l’état actuel de la procédure, aucun bien immobilier appartenant au défunt n’est situé sur le territoire français ».
Il convient de relever que la solution apportée à de tels litiges n’est pas anodine. En effet, si les juges apprécient une résidence habituelle française, ce sont les règles du droit des successions françaises qui auront vocation à s’appliquer et donc la réserve héréditaire qui, il convient de le rappeler, n’existe pas dans tous les États (bien que ceux-ci disposent de leurs propres protections).