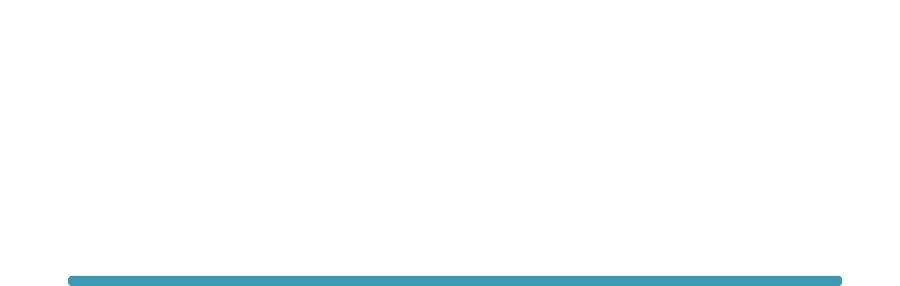Les mécanismes alternatifs de règlement des conflits sont aujourd’hui, sous le sigle MARC, une réalité procédurale de plus en plus ancrée en droit positif français, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au xxie siècle. Cette évolution invite à relire les fonctions que l’aveu peut revêtir dans la sphère pénale. S’il est un acte de langage visant à dévoiler un secret1 ou révéler une part d’intimité2, il revient, en droit, pour son auteur, à objectiver et juger sa faute, tout en assumant la responsabilité qui découle de sa commission3. D’un point de vue procédural, notre ensemble de règles accorde à l’aveu une primauté probante et répressive que l’on retrouve autant dans les modèles de type inquisitoire qu’accusatoire4. Mais peut-on aujourd’hui, à l’heure de la mise en place des M.A.R.C, restreindre la parole du coupable à la dimension principalement probante que la procédure lui reconnaît par tradition ?
Rappelons ici que dans beaucoup de sociétés, la parole fait partie intégrante de la gestion des conflits. L’aveu y est pacificateur et peut se manifester de deux façons ; lorsque la parole du coupable porte sur les faits, l’aveu se restreint à « oui je suis coupable » et s’enferme dans un rouage procédural uniquement probant, mais lorsque la parole intègre davantage l’être au processus judiciaire, l’aveu devient « oui je suis et me sens coupable ». Cette seconde démarche, fondée sur la subjectivité criminelle, s’inscrit dans ce que Michel Foucault a nommé la « véridiction du sujet » ; le jugement porte alors autant sur l’infraction que sur l’individu5. L’aveu peut donc aboutir à une vérité sur les faits, parfois couplée à une vérité sur l’être. Non pas parce que la première vérité est parfois incertaine, mais plus certainement parce que la seconde est plus riche, l’aveu devrait porter sur l’homme6. Notre procédure pénale française a aujourd’hui tendance à devenir mixte ; par le traitement du litige, elle accorde à l’aveu le rôle probant et répressif qu’elle lui a toujours reconnu, par les M.A.R.C, elle commence à intégrer l’être au processus de réparation. Derrière la simple preuve de culpabilité reconnue par le droit (I), l’aveu peut aussi dévoiler des vertus cathartiques que la justice restaurative reçoit avec pertinence (II). C’est là une pertinente avancée, mais elle encore en gestation7.
I. Connaître les faits : l’aveu, une preuve utopique au service d’une vérité judiciaire
Par la transformation d’un fait en droit, le jugement ne reflète qu’une vérité relative8 qui tend à s’éloigner de sa conception objective9. Elle n’est, en effet, que la solution que le juge offre au litige10, soit une « vérité socialement acceptable11 ». L’établissement de cette vérité judiciaire constitue la finalité des preuves auxquelles l’aveu se rallie naturellement. C’est parce qu’il embrasse une vérité simple et rapide là où, parfois, certains éléments probants avouent vite leurs limites qu’il demeure une preuve privilégiée (A). Mais parce que prouver signifie tout autant vérifier la véracité d’une accusation et la justifier12, il est nécessaire de décrypter une parole13 avant de lui accorder la valeur d’indice, de preuve ou de mensonge. Parce que l’aveu ne peut pas se suffire à lui-même, ces derniers doivent être corroborés par des éléments complémentaires pour être pertinents (B).
A. La certitude attachée à l’aveu : une preuve privilégiée
Qui mieux que son auteur pourrait connaître les détails d’une infraction commise ? C’est sur cette question oratoire que repose la valeur probante souvent attachée à l’aveu. La facilité et la rapidité14 qu’il permet dans l’enchaînement de l’enquête constituent sa réalité attractive. Dans la sphère judiciaire, l’interrogatoire est un moment propice à sa production, sinon à sa provocation. En confiant aux soins de Berne et de Lewin les rigueurs du discours médical, Jean Susini classa trois types d’interrogatoires15. Le premier, paisible et bienveillant, méconnu par la procédure française, peut déclencher une confession sincère. Le deuxième est au contraire plus angoissant et aboutirait à des aveux négociés. Le troisième, confusionnel et menaçant, provoquerait l’aveu suicidaire d’un accusé paniqué. En droit français, la recherche insistante de l’aveu inspire la métaphore du culte et se manifeste sous les deux derniers types d’interrogatoires.
Foucault releva que « depuis le Moyen-Âge (…), les sociétés occidentales ont placé l’aveu parmi les rituels majeurs dont on attend la production de vérité16 ». « L’aveu est la reine des preuves17 », a-t-il ainsi souvent été affirmé en droit ancien. Aux époques médiévale et moderne18, les accusés se laissaient souvent arracher, sous la question, l’aveu d’un crime reproché ou commis. Il y arriva parfois que l’innocent se désigne comme coupable sous les supplices, laissant alors une vérité dictée se substituer à la réalité des faits. Sous la plume de plusieurs juristes de la fin de l’Ancien Régime, la question est vite apparue comme l’un de ces égarements judiciaires qui n’emportent ni l’enthousiasme populaire ni l’assentiment unanime de la doctrine. Cette instrumentalisation de l’aveu fut écartée de la procédure pénale au seuil de la Révolution19. Pourtant, certaines dérives contemporaines rappellent à notre souvenir cette procédure violente que l’on recouvre aujourd’hui sous l’appellation de traitements inhumains et dégradants. Le socle de la torture judiciaire trouve son origine dans la philosophie de l’interrogatoire, laquelle se décline en trois versants : la vertu de la souffrance, la présomption de culpabilité pesant sur l’accusé et le culte de l’aveu20. Ce dernier en effet place la parole de l’accusé au rang des preuves privilégiées qu’il faut rechercher à tout prix. Il est dans la nature de l’interrogatoire judiciaire de provoquer l’aveu de l’accusé. Dans ce cadre parfois oppressant21 s’ouvre un véritable « combat rhétorique22 » ou « face-à-face inquisitorial23 » au cours duquel l’accusé et l’enquêteur s’affrontent. Dans cet entretien où les réponses de l’accusé se limitent au champ imposé par la question24, le discours devient presque inexistant. La succession d’acquiescements de l’accusé se substitue à son monologue et compose un aveu ou, plus précisément, des aveux25. L’interrogatoire tend à se réduire à une « relation technico-contractuelle26 » au sein de laquelle l’enquêteur contraint le suspect à accepter sa culpabilité. La ruse et l’affaiblissement de l’accusé sont des outils d’extorsion de l’aveu dont bien des enquêteurs peuvent être familiers. Interroger quelqu’un, on le sait, c’est avant tout exercer un pouvoir27. Lorsque l’accusé renonce à poursuivre l’affrontement verbal au cours de ce processus agonistique, son aveu vient interrompre la mécanique de l’accusation28 : ubi major, minor cessat29, affirme l’adage.
Entre le Moi et ce que Jean Susini nomme la « conduite d’aveu », il y a un intermédiaire : la personnalité30. La manifestation de l’aveu dépend toujours de cette dernière. En se fondant sur le diagramme structural du psychiatre Éric Berne31 et sur les travaux du criminologue Jean Pinatel, Jean Susini a isolé trois organes psychiques ou états du Moi communs à toute personne : le parent (sentiments proches de ceux d’une figure familiale), l’adulte (sentiments proches de la réalité habituelle) et l’enfant (sentiments proches des traces qu’a pu laisser une enfance). Le passage à l’acte d’aveu est dicté par l’un de ces états du Moi, sans que son auteur en ait conscience32. Par exemple, l’égocentrisme pourrait déclencher un aveu, tantôt par masochisme, tantôt par défi ou par jeu. Ici, le Moi enfant avouerait. Si l’auteur de cette théorie psycho‑judiciaire de l’aveu exige de son lecteur qu’il la reçoive avec prudence, il n’est pas erroné de préciser que la psychologie occupe, au cours de l’interrogatoire, une place première dans la manifestation de l’aveu.
Mais interroger quelqu’un, c’est avant tout exercer un pouvoir pouvant conduire à un déséquilibre de l’échange ; l’accusé et l’accusateur peuvent s’y affronter à armes inégales33.
Depuis 1670, le législateur accorde progressivement des droits à la défense34. Véritable « moment de pression intégré dans un processus de répression35 », l’interrogatoire connaît quelques entraves à la production de l’aveu par la reconnaissance des droits de l’accusé, souvent réaffirmés et parfois controversés en raison des nécessités de l’enquête, qui visent à le protéger au cours des auditions36. Au cours d’un interrogatoire, l’accusé peut adopter une position stratégique, fondée sur le droit à l’assistance d’un avocat37 et au silence, visant à organiser son discours. Face à l’interrogateur, l’accusé dispose de trois alternatives38 : répondre par l’affirmative (aveu), répondre par la négative (contestation) ou se taire (silence). Le dernier choix peut poser un problème d’interprétation ; les hésitations et le bafouillage de l’accusé peuvent être interprétés comme des affirmations veules ou encore des négations hésitantes. Là réside par exemple toute l’ambiguïté de l’interjection « hum » dont la définition reste celle du doute signalé à l’interlocuteur. Toutefois, cet aveu par le silence reste exceptionnel39. Le droit au silence40, lui, est un droit au mutisme complet. Si fâcheux qu’il puisse être pour l’enquêteur, il reste l’arme la plus précieuse de l’accusé. Dans ces échanges où les questions alternent avec les réponses, le silence devient une impasse. L’interrogateur s’en retrouve démuni et l’accusé protégé. Sa réticence choisie à l’égard de la parole n’a pas toujours trouvé écho dans le droit. En effet, deux approches parfaitement antithétiques permettent d’appréhender le silence de l’interrogé au cours de l’interrogatoire. La première consisterait pour l’accusateur à voir dans le comportement de l’accusé un « refus douteux de se défendre41 ». L’individu, alors avare de mots, se protégerait contre l’acte répréhensible qu’il a commis et qui, par là même, serait susceptible d’établir sa culpabilité. La seconde approche, bien plus protectrice des droits de la défense, consisterait en un droit dont tout accusé puisse bénéficier : le droit de se taire. L’existence de ce droit vient appuyer l’idée selon laquelle la justice « ne doit pas se confondre avec une machine à extorquer la parole42 ». L’exercice du droit au silence constitue ainsi un refus absolu de coopération de l’accusé. Bien que le silence déçoive l’interrogateur43, ce dernier ne doit pas en déduire un aveu implicite de culpabilité. Mais de là, se mesure non seulement la déloyauté de l’échange visant à la recherche de la vérité, mais aussi, et de façon plus pertinente, l’aversion possible des enquêteurs à l’égard du silence de l’accusé. L’étude des arrêts démontre que le silence de l’accusé peut lui être défavorable dès lors qu’il existe à son encontre des éléments suffisamment sérieux qu’il devrait pouvoir expliquer, mais dont il tait les renseignements44. Le silence est ainsi laissé à la libre appréciation du juge45. Le droit au silence, que sa mise en œuvre soit ou non conseillée par l’avocat, démontre ô combien les remparts contre l’extorsion de l’aveu sont nécessaires dans la procédure pénale. En tant que preuve, l’aveu ne peut pas se suffire à lui-même. Si l’accusé peut avouer, le juge peut ne pas le croire. Douter. Là est la seule façon de trier les aveux pour aboutir à la vérité la plus pacificatrice possible.
B. Le doute attaché à l’aveu : une preuve menacée
« Le doute est un hommage que l’on rend à la vérité46 », affirmait Renan. L’erreur judiciaire, démontrée par l’Histoire et combattue par d’illustres défenseurs de la justice auxquels s’associe volontiers le nom de Voltaire47, est un dysfonctionnement ponctuel du système judiciaire. La recherche effrénée de l’aveu s’égare ainsi parfois sur les chemins de l’injustice, suscitant alors une vive émotion populaire et doctrinale. Mode de preuve fragile, l’aveu peut être mensonger. Il est des cas où un individu participe pleinement à l’établissement de sa culpabilité en s’appropriant une infraction qu’il n’a pas commise. L’acte d’avouer découle ici d’une stratégie, réfléchie ou instinctive, dont la finalité prime le châtiment attaché à la culpabilité. « Mentir, c’est parler ou agir contre ce que l’on croit être la vérité, dans le but de tromper son prochain48 ». En justice, comme ailleurs, l’homme est enclin à mentir.
Le faux aveu est une auto-accusation mensongère qui répond davantage au souhait de persuader qu’à celui de respecter la vérité49. C’est en cela que nous pouvons parler d’aveu rhétorique. Cette fausse déclaration, réfléchie ou instinctive, présente une certaine complexité. Diverses raisons y conduisent. Tout d’abord, le criminel fascine ; entre attirance et aversion, cet attrait est fortement ancré dans la presse. Si, dès le xvie siècle, cette médiatisation occidentale a eu pour finalité de sensibiliser la population à la criminalité afin de l’en dissuader, il n’en reste pas moins que cette exposition traduit une culture de la tragédie et du sensationnel. Le criminel imaginaire, fasciné par ce rôle, est alors enclin à s’approprier une infraction qu’il n’a pas commise50. L’alcoolique51 ou l’alcoolisé, que l’effronterie conduirait à s’accuser, s’inscrit dans une démarche ludique similaire. Par ailleurs, l’innocent sujet à la peur52 de l’interrogatoire peut avouer une infraction dont il n’est pas l’auteur. Les suspects accordent fréquemment une attention bien plus marquée aux conséquences immédiates de l’aveu qu’à ses répercussions ultérieures53. Cela est particulièrement vrai s’agissant du recours à la torture ; les mauvais traitements sont au service de l’aveu, plus qu’à celui de la vérité54. Dans un cadre plus paisible, avoueront également ceux qui tiennent à faire part de leur propre conception de la vérité. Qualifiable de semi-mensonge ou d’aveux partiels, cette pratique consiste en un arrangement personnel de l’auteur de l’infraction avec la réalité des faits. Son aveu résulte d’une stratégie prédéfinie lui permettant d’amoindrir les charges pesant contre lui. L’amour et la haine, deux passions isolées par Kant55, sont également susceptibles de dicter un faux aveu ; pour protéger un coupable, l’aveu devient sacrificiel56 et pour désigner complice l’être détesté57, l’aveu devient vindicatoire. Dans d’autres cas, bien plus rares, l’accusé peut se convaincre de sa culpabilité par l’intermédiaire des faux souvenirs ; les éléments suggérés par l’interrogatoire peuvent trouver écho dans l’imaginaire de l’accusé. Ce dernier, en se projetant dans une situation recréée, va alors construire sa culpabilité58.
Moins rare que le mensonge sincère est certainement l’aveu négocié, profondément ancré dans la culture occidentale. Parce qu’en avouant le coupable accepte par avance une sanction, l’incitation à avouer revient à introduire un mécanisme de récompenses – principalement sous la forme de remise ou de diminution de peine – ayant pour objet le service qu’il rend à la justice. Sans pour autant affirmer que le droit pénal français et la procédure qui l’accompagne sont devenus utilitaires en raison de considérations ici hors de propos, les mesures de déjudiciarisation du droit processuel en ouvrent le chemin59. Mais n’est-ce pas là un moyen de faciliter l’aveu60 en permettant à l’accusé de s’abandonner au calcul de ses intérêts ? La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – soit la CRPC – en est un exemple. Introduite par la loi du 9 mars 2004, cette procédure permet au procureur de la République de proposer une peine à un individu avouant la commission d’un délit sans en ouvrir les poursuites. L’homologation de l’accord par le juge reste une garantie nécessaire du contrôle de la qualité de l’aveu. L’innocent, quelque peu craintif, pourrait être tenté d’être condamné à une peine de moindre ampleur que celle qu’il encourrait si les poursuites étaient ouvertes par le ministère public. Cette dérive potentielle pourrait également s’accentuer si la proposition de CRPC intervenait au cours de la garde à vue et bien avant que l’officier de police judiciaire n’ait reçu les aveux du coupable61.
La transparence des moments de production de l’aveu est nécessaire pour lutter contre son extorsion. Deux outils se sont avérés pertinents dans ce domaine : le procès-verbal et la captation audiovisuelle. Unique trace, mais trace essentielle de l’interrogatoire, le procès-verbal en demeure le reflet ; « verba volent, scripta manent62 » affirme l’adage. Couchés sur papier, les dires de l’accusé y seront conservés. Comme l’expose Monsieur Roussel, « dans la froide technique de la procédure, les procès-verbaux ont une âme, l’âme de ceux ayant vécu les évènements souvent tragiques qu’ils décrivent63 ». La transcription de l’échange n’est pas pour autant entièrement fidèle à la réalité des dires. Ces derniers sont, à bien des égards, altérés par la reformulation des paroles peu compréhensibles de l’accusé. Bien que le rédacteur s’efforce d’en conserver le sens, le langage fonctionnel se substitue au langage personnel64 et à l’attitude verbale de l’accusé65. C’est à ces lacunes que l’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire66 semble pouvoir remédier. Si ce procédé propose une garantie supplémentaire des droits de l’accusé, l’inhérente dramaturgie attachée au support s’oppose à une réception neutre de la parole. Cette dernière emporte l’observateur de l’image au moment même de son action. L’image est alors trahison en ce qu’elle substitue l’analyste au témoin de la scène. Cette transformation du rôle du juge peut alors influencer sa décision : la rupture temporelle causée par un retour en arrière pourrait évincer la prise en compte de l’évolution de la personnalité du coupable et son éventuelle prise de conscience67. Ces mécanismes de transparence de l’aveu ne sont pas encore optimaux, mais aspirent à mieux contrôler68 la production d’aveux judiciaires. Seule la transparence de l’interaction est admise en droit français. Jugés déloyaux en raison de leur caractère arbitraire, le polygraphe, l’hypnose, les narcoses et les neurosciences sont rejetés69. Attester le mensonge de manière scientifique reste le dessein ambitieux auquel aspire la justice pénale. Y voir un rempart pertinent et absolu relèverait du scientisme, non de la science.
Devant ces difficultés d’encadrement de la parole de l’accusé, nous nous demandons si l’aveu peut encore être qualifié de preuve. L’aveu étant provisoire, l’anticipation définitive sur la culpabilité étant prohibée, l’avouant ne renonce pas à la présomption d’innocence. Pourtant, il semble marquer le passage du statut de présumé innocent à celui de présumé coupable70. En nous fondant sur l’étude du professeur Caire71, nous pouvons à plus forte raison émettre l’hypothèse qu’il s’agirait d’une présomption-preuve, soit d’une conviction. Fondée sur des probabilités, cette dernière appelle le doute dans une prise de décision judiciaire. Si l’accusé peut mentir, son interlocuteur peut ne pas le croire72. L’aveu ne peut se suffire à lui-même parce que sa corroboration est essentielle. À bien y réfléchir et malgré les dispositions de l’article 428 du Code de procédure pénale73, l’aveu semble davantage être une présomption de culpabilité qu’une preuve. Mais il peut aussi être perçu comme « révélateur du sujet le formulant74 ». Nous sortons ici du cadre strict du litige pour apaiser les heurts humains ; l’aveu devient cathartique. C’est là notamment toute la pertinence des MARC.
II. Comprendre l’être : une parole cathartique au service de la gestion des conflits
L’aveu, en tant que « démarche critique à l’égard de soi-même », prend parfois les traits d’une confession en public75. Il n’a de sens que dans l’intersubjectivité ; il n’existe que s’il est reçu. Sur l’échelle temporelle, deux dimensions lui sont conférées. L’une porte sur le temps objectif (la durée de l’acte), l’autre sur le temps subjectif. Ce dernier, liant l’aveu au temps imaginaire des interlocuteurs, est bien plus long76. Ce temps subjectif est celui des représentations de l’avouant et des récepteurs77 : l’aveu marque les esprits. Le récit ainsi dépeint par le coupable s’adresse à un auditoire : assistance, magistrats, victimes. Cependant, « l’acte d’avouer change de nature en fonction de la personne devant laquelle on avoue78 ». Si les juges recherchent une preuve, la victime souhaite la reconnaissance de sa souffrance. Le prétoire lui offre la possibilité d’appréhender la personnalité criminelle et personnelle de son agresseur par un face-à-face contraint, certes source de « violence institutionnelle79 » en raison des liens les unissant, mais inexorablement source d’espoir de régénération des deux parties. Voilà qui laisse supposer le sens de l’aveu dans la gestion du conflit. D’abord parole confiée (A), puis parole reçue (B), l’aveu cathartique n’est rien d’autre que la conversion des détresses en paroles.
A. La parole confiée
En vérité, l’aveu est toujours déclenché. Si ce ne sont pas les représentants de l’autorité qui le provoquent, c’est l’avouant lui-même qui entend se condamner. À plus juste raison, si l’aveu peut être dicté par la peur, l’aveu-confession l’est par l’angoisse. Selon Jean-Paul Sartre, la peur est une appréhension ponctuelle portant sur une chose déterminée alors que l’angoisse jaillit de la liberté, du choix à faire parmi les multiples possibilités offertes à l’homme80. Pour l’avouant, la peur devient celle de l’interrogatoire et des mauvais traitements qui parfois l’accompagnent, et l’angoisse est celle de son existence, de son sort, de son reflet.
Le rituel de la confession publique est attesté en Occident à certaines hautes périodes. Dans l’Église primitive81, l’exomologèse liturgique en tant que « rituel pénitentiel collectif82 », dans sa forme aboutie, consistait pour le pénitent à reconnaître publiquement les péchés dont il était l’auteur83. Seules étaient concernées les fautes publiques84, non les inconduites secrètes. Dans l’Occident féodal, les aveux pénitentiels se confondaient parfois avec les aveux judiciaires dans le déroulement des ordalies. Véritable jugement de Dieu, ces épreuves judiciaires consistaient à déclarer l’accusé coupable ou innocent. Lors de la messe qui précédait l’ordalie, le prêtre exigeait des accusés de ne pas se rendre à l’autel s’ils sont coupables85. Si la faute reprochée est celle d’un vol, une confession publique pouvait lui être imposée. Un lien étroit se tisse entre l’aveu pénitentiel et l’aveu judiciaire qui se justifie ici par la nécessité de retrouver l’objet dérobé86.
Cette conception a toutefois évolué en Occident, marquant alors un tournant important dans la mise en œuvre du déclenchement judiciaire de l’aveu qui passe d’une parole publique à une parole privée par la mise en place de la confession auriculaire87. Le rapport entre soi et la vérité qu’engendre la confession est un rapport nouveau ; s’adressant à autrui, la vérité prend les traits d’un discours88. La manifestation de cette mauvaise conscience permettait d’obtenir le pardon divin transmis par la parole sacramentelle d’absolution du prêtre. Cette pratique a pour noble dessein d’élever l’homme à la « pratique du bien89 ». C’est à ce titre que Chateaubriand, écrivain et homme politique aux enthousiasmes successifs, avait affirmé dans son œuvre apologétique que « jamais les lois ne remplaceront la moralité d’une telle coutume90 ». L’intérêt porté à l’examen de conscience, au discours sur soi et à cette intimité révélée trouve ainsi sa source dans le caractère longtemps obligatoire de la confession auriculaire91. L’aveu a permis de « progresser vers une meilleure connaissance de l’âme humaine et une plus grande efficacité dans l’action92 ».
Enfermé dans sa faute et convaincu de la nécessité d’en souffrir, le coupable va parfois subir son remords en entretenant le souvenir de l’infraction commise et des dommages qu’elle a causés. Cette destruction de soi par soi devient une obsession93. De cet « état douloureux d’anéantissement de tous les espoirs94 », le passé s’éternise au point d’en être l’avenir du coupable. À l’inverse du remords, le repentir offre la possibilité de guérir sa propre âme95. Là où le coupable sujet au remords s’accable du mal, le repentir le combat. C’est en cela qu’il se comporte en juge96 et se manifeste, selon Fichte, par une « conscience de l’effort continu de l’humanité en moi 97». Ces deux sentiments peuvent tout autant s’extérioriser dans l’aveu. Ce dernier déculpabilise98 et permet de sortir de la solitude de sa faute. Acte d’humilité et d’humiliation, il est « une parole que l’homme prononce sur lui-même99 ». Bergson a soutenu que l’aveu du criminel lui permet d’exister au sein d’une société. En effet, cette dernière, lorsqu’elle ignore le crime commis, ne reconnaît pas le coupable dans sa vérité100. Ce dernier peut alors ressentir un besoin impérieux d’exister en se reconnaissant fautif. Son aveu n’est plus strictement juridique et devient personnel101. En tant que « découverte tragique de soi102 », il opère inexorablement une rupture biographique103 née de la prise de conscience du drame. L’avouant s’expose devant un tribunal qui, selon les mots empruntés à Ricœur, prend l’apparence d’« une métaphore de la conscience morale104 ». Le récit qu’il va y dépeindre ne porte pas moins sur les faits que sur sa personne et ses sentiments. Ces deniers révèlent « la manière dont le Moi est affecté105 ». Couplée à la volonté de souffrir, la reconnaissance de l’infraction contribue à amplifier l’expérience de la faute106. En acceptant la sanction attachée à l’infraction commise, l’avouant démontre son désir d’expiation. Sa parole peut alors être reçue.
B. La parole reçue
En justice, l’aveu est toujours celui du mal. Perçu comme un véritable récit de soi, il permet une ouverture sur la personnalité délinquante du coupable. De cette brèche intime ressort ainsi le reflet du coupable, tel que le perçoit le récepteur de l’aveu. Le contrevenant s’avoue alors au juge, au policier, à la victime, à ses proches, aux membres de la société. Dans cette interaction, les deux consciences (celle de l’avouant et celle du récepteur) ont vocation à se manifester. Elles vont à la rencontre de « leur être vrai107 ». Unis par cette intersubjectivité, les deux protagonistes se lient autour de ce moment rare qu’est l’expérience de l’autre.
Le prétoire occidental est en partie assimilable à un théâtre108. La scène judiciaire fait de l’accusé le héros momentané d’un débat décisionnel ; il va devoir répondre aux questions qui lui seront posées, et par là même, justifier son acte109. Depuis le milieu du xixe siècle, la parole du coupable est davantage sollicitée pour comprendre les mobiles de l’acte, son déroulement et les émotions qui l’ont accompagné110. « L’aveu est un soulagement pour tous111 ». Que le juge médiéval, de conscience chrétienne, eût des devoirs envers Dieu ou que le juge contemporain rende la justice au nom du peuple français, sa mission, pour être loyalement remplie, se doit de contourner l’écueil de l’erreur judiciaire. Permettant ainsi de libérer les cas de conscience, l’aveu ne cesse de procurer une entière satisfaction. De plus, les liens qui unissent la victime au coupable dans le prétoire relèvent de ceux qui les ont unis le temps de l’infraction. À travers les aveux, la gestion du conflit se pacifie. « Merci », murmura un jour une victime dans un palais de justice112 ; l’aveu de culpabilité de son agresseur, couplé à une demande en pardon, l’avait soulagée. C’est une même philosophie que l’on redécouvre aujourd’hui et dans laquelle l’aveu s’insère pleinement.
Premier pas vers la réhabilitation, l’aveu est une promesse de conversion efficace des maux en parole lorsqu’il est reçu par la justice restaurative. Le postulat selon lequel la répression appelle la condamnation a désormais flétri ; les MARC ne visent pas tous à la répression113. Cette forme de gestion des conflits ouvre surtout la voie de la pacification de toutes les répulsions dont le cœur humain est capable. Le droit français a découvert les vertus de la justice restaurative à travers la médiation pénale. Ce mécanisme procédural peut désormais s’ouvrir lorsque l’auteur d’une infraction en reconnaît la commission. Elle est susceptible de prendre deux formes : l’une est pré-sentencielle, l’autre post‑sentencielle. La première se manifeste dans le droit positif français sous les traits d’une procédure alternative aux poursuites ne concernant que des infractions de moyenne gravité. La seconde a vocation à intervenir à l’issue du jugement dans le cadre d’un travail sur le conflit. Fortement influencée par son usage canadien, cette médiation peut notamment se traduire par une rencontre entre la victime et le détenu au cours de laquelle seront abordées les répercussions morales de l’infraction. D’un recours encore discret en France, la rencontre entre la victime et le détenu a lieu bien après le procès et permet de rompre avec les rôles dits du bourreau et de la victime114. Au cours d’un entretien dirigé par un médiateur, le coupable et sa victime abordent ensemble les heurts qui les unissent. La vérité avouée par le coupable, la reconnaissance de sa responsabilité et sa volonté de réparer le préjudice subi vont permettre à la victime d’obtenir les réponses aux questions qui la tourmentent. De cette rencontre entre une personne que le hasard a voulu victime et un individu que la vie a rendu coupable, l’aveu occupe une place nouvelle. D’une part, il permet à la victime d’approcher la personnalité criminelle du coupable, et d’autre part de mieux traiter les émotions que ce dernier porte sur la commission de l’infraction. Par cette rencontre volontaire, la victime et le coupable vont pouvoir faire l’expérience du mal d’autrui : celui que la victime s’est vu infliger et celui que ressent le coupable par introspection. Une telle démarche nécessite une reconnaissance sincère par le coupable des actes commis. Le recours à la parole au sein de cette rencontre dépasse le cadre de l’infraction et aspire à la pacification des relations115. Cette nouvelle place accordée à l’aveu tend à se résumer en une question unissant la victime et le coupable : que peut-on faire pour « se réparer ensemble116 » ? La médiation pénale peut ainsi ouvrir la voie aussi éventuelle qu’ambitieuse du pardon. Ce dernier n’est bien évidemment pas systématique ; il n’est pas un dû, mais un don117. Paul Ricœur a ainsi enseigné que « l’équation de l’aveu » a pour élément constitutif une dissymétrie entre la bassesse de l’infraction et la hauteur du pardon, formant ainsi une « force invisible » les unissant118. Mais si le pardon ne pouvait être accordé au coupable par la victime, ce binôme aura tout au moins pu comprendre les contours de l’infraction et les conséquences qui l’accompagnèrent. Rien n’inspire mieux la pacification des rapports humains que la conversion des maux en parole. « Tout comprendre rend très indulgent119 », avait affirmé un personnage de Staël… Par le prisme de l’aveu, la médiation permet une véritable gestion post-sententielle du conflit.
L’aveu, on le sait, n’a de sens que s’il est reçu. Dans certains cas, il le sera trop tard. Une étude des lettres d’adieu de détenus montre ainsi l’anéantissement des espoirs. De cette douleur, il ne restera parfois qu’une phrase d’aveu : « Voler pour vivre » ou encore « Je suis un minable à qui la chance, l’argent et le bonheur ne m’ont jamais souri120 », ont alors écrit ceux qui ont regretté la faute à laquelle ils ont attaché leur existence. Ces coupables ont alors trouvé dans la mort le plus inviolable asile. On voit ici se dessiner toute l’importance de la dissociation de l’être et de la faute commise. Si le pardon est l’objectif presque utopique de la justice restaurative, il reste une ligne de conduite intéressante et, surtout, une promesse de résoudre le conflit sans se restreindre à la reconstitution de la réalité des faits litigieux. C’est en prenant conscience de l’innocence des victimes que les hommes se moralisent121, a affirmé le philosophe. René Girard a peut-être raison…
« N’avouez jamais122 », est-il parfois conseillé… L’aveu, provoqué au cours de l’interrogatoire, se heurte parfois aux mauvais traitements, aux mensonges et aux erreurs judiciaires. Le revers du culte de l’aveu désenchante considérablement à la lumière de l’Histoire, et encore de celle du Présent. Ces égarements judiciaires conduisent à recommander un recours parcimonieux et contrôlé de la preuve par la simple reconnaissance des faits. Pour le moment, l’usage recommandé pourrait se résumer en ce vers emprunté à La Fontaine : « Il est bon de parler, et meilleur de se taire123 ». Mais parce que l’aveu a pour universelle fonction de retrouver l’harmonie sociale, il ne saurait se voir évincer de la procédure pénale124. Il est parfois admis que le réduire à sa dimension probante revient à « refouler sa précieuse sève125 ». C’est à cette conviction que notre étude s’est ralliée. À bien y réfléchir, seul le cumul des fonctions probante et cathartique permet d’accorder à l’aveu la pertinence qu’il mérite dans le processus judiciaire. L’échange entre l’homme que la vie a rendu coupable et celui que le hasard a voulu victime conserve toutes ses promesses de pacification des répulsions dont le cœur est capable. Et si cette parole ne peut parfois suffire à pardonner, elle a tout au moins la pertinence d’intégrer davantage l’être au processus de jugement. Son aveu, dévoilant son histoire, n’est autre que sa volonté de vivre au sein d’une société, en tant qu’homme et parmi eux. C’est en cela que l’aveu est bien plus qu’une preuve.