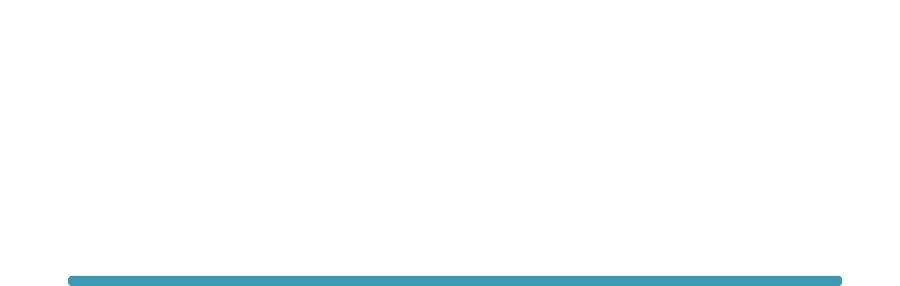Très impressionné et très honoré d’avoir été invité à m’exprimer, au nom de la philosophie, immédiatement après cette conférence d’introduction à une journée consacrée par de savants juristes aux biens communs, je n’oserai faire davantage que rappeler, au moyen de quelques distinctions simples, ce qu’on entend par ce « bien commun » (bonum commune), devenu, depuis peu, l’objet d’une constante préoccupation même chez les politiques, qui ne l’invoquent, il est vrai, pas toujours en connaissance de cause.
C’est l’ordination des biens communs (les communia, tels que les désigne déjà Cicéron) au bien commun qui se trouve interrogée ici : il s’agit d’abord de savoir si la nécessité de cette ordination est un fait, de telle façon que les biens communs se définissent à partir du bien commun qui en est alors la fin et la règle, ou bien si elle désigne quelque chose qui reste à accomplir, de telle sorte qu’on en cherche les moyens ; il se peut, à cet égard, que l’ambition d’ordonner les biens communs au bien commun exige de profondes réformes dans les conceptions à l’œuvre. Réfléchir au bien commun, notion éminemment politique, c’est réfléchir à ce qui est à ce point la condition de la paix que beaucoup voient dans l’un et l’autre les deux noms d’une même chose.
Sans doute il peut facilement sembler que l’idée même des biens communs est immédiatement dérivée de celle du bien commun ; comment, en effet, les biens communs ne seraient-ils pas en tant que tels ordonnés au bien commun, puisqu’ils sont communs ? Ne tiennent-ils pas leur communauté de cette ordination elle-même ?
C’est une idée très répandue, selon laquelle tout ce qui est utile à tout le monde constitue le bien commun comme tel, qu’on définit, par suite, le plus souvent : l’ensemble des conditions du bien-être général. Mais une telle acception méconnaît ce qu’est le bien commun, qu’elle subordonne au bien-être, en le réduisant à ses moyens matériels et institutionnels ; mais encore, elle ne voit pas que ce n’est pas en un même sens qu’on dit « bien » en parlant du bien commun, et des biens communs. L’écart de sens ne tient d’ailleurs pas essentiellement à l’écart de nombre, entre singulier et pluriel : si un bien commun n’est pas le bien commun, c’est parce que ce sont des réalités de natures différentes. Ce n’est sans doute pas non plus en un même sens qu’on dit « commun » dans l’un et l’autre cas.
D’une façon générale, le bien est ce que tout être recherche pour lui-même ; le bien a fondamentalement rang de fin : tout ce que nous identifions comme un bien nous y voyons une fin, et il n’est pas de fin que nous poursuivions en laquelle nous ne voyions un certain bien.
Maintenant, que tous aient en commun de rechercher le bien ne signifie pas qu’il soit nécessairement commun : c’est d’abord son bien propre que recherche tout être, qui tend naturellement à sa conservation et son bien-être. À la suite, on appelle un bien ce qui est propice au bien, en est l’instrument ou le moyen ; chacun regarde ainsi ce qu’il acquiert et possède comme son bien : c’est en tant même qu’il y trouve son utilité qu’il se l’approprie et le déclare son bien.
C’est à partir de cette notion que sont pensés, négativement, les biens communs : choses utiles et inappropriables, parce que leur utilité s’étend uniformément à tous. Elles sont donc déclarées la propriété d’aucun en particulier, c’est-à-dire de tous indifféremment dès là que tous y ont (ou doivent avoir) un accès immédiat et inconditionnel, puisqu’il s’agit pour chacun de ce qui lui revient dans la mesure du besoin naturel qu’il en a, en principe égal à celui de tout autre, pour sa santé ou l’épanouissement de ses facultés ; et c’est dans cette exacte proportion que chacun est tenu d’en disposer pour lui-même, un peu comme de la liberté, dont on dit qu’elle s’arrête, pour chacun, là où commence celle des autres.
Les biens communs sont donc des biens extérieurs, sinon toujours matériels : ils sont autre chose que ce qu’Aristote désigne le bien d’un être qui consiste dans la perfection de sa nature, dont les communia sont plutôt les moyens ou instruments : ce qui est propice à la santé peut être déclaré un bien commun puisque tous aspirent légitimement à bien se porter. Mais dire que la santé elle-même est un bien commun, c’est dire qu’elle est pour chacun son bien propre, que tous ont en commun de rechercher chacun pour soi. À cet égard c’est davantage le besoin qui est commun, semble-t-il, que le bien qui y répond : tout ce en quoi nous voyons des biens par le bénéfice qu’on en tire pour la santé n’a rang de fin que de façon secondaire ; fin subordonnée à un bien supérieur dont il faut convenir qu’il est appréhendé comme un bien singulier avant de l’être comme un bien universel. Les biens communs, biens extérieurs, instruments et moyens du bien de chacun, ne sont donc communs que de manière extrinsèque ou relative, d’une communauté qui n’est celle des biens en question qu’en tant qu’elle est d’abord celle des besoins que chacun éprouve et cherche à satisfaire pour soi-même.
Nous tomberons d’accord sur le fait qu’un bien qui n’est qu’extrinsèquement commun, commun de manière dérivée, c’est-à-dire qui tient sa communauté d’autre chose que de sa nature de bien, n’est pas vraiment commun. On a donc raison quand on dit que l’ensemble des conditions du bien-être général ne suffit pas à définir le bien authentiquement commun ; ces conditions, qu’on regarde comme autant de biens d’autant plus précieux qu’ils s’étendent au besoin de tous, assurent si peu le bien commun proprement dit qu’il suffit de les cultiver pour elles-mêmes pour entraîner la société tout entière dans l’égoïsme le plus agressif.
*
En quelle sorte de bien consiste donc le bien commun, auquel on entend subordonner l’usage des biens extérieurs nécessaires à tous ?
Si, comme nous l’avons dit, le bien est pour tout être sa fin, il n’est pour tout être de bien plus véritable que d’être parfaitement ce qu’il est, c’est-à-dire d’être pleinement ce à quoi le dispose sa nature. Le bien a originairement rang de fin parce que toute chose recherche naturellement sa perfection. C’est, par conséquent, la nature même de ce dont on considère le bien qui est principe de ce bien. La question du bien commun se trouve ainsi suspendue à celle de la nature de l’homme.
Maintenant, il est vrai qu’un bien est d’autant plus grand, absolument parlant, qu’il s’étend à un plus grand nombre : c’est-à-dire, puisque c’est par la notion de fin que se définit le bien, qu’un bien est d’autant plus un bien qu’il est une fin pour un plus grand nombre, fin commune à un plus grand nombre. Si important que soit pour chacun son bien particulier, il ne s’étend, en tant que tel, qu’à lui-même, et le bien privé du prince n’est pas plus grand que celui de son écuyer puisqu’il n’est rien de plus que le bien d’un seul.
Il est vrai que l’appétit suit la connaissance. Les êtres recherchent le bien à proportion de l’appréhension qu’ils en ont : l’animal, dont la connaissance est bornée aux sensations, ne connaît véritablement que son bien singulier, qui est tout ce à quoi il aspire : ce n’est pas par altruisme qu’il répugne à quitter le troupeau, ou par ascèse qu’il vit solitaire.
L’homme, remarque Aristote, a la faculté d’appréhender des biens plus élevés que lui, et de les aimer davantage que lui-même. La vérité est un grand bien dès là que tout homme étant doué de raison, tous sont aptes à la connaître ; elle s’étend donc à tout homme absolument, en tant qu’elle est fin de l’intelligence.
Le bien est donc diffusif de soi per modum finis, il se communique par mode de finalité ; et le bien commun diffère du bien particulier en ce qu’il est à portée de l’appétit d’un plus grand nombre. Sa communauté elle-même est antérieure aux particuliers comme la fin est antérieure à ce dont elle est la fin : si un seul aimait la vérité, elle n’en serait pas moins un bien commun, car la communauté du bien commun ne dépend pas de l’appétit qu’on en a, mais de son amabilité intrinsèque.
Corollairement, le bien commun n’est aimé pour lui-même que s’il est aimé dans sa communicabilité : non pas, ici encore, selon qu’il est communiqué à plusieurs, car ce serait faire des autres la mesure de la bonté du bien commun, c’est-à-dire du bien particulier la raison d’amabilité du bien commun. N’y eût-il qu’un seul bienheureux, la béatitude céleste n’en serait pas moins le plus grand bien commun, observe saint Thomas d’Aquin, car Dieu est fin de toute chose, et c’est par leur seul refus que les hommes se privent de Paradis. Ce bienheureux aimerait donc la béatitude céleste dont il serait seul à jouir non pas comme un bien privé, à lui seul communiqué, il l’aimerait dans son incommensurabilité même au bien particulier, c’est-à-dire dans l’infinité de son amabilité.
Encore un exemple. L’amour de sa mère est d’autant plus adorable à l’enfant qu’il le voit s’étendre à ses frères et sœurs, jusqu’à ceux qu’il n’a pas encore ; il l’aime dans cette surabondance même qui lui rend aimable tout ce que touche cet amour.
C’est en tant même qu’il est antérieur dans son universalité que le bien commun est principe d’unité : ce que nous appelons une communauté, c’est, ni plus ni moins, au sens strict, une certaine union par la raison d’un bien dont chacun voit qu’il est plus aimable que son bien particulier, et qu’il est le principe même de son bien particulier.
La communauté politique est la communauté parfaite, dit encore Aristote, parce qu’elle seule, par le nombre de ses membres et la diversité de leurs activités, comporte les moyens de sa suffisance, tandis que la famille et les autres communautés (les métiers eux-mêmes) dépendent d’elle pour le bien de leurs membres. Le bien commun de la cité est donc plus aimable pour chacun que son bien singulier en tant que la cité réalise plus parfaitement la nature d’homme que ne le peut l’individu par lui-même ; et l’on peut dire que la cité elle-même est en quelque sorte plus humaine que l’individu pris séparément. Le bien de la famille ou de la nation est ainsi meilleur pour chacun des particuliers qui y participent, non parce que chacun y trouve son bien singulier, mais parce que pour chacun il est aussi le bien des autres : nul ne le veut pour soi seul, car chacun ne se connaît de plus grand bien que celui de sa nature d’homme, par laquelle il aspire à la communauté de ses semblables.
Si le bien commun n’était pas le plus grand bien du singulier, raison de ce que le singulier est à lui-même un certain bien, il serait faux de dire que l’homme est naturellement social et politique ; nul ne peut sensément prétendre, en effet, que son plus grand bien est dans l’indépendance radicale vis-à-vis de ses semblables ; le bien commun est donc le bien propre de l’homme selon sa nature d’homme, dont dépend tout ce que chacun est pour lui-même.
Il est encore, et par là même, principe de l’amitié qui lie les membres de la communauté entre eux, qui tendent naturellement à s’opposer sous le rapport de leur bien particulier pris en tant que tel : ce que chacun désire pour soi-même, il peut, bien sûr, le vouloir aussi pour les autres, mais il n’est pas intrinsèquement nécessaire au désir qu’il en a pour lui-même qu’il s’étende jusqu’aux autres ; ce que je veux pour moi c’est pour moi que je le veux, et si vous et moi voulons la même chose, le Ciel fasse qu’il y en ait assez pour tous.
Je ne peux vouloir un bien pour les autres en tant que je le veux pour moi-même que si j’ordonne mon bien privé au bien commun.
Dès l’instant où les hommes ne sont plus liés entre eux par un bien commun qu’ils aiment comme leur plus grand bien, et que l’amitié qu’ils se prêtent n’a plus sa raison dans leur amour du bien commun, c’est pour lui-même exclusivement que chacun exige d’être aimé, comme une fin en soi, dans sa singularité même prise comme unique et insubstituable. Lorsque les communautés humaines ne sont plus ordonnées au bien commun, elles se disloquent. Ce qu’on appelle alors « bien commun » n’est qu’un idéal factice et la communauté est seulement virtuelle.
Si nous prenons l’exemple d’une bande de brigands, c’est à tort qu’on dirait que le butin leur est un bien commun, puisqu’une fois partagé ils se séparent ; et cependant qu’ils le détiennent « en commun », ils n’ont vraiment en commun que le désir de l’accaparer chacun pour soi et la crainte des autres qui les arrête.
Stricto sensu, le butin (bien extérieur s’il en est) est le bien de tous, bien extrinsèquement commun ; et une telle communauté n’est une communauté que par analogie, si ce n’est par abus de langage.
Les biens extérieurs s’ils sont communs le sont donc de manière extrinsèque ou relative. Tous en ont besoin, mais chacun les recherche pour soi. À ce qui est déclaré ou reconnu un bien commun, chacun doit avoir un accès immédiat pour lui-même, puisque cela appartient en commun à l’un et à l’autre, c’est‑à‑dire à personne en particulier. Cet accès étendu à l’ensemble des membres d’une société, tout au plus obtient-on le bien de tous qui n’est que la somme des biens particuliers. Mais que tout le monde soit content ne fait pas une société heureuse si chacun ne l’est qu’à l’écart des autres.
*
En somme, il semble que la question de l’ordination des biens communs au bien commun soit entièrement dépendante de l’idée qu’on se fait du bien commun, c’est-à-dire de l’homme lui-même et de sa place dans la société.
Ce que révèle le fait qu’on envisage l’ordination des biens communs au bien commun comme problème, c’est la difficulté qu’il y a, originairement, à regarder les biens universellement nécessaires comme effectivement communs ; autrement dit, ce n’est pas parce que tous ont besoin d’eau ou des rivages que l’eau et les rivages sont nécessairement par tous regardés comme des biens communs.
Si l’on parle d’une nécessaire ordination des biens répondant aux besoins les plus universels au bien commun, c’est-à-dire au bien tel qu’il est incommensurable au bien particulier (et sa condition même), c’est que la notion même de biens communs ne trouve de sens qu’à partir de l’intuition qu’il y a un bonum commune ; mais si l’on se contente d’y voir le bien de tous, on condamne les biens universellement nécessaires à n’être jamais vraiment regardés comme communs.
En réalité, le passage de la communauté naturelle du besoin à la communauté du bien qui y répond est philosophico-juridique :
Cicéron (De Off.) est convaincu que tout le produit de la terre est créé pour l’usage des hommes ; il en infère, pour ainsi dire, que les hommes ont naturellement vocation à s’entraider ; et pour cela, à mettre en commun leurs intérêts, leur travail et leurs ressources afin d’unir la société entre tous les hommes (c’est-à-dire à l’échelle de l’humanité). Mais il place au principe de ce devoir l’usage honnête et loyal de la raison, c’est-à-dire qu’il fonde l’effectivité de la communauté des biens sur une morale, ce qui implique une certaine conception de l’homme et des devoirs qui lui reviennent étant ce qu’il est par nature.
D’autre part, le caractère inappropriable du bien répondant au besoin universel ressortit, lui, au droit. Il n’est en effet que la loi pour interdire au plus fort d’accaparer ce dont il est le plus avide.
Mais le passage du besoin commun aux biens communs ne constitue pas encore l’ordination des biens communs au bien commun. Ordonner c’est subordonner : la fin est supérieure en dignité à ce dont elle est la fin. C’est à la fin poursuivie que se prend la règle de l’action ; en ce sens, la fin est la mesure de ce dont elle fixe l’ordre, et comme telle, on l’a vu, antérieure à ce dont elle est la fin.
Or la loi elle-même, qui prescrit l’ordre dans les actes, est originairement l’expression d’une certaine conception de l’homme et de la vocation de la société vis-à-vis de ses membres ; la loi obéit à des principes qu’elle illustre, et qui ne sont pas de nature juridique, mais anthropologique et philosophique. Ce qu’il faut considérer chez Cicéron, c’est le principe qui fonde la nécessité de l’honnêteté, c’est-à-dire de la vertu complète dans les rapports des hommes entre eux.
Cicéron est l’héritier d’Aristote, on le sait : or si l’homme est conçu comme politique par nature, le passage de la communauté des besoins à celle des biens se fait pour ainsi dire spontanément, puisqu’Aristote définit justement le politique par l’ordination au bien commun. C’est ainsi que l’homme est seul parmi les animaux à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l’injuste, et des autres notions morales, et c’est la communauté de ces sentiments qui engendre la famille et la cité (Pol. I).
La cité est donc un fait de nature. Elle est antérieure à la famille et à chacun de nous pris individuellement ; le tout, en effet, est nécessairement antérieur à la partie, puisque le corps entier une fois détruit, il n’y a plus ni pied ni main… (Pol. I).
Pour ceux qui ne veulent rien voir dans l’homme que sa liberté, qu’ils placent au fondement même de son humanité, la société ne peut être un bien que négativement, puisqu’elle est, de fait, un mal nécessaire : pour ceux-là, tout ordre antérieur à la liberté de l’homme est contraire à cette liberté et offense la dignité de l’homme.
La liberté ainsi conçue comme origine de l’homme dans l’homme l’est nécessairement comme liberté individuelle ; et cela a pour conséquence que l’homme est pensé, en fait et en droit, antérieur à la société, et la société comme un biais rendu nécessaire par les insuffisances naturelles de l’homme qui reste originairement indépendant de tout ordre dont il n’est pas la source et le principe.
Les conceptions contractualistes de l’ordre social subordonnent systématiquement le bien commun au bien particulier.
L’homme naturel de Jean-Jacques Rousseau est solitaire, occupé à son seul bien singulier. S’il est capable de pitié, ce n’est pas qu’il incline au bien : il ignore le mal, mais il ignore aussi le bien. Il est complètement dépourvu d’idées. L’homme dans son état de nature, l’homme vrai, n’est pas un être raisonnable, il n’a pas la faculté de juger, il est innocent, livré par la Nature au seul instinct.
La bonté (innocence) de l’homme de Rousseau est donc pure indifférence, il ne distingue que le plaisir et la douleur. S’il répugne à la souffrance de son semblable, c’est par une pitié dont les bêtes mêmes, dit Rousseau… donnent quelquefois des signes sensibles ; sitôt qu’il côtoie les autres de façon habituelle, cette pitié naturelle disparaît : apprenant à réfléchir et à comparer, il devient inéluctablement mauvais, corrompu (Disc. 1753, I).
La société bonne (libérée des inégalités) est donc celle où l’homme se trouve réconcilié avec sa première nature qui était le meilleur de l’homme et dont il n’a dû sortir que par quelque funeste hasard qui pour l’utilité commune eût dû ne jamais arriver. L’authentique utilité commune au genre humain n’est donc pas dans la société politique, mais dans l’indifférence naturelle des uns aux autres et de tous au bien, à tout bien, c’est-à-dire et à plus forte raison, au bien commun.
Quoi qu’on en pense, le contrat social engendre la société individualiste : dès l’instant où l’unité du tout dépend du consentement des parties, c’est le bien de la partie qui préside à celui du tout ; le tout n’est alors plus rien d’essentiel à la partie, mais une simple commodité ou le moyen d’augmenter sa jouissance d’en être indépendante. La société est là pour permettre à chacun de jouir de ses droits, développer ses facultés comme bon lui semble, sans nuire à autrui, suivant les termes, fameux, de Benjamin Constant.
Les biens communs peuvent être déclarés communs, ils ne le sont que dans la mesure où chacun convient de ne pas empiéter sur la liberté des autres ; on peut encore déclarer les biens communs ordonnés au bien commun, il ne peut s’agir que du bien de tous. Et si la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres, comment prévenir que, chacun étant l’autre de chaque autre, il n’en tire que sa liberté commence là où s’arrête celle des autres ? Par quel prodige chaque liberté étant ordonnée à elle-même se limiterait-elle librement ?
Dès là que la société repose tout entière sur la primauté du bien particulier, de la liberté individuelle source et fin de l’ordre politique, la loi n’a d’autre vocation que de garantir à chacun le droit à l’épanouissement personnel.
La loi n’est plus là telle que la pense Aristote, pour inciter à l’amour du bien commun. Le fondement du droit étant la liberté subjective, il suffit qu’augmente le nombre de ceux qui aspirent à ce qui nuit aux autres (ou à tous) pour que change l’idée qu’on se fait de l’intérêt général, et par suite la règle du droit.
*
Il n’est pas douteux qu’il faille ordonner au bien commun les biens qui répondent aux besoins les plus universels, puisqu’à défaut ils ne seront jamais vraiment regardés comme communs. Mais si on les ordonne au bien de tous seulement, c’est au bien privé qu’on les ordonne en réalité, et il s’en trouve toujours quelques-uns pour accaparer ce qu’on a rêvé commun.
Or le bien commun authentiquement commun ne se conçoit que suivant ce à quoi ceux dont il est le bien commun ont vocation par nature ; si l’on néglige ou refuse ce que sont les choses par leur nature, on cède vite aux fantaisies des idéologies.
C’est au politique que revient la gestion des biens communs. On ne voit pas comment les ordonner au bien commun sans y ordonner d’abord le politique.
Je vous remercie de votre patience.