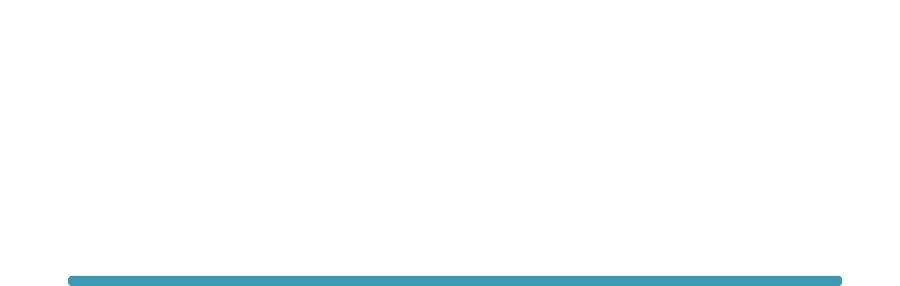Bossuet a prononcé en 1663 au séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnet un panégyrique de sainte Catherine d’Alexandrie, patronne des philosophes. Au deuxième point de son sermon, l’évêque de Meaux présente ainsi le statut de la vérité :
La vérité est un bien commun : quiconque la possède, la doit à ses frères selon les occasions que Dieu lui présente et quiconque se veut rendre propre ce bien public de la nature raisonnable, alors celui-là mérite bien de le perdre et d’être réduit, selon saint Augustin, à ce qui est véritablement le propre de l’esprit de l’homme, c’est-à-dire le mensonge et l’erreur1.
Bossuet se réfère ici aux Confessions de saint Augustin, qui, à la fin du ive siècle soulignait au chapitre 25 du livre 12 :
Les amants de la vérité vivent d’un commun patrimoine. Et c’est pourquoi, Seigneur, vos jugements sont redoutables ; car votre vérité n’est ni à moi, ni à lui, ni à tel autre ; elle est à nous tous, que votre voix appelle hautement à sa communion, avec la terrible menace d’en être privés à jamais, si nous voulons en faire notre bien privé. Celui qui prétend s’attribuer en propre l’héritage dont vous avez mis la jouissance en commun, et revendique comme son bien le pécule universel, celui-là est bientôt réduit de ce fonds social à son propre fonds, c’est-à-dire de la vérité au mensonge.
Et Saint Augustin de rappeler l’évangéliste « celui qui professe le mensonge parle de son propre fonds » (Jean, 8, 44).
Cette idée de la vérité comme patrimoine commun chez Saint Augustin renvoie à l’évidence à une notion déjà bien connue des Romains, l’existence des res communis, avec cette originalité chez Saint Augustin qu’à l’image de Cicéron qui avait assuré le passage de l’agricola à la cultura animi, qui nous donnera la culture, la connaissance de la vérité, fondement de la culture, relève de la chose commune. La chose commune, matérielle ou immatérielle, est celle qui appartient à tous et que nul n’a le droit de s’approprier, par exemple en installant des clôtures, c’est-à-dire en privant son voisin d’en jouir. Pendant des siècles l’histoire des communs a surtout mis l’accent sur les choses matérielles. Les communaux désignaient justement au Moyen Âge ces terres sans clôtures sur lesquelles les villageois avaient un droit d’utilisation reconnu. Ivan Illich, dans une conférence célèbre prononcée à Tokyo en 1982, Silence is a commons, propose la définition suivante des communs :
Les communaux sont ces parties de l’environnement à l’égard desquelles le droit coutumier imposait des formes particulières de respect communautaire. Le droit des communaux réglemente le droit de passage, le droit de pêcher, de faire paître les bêtes, de ramasser du bois et des plantes médicinales dans la forêt. Lorsque les gens parlaient des communaux, ils désignaient un aspect de l’environnement qui était limité, nécessaire à la survie de la communauté, nécessaire de différentes façons à différents groupes, mais qui, au sens strictement économique, n’était pas perçu comme rare2.
L’on doit à Karl Polanyi d’avoir rappelé dans son ouvrage de 1944, La Grande Transformation, l’histoire – alors largement oubliée – des enclosures agricoles, mouvement général en Europe entre le xvie et le xviiie siècle et qui a vu la plupart des terrains communaux, jusque-là librement utilisables par les habitants d’une commune, appropriés (enclos) par de grands propriétaires fonciers. Cette capture des communaux (les commons) par un cycle de développement du capitalisme qui est apparu d’abord en Angleterre est à la source de la révolution industrielle par la mise en œuvre d’un modèle d’agriculture plus productiviste, alors très destructeur socialement. Le biologiste Hardin a remis sur le devant de la scène scientifique la question de l’enclosure des communs dans son article de 1968, The tragedy of the commons, affirmant que c’est le régime de propriété, public ou privé, qui représente la solution optimale au problème écologique de la préservation des ressources naturelles. Il avait alors pris pour appuyer sa démonstration l’exemple d’un pâturage laissé en libre accès sur lequel chaque berger veut maximiser la consommation de son troupeau, ce type de comportement conduisant à l’extinction des ressources. Comme le souligne Allaire, « la tradition néoclassique situe la question de l’“efficacité” dans l’utilisation des ressources dans une alternative entre la propriété privée et l’État, s’agissant tant des ressources naturelles que des ressources intellectuelles (propriété intellectuelle versus domaine public). Il revient notamment à Elinor Ostrom, Prix Nobel d’économie 2009, et à l’école des communs d’avoir déplacé la question de l’efficacité. L’efficacité ne tient pas au régime de propriété, mais aux formes de gouvernement des ressources et à des capacités collectives, comme le montre l’analyse du fonctionnement des communs. C’est une rupture épistémologique.3 »
Cependant, si les communs peuvent être naturels et matériels, ils peuvent aussi être immatériels : des connaissances et des œuvres du patrimoine culturel par exemple. Or c’est à partir du début des années 2000 qu’Ostrom a orienté avec Hess ses recherches dans une nouvelle direction en abordant la question des connaissances communes4. Hess et Ostrom ont ainsi proposé une nouvelle conception de la connaissance comme une ressource informationnelle partagée gérée par un système de gouvernance collective. Plusieurs penseurs comme Aigrain5 et Moullier Boutang6 ont analysé la révolution du capitalisme informationnel que nous vivons par une nouvelle capture des communaux : les biens communs de la connaissance, c’est-à-dire aussi bien le code génétique des espèces vivantes, que les ondes radio, ou le spectre électromagnétique pour transmettre de la musique et des informations, les connaissances et les œuvres culturelles ou le code numérique contenu dans un logiciel, sont transformés en ressources par les entreprises de la nouvelle économie de la connaissance. Bomsel7 avait relevé quant à lui que la grande entreprise américaine Google avait créé depuis vingt ans un véritable marché des mots de toutes les langues en proposant aux enchères sur son moteur de recherche des « mots clés ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ses fondateurs ont renommé la société mère de leur moteur de recherche « Alphabet » en 2015. Ainsi, ce qui était le plus commun à l’homme, la langue, est devenue ressource. Les fondateurs de Google l’affirment, le langage qui au cœur de son outil de recherche n’est qu’une innovation de l’humanité que l’on peut exploiter. Les langues humaines, que l’UNESCO a inscrites au patrimoine commun de l’humanité, ne constituent alors plus qu’un ensemble de signes échangeables sur des marchés mondialisés. Les pouvoirs publics européens n’ont toujours pas su anticiper la vitesse avec laquelle ce capitalisme informationnel bouleverserait le paysage des œuvres et du patrimoine culturel. À la faveur d’accords juridiques souvent léonins, et sans toujours respecter les droits d’auteurs et les droits des éditeurs, de grands groupes technologiques ont numérisé depuis le début des années 2000 plusieurs millions d’ouvrages, tous issus des plus grandes bibliothèques américaines et européennes. Bénéficiant de l’exclusivité de leur indexation et de leur exploitation commerciale en ligne, ces entreprises ont ainsi constitué d’importantes bibliothèques numériques privées tout en restreignant les droits des bibliothèques publiques d’exploiter en ligne des ouvrages appartenant pourtant au domaine public. Comme l’y appelle en France le rapport Tessier sur la numérisation du patrimoine écrit paru en 2010, l’État devrait plus que jamais « relever le défi de la protection, de la conservation et de la mise à disposition de tous de la connaissance et du patrimoine culturel à travers des technologies de l’information et de la communication, et face aux intérêts particuliers ». Il s’agit ici de préciser le rapport que les institutions publiques doivent entretenir avec les nouvelles technologies pour préserver la finalité de leur mission de service public. Les stratégies publiques comme privées de numérisation et de diffusion du patrimoine culturel font en effet l’objet de vives critiques de la part des défenseurs des biens communs ai sein de la société civile. Ces nouveaux communs de la connaissance diffusés en ligne ne risquent-ils pas d’être finalement capturés par de grandes firmes capitalistes qui pourront en exploiter la valeur à leur seul profit ? Au-delà de cette seule analyse économique, un problème plus large se pose qui est celui de la finalité vers laquelle se dirige la société de l’information lorsqu’elle procède à la transformation des biens communs de la connaissance en informations numériques par les organisations publiques comme privées, par exemple par le processus de dématérialisation du patrimoine culturel.
Deux exemples relatifs à la numérisation du patrimoine culturel quand ce processus a pour objet de créer de nouveaux communs sur le web peuvent être cités. En premier lieu, le rapport que le numérique entretient avec la finalité et le sens des missions des institutions culturelles impliquées dans ces projets de numérisation. En second lieu, le type de connaissance et de culture réellement produit et la place de l’homme dans ce processus. Nous soulignerons ces deux aspects à partir des résultats d’études de cas que nous avons conduites pendant notre thèse de doctorat8 dans trois villes dans lesquelles les pouvoirs publics locaux ont voulu diffuser sous la forme de communs un patrimoine culturel numérisé.
I. Le passage au numérique du patrimoine culturel sous la forme de communs de la connaissance
De nombreuses institutions culturelles sont aujourd’hui en voie de transformation digitale : leurs œuvres sont numérisées sous la forme de données culturelles qui ont vocation à être diffusées sur le web qui est le plus grand système de ressources informationnelles au monde. Dans ce système, la numérisation du tableau de la Joconde, d’un morceau de musique de Mozart ou d’un poème de Victor Hugo, sont d’abord des données traitées sous une forme binaire par des machines informatiques. L’opération de codage effectuée, il n’y a plus de distinction technique entre œuvre et information numérique : cette dernière obéit à la structure logique de ce système de ressources. L’adaptation à ce système par les acteurs de la culture est proposée par le Guide Data Culture du ministère de la Culture et de la Communication en France publié en 2013. Le Ministère signale dans ce guide le nouveau rôle des institutions culturelles : celles-ci deviennent des « producteurs de données ». On relève ainsi que « l’activité administrative doit tout entière être repensée dans l’optique d’une diffusion future, en optant notamment pour des formats ouverts et lisibles par la machine. » Cette stratégie est adaptée au monde de l’Internet dans lequel la donnée est l’unité de base. Il est ainsi logique que les données culturelles soient subordonnées à une bonne « culture de la donnée » pour que le système puisse l’interpréter (qualité et interopérabilité des données sont alors essentielles). L’aboutissement de cette orientation est l’entreprise conjointe du Ministère et de la Fondation Wikimédia autour du projet Wikidata : construire un graphe unique de connaissances interprétables par les humains comme par les machines qui accomplirait enfin le projet d’une connaissance universelle, unique et univoque, parce que régulée automatiquement par la machine. Ce naturalisme informationnel entraine la perte de sens que provoque la transformation des œuvres culturelles en données numériques : tout y est décomposé. Des métadonnées peuvent décrire les œuvres, mais chaque élément est réutilisable indépendamment d’un autre. Un acteur du projet de numérisation du Muséum de Toulouse rapporte par exemple le phénomène suivant : « on a une tombe ici qui est la tombe de Téviec, qui est magnifique, mondialement connue, et j’avais fait la photographie du crâne d’une de ces deux dames dans cette tombe. L’autre jour, un monsieur s’est immolé par le feu dans la cour d’un lycée de Toulouse, et bien, pour illustrer ça, les journalistes sur le web ont mis la photo du crâne de Téviec sans sa légende. Ne me demandez pas pourquoi, mais c’est comme ça. Ce sont des détournements d’œuvres qui ne vont pas forcément là où l’attendait ». Le savoir n’est ainsi plus contextualisé et les « œuvres » peuvent circuler, être réutilisées ou « remixées » pour n’importe quelle raison avec un sens parfois très éloigné de celui voulu initialement par son créateur. La connaissance se situe désormais dans l’ordinateur et les réseaux : avec un temps de retard, les représentations sociales en prennent acte.
II. Les flux d’informations mis en réseau créent un nouveau type de connaissance et de culture
Le patrimoine culturel transformé en simples données culturelles à l’heure d’Internet, le management public des institutions culturelles est conduit à focaliser les acteurs sur la production de ces nouveaux biens immatériels et la gouvernance des systèmes de gestion de ces ressources informationnelles. Les biens communs ne sont plus des biens à l’ère de l’information numérique et des réseaux. Il n’y a plus que des flux d’informations. Broca et Coriat9 ont montré en ce sens que puisque l’information est un bien non rival, « les barrières, notamment légales, empêchant certaines personnes d’y accéder sont considérées comme inutiles et artificielles. Cette libre circulation de l’information est un facteur éminemment favorable à son enrichissement continu ». Les hommes essaient de réguler l’accès à ces flux et leur « alimentation ». Ils le font en conformité ou non avec la logique du système technique qu’ils ont créé. Mais ces flux d’information ne sauraient accroître leur liberté. La croissance de ces flux témoigne simplement de leur capacité de coopération avec les autres membres du système dans lequel ils sont connectés les uns avec les autres et avec lesquels ils passent leur temps à échanger des données qu’ils produisent grâce à des dispositifs numériques. Ce qui devient indispensable pour les hommes adaptés à ce système, c’est la connaissance de ce changement constant qu’il génère, la découverte des nouvelles règles du jeu imposées par la technique. Ce qui aboutit à la création d’une nouvelle culture. Dans cette transformation en cours, le monde de l’ancienne culture (analogique) représente un réservoir potentiellement immense, mais non inépuisable, de ressources, et le saut dans le numérique n’est pas seulement quantitatif, il est avant tout qualitatif et affecte la nature même des connaissances et de la culture et surtout de la nature de l’homme lui-même. Comme le souligne Ellul10, « le monde est codé et transformé en flux d’informations par l’intermédiaire des machines », aussi la condition sine qua non pour que l’homme puisse être adapté et adaptable à ce nouveau monde, c’est qu’il devienne lui-même producteur de données grâce au Web. La nouvelle culture est celle de la technique, par conséquent, dans ce nouveau paradigme, l’homme cultivé est l’homme adapté au système technicien. D’où l’érosion de la mémoire vivante, de l’intelligence et de la culture authentiques.