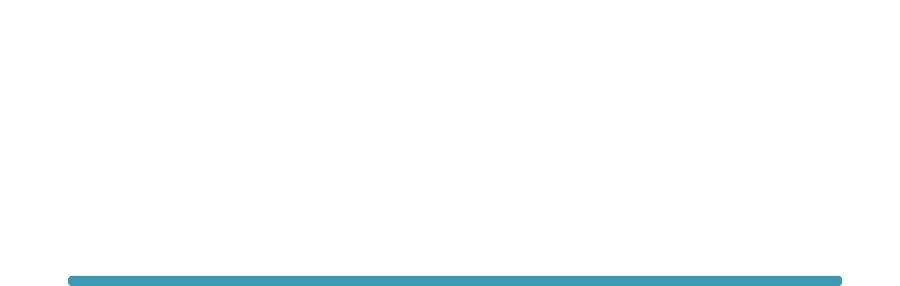« L’accord que le monde manifeste, il le tient de la proportion géométrique ; et les rapports instaurés par cette proportion lui apportent l’amitié. »1
« Remarquable sagesse ! Ils privent l’univers de soleil, semble-t-il, ceux qui privent la vie d’amitié : les dieux immortels n’ont rien mis de meilleur qu’elle en notre possession, rien de plus agréable. »2
« Quelles autres stratégies locales de contestation du “naturel” pourraient nous conduire à dénaturaliser le genre en tant que tel ? »3
Introduction : l’amitié ou l’oubliée du commun
Le célèbre ouvrage d’Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs, ne comporte qu’une seule mention d’Aristote ; elle apparaît très rapidement, dès la page 15, et s’inscrit dans un développement non pas consacré au Stagirite, mais à la « tragédie des biens communs » selon le titre d’un article de Garrett Hardin paru dans la revue Science en 19684. Le passage en question concerne le Livre II des Politiques lors duquel Aristote prononce une critique du communisme de son maître ; cette option ne s’avère en effet pas tenable dans la mesure où l’homme tend à mieux s’occuper de ce qui lui est propre et à délaisser ce qui est commun. Cette référence d’Ostrom à Aristote, coupée de l’ensemble du corpus aristotélicien en général et de ce bien commun qui constitue la clef de voûte de la science architectonique qu’est la politique en particulier, témoigne de l’ancrage exclusivement moderne et économique de l’auteur : on ne sera donc guère surpris de retrouver parmi les courants théoriques mobilisés la théorie des jeux, la logique de l’action collective, la rationalité limitée, l’institution pensée comme auto-organisation, la gouvernance, liste qui ne prétend pas à l’exhaustivité bien sûr. Cette approche souffre néanmoins d’un défaut logique rédhibitoire : à vouloir gouverner les biens communs au pluriel, on s’en trouve réduit à dégager des classifications et des typologies à partir de critères techniques, mouvement dans lequel on laisse dans l’ombre la signification des termes utilisés. C’est la raison pour laquelle Pierre Dardot et Christian Laval, platoniciens malgré eux, affirment que les travaux d’Elinor Ostrom « doivent être dépassés par une théorie non pas des communs, mais du commun »5.
C’est donc en toute logique que les deux auteurs marxistes visent à établir, dès le premier chapitre de leur ouvrage, une archéologie du commun qui débute, après l’exposition de l’étymologie du terme, par la doctrine aristotélicienne avant de se poursuivre par un balayage de l’histoire de la philosophie du point de vue de la notion concernée. Dardot et Laval se réfèrent tout d’abord aux Politiques pour rappeler que « ce sont les citoyens qui délibèrent en commun pour déterminer ce qui convient pour la cité et ce qu’il est juste de faire »6. Ils poursuivent, convoquant cette fois-ci le livre IX de l’Éthique à Nicomaque, en affirmant que « “vivre ensemble” […] c’est produire, par la délibération et la législation, des mœurs semblables et des règles de vie s’appliquant à tous ceux qui poursuivent une même fin »7. Or, cette dernière citation renvoie à la note de bas de page n° 4 qui concerne l’amitié que je reproduis ici in extenso :
Il est significatif que la philia comme amitié civique soit conçue par Aristote comme l’effet affectif de la participation à une même activité et non comme une communauté affective réalisée par une stricte hiérarchie de fonctions (comme c’est le cas pour la communauté platonicienne, où l’amitié ne peut que se « diluer », cf. Aristote, Les Politiques, p. 1488).
Pourquoi prendre le temps de citer cette note de bas de page ? Il se trouve qu’elle constitue la première référence à l’amitié, à la philia, de l’ouvrage de Dardot et Laval qui la mentionnent à l’autre bout de leur travail, au moment de leur première proposition politique qui s’intitule « Il faut construire une politique du commun ». Les auteurs se réfèrent à l’expérience antique de la démocratie, « lié [é] à ce que depuis les Grecs on appelle la justice et l’amitié ».
Voici donc tout le paradoxe : alors que l’amitié semble une pièce primordiale de leur dispositif, Dardot et Laval ne lui consacrent pourtant aucun développement significatif, se contentant d’avancer sans justification qu’elle serait la conséquence de l’activité délibérative. Et pour cause, nous semble-t-il : l’amitié, comme expérience concrète et privilégiée du proche, pourrait bien s’inscrire en faux contre l’internationalisme des auteurs.
Nous souhaitons par conséquent dans ce travail pousser l’archéologie du commun, entamée par Dardot et Laval, jusque et y compris dans ses strates les plus reculées, c’est-à-dire préaristotéliciennes. Nous y observerons alors l’ajointement cosmique, politique et éthique qui lie indéfectiblement amitié, justice et commun jusqu’à ce que l’idée se fasse jour, avec Jacques Derrida, que l’on peut « penser et vivre l’amitié, le propre ou l’essentiel de l’amitié, sans la moindre référence à l’être aimé, plus généralement à l’aimable »9. Nous mettrons également en exergue que la désinstitutionnalisation de l’amitié, c’est-à-dire sa sortie de la sphère publique et sa privatisation, eut pour conséquence son instrumentalisation au service d’une rationalité managériale réduite à son versant instrumental.
I. De l’être comme communauté à la transcendance du bien
Le premier ouvrage connu traitant à part entière de l’amitié comme question philosophique se trouve être le Lysis de Platon. Dans ce dialogue de jeunesse, Socrate converse avec Ménexène puis avec son ami Lysis dans le coin d’un gymnase. La discussion se focalise dans un premier temps sur l’identification de l’ami : qui au juste peut être qualifié d’« ami » ? L’être aimant ou l’être aimé ? Mais l’on peut aimer et en retour être haï, de même que l’on peut haïr une personne qui nous aime ! Sans approfondir cette nécessité de la bienveillance réciproque dont dépend l’amitié, Socrate juge la question aporétique et décide de changer d’orientation : c’est alors le fondement même de l’amitié qui se trouve interrogé. Deux traditions philosophiques et populaires se trouvent passées au crible de son doute. D’une part, il se pourrait que le semblable attire le semblable et qu’ainsi des personnes aux caractères relativement proches ou similaires nouent plus facilement des liens amicaux. Telle est la thèse que Socrate attribue à Empédocle. Une telle thèse, toutefois, ne résiste pas à la contradiction, car « le méchant est l’ennemi du méchant »10 : en effet, d’être semblable à un autre méchant n’empêche guère notre premier méchant de nuire au second ! Se dessine alors la seconde hypothèse, cette fois-ci rattachée au nom d’Héraclite. Car il se pourrait d’autre part que l’amitié procède de l’attrait qu’exercent sur eux des contraires. Le même ne fait qu’attirer la jalousie et la rancune ; au contraire, les opposés se complètent et retrouvent à travers leur relation comme une unité perdue : c’est le cas de la relation entre le pauvre et le riche, entre le médecin et le malade, entre le savant et l’ignorant, etc. Socrate objecte alors que ce qui aime et ce qui hait ne peuvent devenir amis. Au total, les deux hypothèses se trouvent congédiées, car elles ne résistent pas aux contre-pieds du philosophe.
La question du fondement de l’amitié ne trouve pas de réponse, le dialogue se révèle de ce point de vue aporétique. Dimitri El Murr conclut ainsi sa présentation de cette œuvre de jeunesse de Platon : « On ne sait donc pas qui est l’ami au sortir de cette double démonstration. Mais on sait en revanche qu’on ne le trouvera pas dans la tradition héritée et populaire, enfermée dans une alternative dont le défaut principal est sans doute d’aborder la philia dans une logique qui n’est pas la sienne. […] Pourtant, il faut nuancer, car ce sont bien ces mêmes catégories que Platon retrouvera en Lois, VIII »11. En somme, l’aporie éthique de l’œuvre de jeunesse, qui questionne les termes de la relation amicale, trouverait sa solution politique dans le dernier dialogue de Platon, qui analyse la relation amicale pour elle-même, en tant que relation. Ce déplacement de la problématique conduit l’Étranger d’Athènes à distinguer trois espèces du genre « amitié » : l’amitié réciproque fondée sur la quête commune de la vertu (837 a), l’amitié des contraires qui vise à pallier un manque (837 a), l’amitié qui mélange les deux premières et se caractérise par le tiraillement (837 b-c)12. Pourtant, il nous semble que cette évolution de la question de l’amitié, qui ne porte donc plus sur les termes, mais sur la relation elle-même, si elle trouve son développement final dans les Lois, s’appuie sur l’ontologie développée et systématisée dans ce dialogue de la maturité qu’est le Sophiste, au cours duquel l’Étranger en vient à définir l’être comme communauté.
Arrêtons-nous par conséquent quelques instants en compagnie de l’Étranger et de Théétète afin de lever cet oubli de l’être. Le dialogue débute par la chasse au sophiste, qui toujours se dérobe aux multiples tentatives de prise conceptuelle ; impossible de le définir tant il parvient à se glisser entre les rets du filet dichotomique ! Aussi sont-ils aussi difficilement saisissables que les simulacres : le manque de consistance de leur discours, qui toujours s’adapte à la situation sans égard à la vérité, les rend tout à fait hermétiques à la clarté des Formes. L’Étranger formule alors le problème de la façon suivante :
C’est que nous voilà réellement, bienheureux jeune homme, devant une question extrêmement difficile ; car paraître et sembler sans être, dire quelque chose sans pourtant dire vrai, ce sont là formules qui, toutes, sont grosses d’embarras, aujourd’hui comme hier et comme toujours. Quelle formule, en effet, trouver pour dire ou penser que le faux est réel, sans que, à la proférer, on reste enchevêtré dans la contradiction, la question est vraiment, Théétète, d’une difficulté extrême13.
S’engage alors une discussion sur le non-être, puis sur l’assemblage de l’être et du non-être, et enfin sur l’être lui-même. Et c’est à ce point du dialogue que nous voulons précisément en venir. L’enjeu consiste à sortir des dualismes stériles qui opposent l’idéalisme et le matérialisme, ou encore le mobilisme et l’immobilisme : et cela ne sera possible qu’en dotant l’être d’un pouvoir de médiation et de mise en lien.
Mais avant d’en arriver là, l’Étranger doit prendre le temps de dégager les genres de l’Être ; il procède en distinguant deux couples. Il s’attache tout d’abord à récuser les tenants de l’immobilisme (248 e-249 a), car la connaissance de ce qui est requiert le mouvement de l’intellect, c’est-à-dire, en quelque sorte, une action de la pensée ; inversement, il rejette les discours des tenants du mobilisme intégral, sans « même [leur] prêter l’oreille » (249 d). Conclusion : l’être est à la fois mouvement et repos.
Avançons plus avant : des trois genres que nous venons de distinguer, l’être, le mouvement et le repos, on peut dire que « chacun d’eux est autre que les deux qui restent et même que soi » (254 d)14. Voici donc introduit un nouveau couple d’opposé : celui du même et de l’autre, au sein duquel chaque terme diffère de l’autre, mais demeure identique à lui-même. Voici donc constituée la communauté de l’être composée de deux couples de termes antagoniques.
C’est précisément en cet endroit que se résout l’aporie du Lysis : alors que Socrate avait renvoyé dos à dos les deux thèses de l’amitié comme relation du semblable avec le semblable et comme attrait du contraire pour le contraire, voici exposée dans le Sophiste la possibilité ontologique du lien entre le même et l’autre. Il y va, dans ce mélange des genres, de la possibilité même de la philosophie : « nous en priver, en effet, serait d’abord, perte suprême, nous priver de la philosophie » (260 a) affirme ainsi l’Étranger après avoir souligné que « c’est la plus radicale manière d’anéantir tout discours que d’isoler chaque chose de tout le reste ; car c’est par la mutuelle combinaison des formes que le discours est né » (259 e)15. Ainsi, à l’être comme puissance de communauté du même et de l’autre exposée dans l’ontologie du Sophiste correspond l’amitié comme relation d’hommes dissemblables en quête de la vertu dans la politique des Lois.
Mais poursuivons plus avant. L’être est puissance de communauté, dynamis koinonias : cela signifie que la dissymétrie qu’il introduit dans le concert des genres est la condition de mise en lien des couples d’antagoniques que sont d’une part le mouvement et le repos, d’autre part le même et l’autre. Mais de quelle communauté s’agit-il ? Quel est ce commun que l’être, dans son retrait et son effacement, fait advenir ? Il ne s’agit de rien de moins que du monde, que les Grecs nommaient cosmos.
Dans le Gorgias, Socrate s’adresse à Calliclès de la façon suivante :
Les savants, Calliclès, affirment que le ciel et la terre, les dieux et les hommes, sont liés ensemble par l’amitié, le respect de l’ordre, la modération et la justice, et pour cette raison appellent l’univers l’ordre des choses [cosmos], non le désordre ni le dérèglement16.
L’amitié constitue par conséquent l’une des quatre conditions par lesquelles le monde se maintient en tant que monde : par elle le Ciel, régi par les mouvements cosmiques, la Terre, qui offre le repos aux hommes et aux choses, les dieux, toujours les mêmes grâce à leur immortalité, et les hommes, perpétuellement autres en raison de leur finitude, forment un accord parfait et habitent le Monde en toute harmonie pour filer ici une métaphore musicale. Jean-François Mattéi a montré, dans ses premiers travaux, que cette figure du cosmos imprègne l’histoire de la philosophie de part en part, de Platon à Heidegger, de Pythagore à Nietzsche17. Et, en effet, à lire le passage suivant de la Vie de Pythagore écrite par Jamblique au début du ive siècle, on perçoit aisément l’ancestralité de ce thème de la mise en relation, cosmique, politique et éthique, par l’amitié :
Pythagore recommanda de la manière la plus explicite l’amitié de tous pour tous : des dieux à l’égard des êtres humains par le moyen de la piété et du culte savant ; des doctrines les unes avec les autres, de l’âme avec le corps en général, de la partie rationnelle de l’âme avec les parties non rationnelles par le moyen de la philosophie et de la contemplation qui s’y rapporte ; des êtres humains les uns avec les autres, des citoyens (entre eux) par une saine observance des lois, des gens qui n’appartiennent pas à la même communauté, par la connaissance correcte de la nature humaine ; de l’homme avec la femme, les enfants, les frères et les gens de la maison, par des liens communautaires indissolubles18.
Mais l’on peut encore préciser la nature de cette amitié en lisant la suite du discours de Socrate à Calliclès :
Tu n’y fais pas attention, je crois, malgré toute ta science, et tu oublies que l’égalité géométrique est toute-puissante parmi les dieux comme parmi les hommes. Tu es d’avis qu’il faut travailler à l’emporter sur les autres : c’est que tu négliges la géométrie19.
Tandis que l’égalité arithmétique accorde à chacun une part égale, quelles que soient sa nature et ses qualités, justifiant ainsi, par exemple, l’attribution d’une voix à chaque citoyen dans le cadre du suffrage universel, l’égalité géométrique, quant à elle, vise un rapport, c’est-à-dire l’harmonie entre le destin, ou le mérite, et la rétribution. Par l’usage de la proportion et de l’analogie, elle évite aussi bien la tautologie du même, calculée par la moyenne arithmétique qui divise une somme par le nombre de participants concernés, que la dispersion qui renonce à toute idée d’égalité : ainsi la Différence se trouve réintroduite dans l’ordre du monde, mais aussi dans celui de la cité. Par conséquent, si l’être, sur le plan ontologique, et l’amitié, au niveau éthique, se définissent comme relations, ils ne sauraient toutefois être englobés dans n’importe quelle forme relationnelle : ils procèdent très précisément de l’égalité géométrique, loi cosmique et éthique de redistribution des différences au sein d’une harmonie globale.
Mais si sommes désormais en possession de la connexion qui lie amitié et communauté, la notion de Bien, quant à elle, se fait toujours attendre. Il nous faut, pour procéder à son introduction dans notre réflexion, repartir de la fin du dialogue du Lysis. Jean-Claude Fraisse, auteur du livre de référence sur l’amitié dans la philosophie antique, axe à juste titre son interprétation du Lysis sur ses derniers développements qui font suite au rejet des thèses cosmologiques20. Socrate, en effet, pour relancer le dialogue, en vient à introduire la question de la finalité, du « ce en vue de quoi » l’on est ami. Par exemple, le malade, quand son corps défaille, aime le médecin, car ce dernier possède le savoir nécessaire à sa guérison. Mais il convient alors de ne pas s’arrêter en si bon chemin, et de déceler derrière les finalités évidentes la finalité suprême : celle du Bien, du prôton philon, qui marque l’introduction de la transcendance éthique dans le dialogue. À y regarder de plus près, le médecin n’est point aimé pour lui-même, mais en raison de sa faculté à ramener le corps souffrant vers la santé ; et cette dernière n’est autre qu’une des formes particulières du bien : « or la médecine est un bien, et c’est en vue de la santé que la médecine se fait aimer. Or la santé est un bien, n’est-ce pas ? » affirme ainsi Socrate en 219 b. Aussi, par cette sorte de régression qui ne chemine plus vers la cause efficiente, mais vers la finalité, le philosophe peut établir l’existence logique du prôton philon :
Alors n’arrivera-t-il pas fatalement que nous nous lasserons de poursuivre cette voie, ou que nous arriverons à un principe qui ne nous enverra plus à un autre objet aimé, je veux dire à cet objet qui est le premier objet d’amour, en vue duquel nous disons que tous les autres sont aimés (220 a).
Voici donc annoncée, dès ce dialogue de jeunesse qu’est le Lysis, la transcendance du « Bien au-delà de l’être » énoncée dans le Livre VI de la République, et qui retiendra tant l’attention de Plotin au iiie siècle que d’Emmanuel Levinas à l’autre bout de l’histoire de la philosophie.
C’est ainsi que se mettent en place, chez Platon, tous les éléments constitutifs de la théorie de l’amitié chez Aristote, telle qu’on la trouve exposée dans le livre VII de l’Éthique à Eudème et les livres VIII et IX de l’Éthique de Nicomaque : d’une part, l’amitié comme relation unifiante du divers, qui contient en arrière‑plan une conception cosmologique de l’être comme mesure, proportion et analogie ; d’autre part, le Bien comme irruption de la transcendance éthique dans l’ordre du monde et moteur de l’action humaine en tant que suprêmement désirable. Envisageons à présent comment amitié, justice et bien commun se lient chez le Stagirite pour former une philosophie politique cohérente.
II. Amitié politique, justice et bien commun
S’il est un premier point qu’il faut ici prendre en vue, c’est bien l’aspect phénoménologique de l’amitié, sa caractérisation concrète, qu’Aristote expose et qui, assurément, manquait à l’approche platonicienne. En effet, dans le Lysis, Socrate semblait plus soucieux de congédier les thèses cosmologiques pour préparer le terrain à l’advenue du Souverain Bien que de proposer une description de l’amitié et de ses différentes modalités.
Le premier trait qu’Aristote fait ressortir semble relever de l’évidence : deux amis peuvent le devenir puis le rester s’ils se rencontrent et se côtoient régulièrement, en d’autres termes, si leur relation s’inscrit dans un espace local, dans une proximité géographique. Car « l’éloignement, en effet, sans interrompre absolument l’amitié, en suspend les manifestations »21. Mais à ce premier critère spatial se superpose une dimension temporelle. Car l’on est bien en peine d’imaginer une relation amicale éphémère : cela contredit la nature même de l’amitié qui a partie liée le temps, c’est-à-dire d’une part sur la fréquence et d’autre part sur la durée. Synthétisant cette importance primordiale de l’espace-temps pour l’amitié, le philosophe écrit alors qu’« il faut aux amis la consécration du temps et de la vie en commun »22. Nous pourrions le formuler à notre tour de la façon suivante : si la proximité, la contiguïté et la mitoyenneté peuvent être définies comme les conditions matérielles de l’amitié, le temps, quant à lui, doit se penser en termes d’épreuve(s) : une amitié existe en tant que telle si l’intimité des deux parties parvient à surmonter la corrosion et l’usure des jours, des saisons et des années qui passent, si le lien se maintient en dépit des vicissitudes et des surprises de la vie. L’amitié ne relève donc pas de la seule intention, mais se concrétise bien dans des actes.
C’est précisément, deuxième élément de caractérisation, ce qui permet de la distinguer de la bienveillance. Nous pouvons en effet vouloir le bien de personnes que nous ne connaissons guère, d’inconnus qui habitent à l’autre bout de la planète et, pourquoi pas, de la galaxie. Par ailleurs, cette sympathie serait vouée à rester cachée aux yeux de ceux à qui elle est destinée. Il en va ainsi, par exemple, des dons aux œuvres caritatives qui, matériels ou financiers, demeurent souvent anonymes. Or, la relation amicale exige que les deux amis se connaissent mutuellement, et soient chacun bienveillants envers l’autre : de telle sorte qu’Aristote peut définir l’amitié comme une « bienveillance réciproque »23. Et cette réciprocité de ne pas se satisfaire de mots et de déclarations, mais d’appeler au contraire des actes : c’est bien par les agissements et les actions de chacun envers l’autre que les deux amis pourront se reconnaître puis se déclarer « amis ». En d’autres termes, l’amitié ajoute à la bienveillance non seulement la réciprocité, la mutualité, le retour, mais en sus l’effectivité et la démonstration : l’ami, au contraire de l’inconnu qui habite aux antipodes, ne se satisfera pas de bonnes intentions et de belles paroles, mais attendra les preuves de l’amitié : que celle-ci se manifeste, qu’elle donne à voir, dit le philosophe, ses « marques »24. Et c’est la raison pour laquelle, comme le note très à propos Bénédicte Sère, les philosophes médiévaux durent, pour penser l’amitié, changer de registre, procéder au passage de l’éthique à l’épistémologie et produire une théorie du signe qui permette d’identifier les traces visibles de la relation amicale25.
Si l’amitié se définit comme une bienveillance réciproque, effective et visible, cela ne saurait toutefois suffire à épuiser le sujet, car l’objet même de l’amitié est encore absent de nos développements. Et c’est à ce moment précis de notre raisonnement qu’Aristote rejoint la leçon platonicienne du Lysis : en effet, « nous n’aimons pas, semble-t-il, toutes choses indistinctement, mais cela seul qui est aimable, à savoir le bon ou l’agréable ou l’utile »26. Ici se trouve réintroduite la finalité, le « ce en vue de quoi » nous entretenons une relation amicale. Et puisque le Bien peut se dire, par analogie, du bon, de l’agréable et de l’utile, Aristote est amené à dresser une typologie de l’amitié et à assurer le départ entre l’amitié qui se fonde sur l’utilité, l’amitié qui s’inspire du plaisir et l’amitié qui rassemble les amis par la vertu. Détaillons brièvement ces trois formes d’amitié, cela nous sera bien nécessaire pour la suite de notre argumentation. L’amitié fondée sur l’utilité consiste à entrer en relation avec autrui pour en retirer un avantage quelconque ; c’est la raison pour laquelle elle concerne un grand nombre de personnes, « une multiplicité de gens », dit Aristote dans l’Éthique à Eudème27. L’amitié qui s’inspire du plaisir recherche l’agrément, la compagnie délicate et enjouée, et les bons moments à partager. Alors que la première concerne plutôt les personnes âgées, qui ont cessé de rechercher le plaisir, la seconde serait l’apanage des plus jeunes, eux dont « la passion domine encore la vie »28 ; toutefois, dans les deux cas, l’amitié ne vaut pas par l’ami en lui-même, mais par ce qu’il apporte, utilité ou plaisir : en raison de ces circonstances accidentelles, ces deux types d’amitié se révèlent bien fragiles et éprouvent des difficultés à se maintenir dans le temps. Au contraire, quoique rare, « l’amitié parfaite est celle des bons et de ceux qui se rassemblent par la vertu »29 : c’est ici par essence que les amis sont amis, recherchant la compagnie de l’homme non en raison d’une finalité extrinsèque, intérêt objectif ou subjectif, mais pour elle-même, en raison de son caractère vertueux.
Néanmoins, à ce stade de compréhension de l’amitié chez Aristote, nous ne voyons toujours pas le lien qu’elle pourrait entretenir avec la politique, la justice et le bien commun. Reprenons alors les premiers développements des Politiques ; Aristote y écrit d’emblée : « il est clair que toutes les communautés visent un certain bien, et que, avant tout, c’est le bien suprême entre tous que vise celle qui est la plus éminente de toutes et qui contient toutes les autres. Or c’est celle que l’on appelle la cité, c’est-à-dire la communauté politique »30. Les communautés particulières, la famille, le domaine, le village ont pour vocation d’être intégrés à la cité, car le tout précède les parties. Il est en effet obvie que nous naissons dans le cadre d’institutions déjà préexistantes, telles, par exemple, que le langage et le système politique en vigueur. Or, la finalité de la cité est la recherche du bien commun, c’est-à-dire de la vie heureuse, dont la condition est la vertu de justice sans laquelle les hommes s’abêtiraient, c’est-à-dire deviendraient « le pire des animaux dans ses dérèglements sexuels et gloutons ». Plus précisément, « la vertu de justice est politique, car la justice introduit un ordre dans la communauté politique, et la justice démarque le juste de l’injuste31 ».
Or, en plusieurs passages, Aristote paraît marquer sinon une équivalence du moins un parallèle prononcé entre justice et amitié. Lisons plutôt : « Il semble, comme nous l’avons dit au début, qu’amitié et justice se rapportent aux mêmes objets et ont des caractères communs. Dans toute association on trouve, semble-t-il, de la justice et par conséquent de l’amitié. Du moins décerne-t-on le nom d’amis à ceux qui sont compagnons de bord et d’armes, comme ceux qui se trouvent réunis en groupe dans d’autres circonstances. La mesure de l’association est celle de l’amitié et aussi du droit et du juste. Aussi le proverbe est-il bien exact qui dit qu’“entre amis, tout est commun”, car c’est dans la communauté que se manifeste l’amitié »32. Et les parallèles entre amitié et justice de se poursuivre, plus particulièrement en fonction des formes de gouvernement, thème qui occupe l’intégralité du chapitre XI du livre VIII de l’Éthique à Nicomaque : « Dans chacune des formes de gouvernement, l’amitié apparaît en même proportion que la justice »33. Je retiendrai de ces citations les points suivants. En premier lieu, amitié et justice se rapportent aux mêmes objets, les associations humaines, dont la forme ultime est la citée ; elles possèdent par ailleurs des caractères communs liés à la recherche de la concorde, de la vie heureuse, c’est-à-dire du bien propre à la communauté concernée. Toutefois, ces rapprochements, s’ils possèdent le mérite de pointer que les deux vertus ne sauraient être dissociées, non seulement entre elles, mais également du commun et du bien, masquent une articulation plus fine et plus essentielle entre elles deux.
Revenons alors vers le chapitre 1 du Livre VIII, dans lequel le Stagirite écrit :
L’amitié semble encore être le lien des cités et attirer le soin des législateurs, plus même que la justice. … D’ailleurs, si les citoyens pratiquaient entre eux l’amitié, ils n’auraient nullement besoin de justice ; mais, même en les supposant justes, ils auraient encore besoin de l’amitié ; et la justice, à son point de perfection, paraît tenir de la nature de l’amitié34.
Il ne suffit donc pas de dresser un parallèle entre justice et amitié : en effet, cette dernière possède indéniablement une priorité ontologique sur la première. Car là où l’on trouve de la justice, l’on décèle également la présence de l’amitié ; mais la réciproque ne saurait être valable : là où règne l’amitié pleine et entière, la justice devient superflue puisque la vertu opère le juste partage sans avoir besoin de recourir au droit et aux institutions. On pourrait en conclure que l’amitié peut se définir, eu égard à la justice, comme la condition de possibilité de cette dernière : « La nature veut que l’obligation d’être juste croisse avec l’amitié »35. Franchissons encore un pas : condition de la justice, l’amitié l’est donc de la cité : « en effet, la communauté politique suppose l’amitié, car on ne veut pas faire de chemin en commun avec ses ennemis »36.
Nous pourrions toutefois opposer à ce raisonnement qu’amitié et justice, quoiqu’elles traitent du même objet et affichent des caractères communs, ne concernent pas le même échelon de la réalité humaine. La première a trait aux relations interpersonnelles, aux interactions, à la dyade, au lien qui réunit deux personnes tandis que la seconde s’envisage au niveau macroscopique de la cité. Chacune possède ainsi son ordre propre. C’est la raison pour laquelle la place de l’égalité arithmétique et de l’égalité géométrique sont exactement symétriques. Dans le cadre de l’amitié, l’égalité arithmétique est première, car deux amis s’échangent une quantité égale de biens, d’affection et d’honneurs, et, par voie de conséquence, l’égalité géométrique seconde, elle qui vient compenser une amitié entre deux personnes de rangs ou se statuts inégaux. Parce que la cité contient beaucoup plus d’hétérogénéité que la relation amicale, l’égalité géométrique, qui rend à chacun son dû selon sa condition et son mérite dans le cadre de la justice distributive, dame le pion à l’égalité arithmétique selon laquelle s’opère la justice commutative. Aristote le note de la façon suivante : « l’égalité ne présente pas dans l’amitié les mêmes traits que dans la justice. Ici, ce qui vient en premier lieu, c’est la proportion fondée sur le mérite et, en second lieu, la proportion fondée sur la quantité ; par contre, dans l’amitié, ce qui est au premier plan, c’est la proportion basée sur la quantité et, au second rang, celle qui est fondée sur le mérite »37.
Cette dernière remarque permet de saisir sur le vif la profonde asymétrie entre la relation amicale et la cité, ou encore entre l’amitié et la justice. Tirons-en le corollaire radical : l’amitié fondée sur la vertu et la contemplation s’enracine bel et bien dans le domaine éthique, mais elle révèle par là même sa nature profondément apolitique. On peut donc affirmer, avec Jean-Claude Fraisse, que « la finalité de l’amitié, sous cette forme achevée [c’est-à-dire théorétique], l’affranchit de toute relation avec la vie politique, et qu’elle n’en est ni la condition, ni le but, ni même un élément »38. Faut-il conclure au divorce de l’amitié et de la justice et à présent énoncer le contraire de ce que nous écrivions quelques lignes plus haut ? Certes non. Mais il convient de rapprocher la justice de la seule amitié utile, ainsi qu’Aristote nous y invite explicitement dans l’Éthique à Nicomaque : « La communauté politique, semble-t-il, se fonde dès le début sur le besoin utilitaire et subsiste par lui ; tel est, d’ailleurs, le but que se proposent les législateurs qui identifient le juste avec ce qui est utile à la communauté »39, ainsi que dans l’Éthique à Eudème, qui distingue explicitement l’amitié éthique de l’amitié politique : « L’amitié politique, elle, est fondée sur l’utilité, et cela tout particulièrement »40. La cité ne se fonde guère sur le plaisir et l’agrément, car elle ne peut s’inscrire dans le temps et rechercher la vie bonne en se soumettant aux caprices du désir ; elle ne saurait non plus prendre appui sur l’amitié vertueuse qui requiert le détachement et le retrait contemplatif, c’est-à-dire l’étrangeté au lieu, l’« atopie » selon le mot de Socrate. C’est précisément la raison pour laquelle la justice et l’amitié utile possèdent exactement la même structure : « De même que la justice se montre sous un double aspect : l’un non écrit, l’autre codifié par la loi, de même l’amitié fondée sur l’utilité est, semble-t-il, de deux sortes : l’une morale, l’autre légale »41. Plus encore, l’existence et l’effectivité de l’amitié utile mènent ni plus ni moins qu’à la concorde, et participent de ce fait au bien commun et à la vie bonne : « La concorde paraît donc être une amitié politique et c’est dans ce sens qu’on emploie le mot. Elle s’exerce dans le domaine des intérêts communs et de la vie en société »42. Les gens honnêtes, qui parviennent à maîtriser l’irascibilité des pulsions par la force de leur raison et de leur volonté, « veulent le juste et l’utile, et c’est ce à quoi ils tendent d’un commun accord »43.
Reprenons notre fil directeur. Il nous semble avoir mis en évidence que l’amitié utile est à la cité ce que l’être est au monde : une puissance de communisation, de mise en commun des choses et des hommes, éclairée par la finalité du bien, qu’il prenne la forme du prôton philon dans le Lysis ou du télos dans l’Éthique de Nicomaque. Il est toutefois une différence essentielle entre le cosmos et la polis : c’est que les lois de la seconde sont le fruit de l’activité humaine et non pas de la nature, et il convient d’y insister pour conclure cette seconde partie.
En effet, certains mots sont apparus dans les citations précédentes que nous n’avons pas intégrés à notre raisonnement : c’est le cas du « droit » (« La mesure de l’association est celle de l’amitié et aussi du droit et du juste »44) et de la « loi » (« l’amitié fondée sur l’utilité est, semble-t-il, de deux sortes : l’une morale, l’autre légale »45). Si l’amitié fondée sur la vertu entretient une forme d’autosuffisance, car l’activité de contemplation se suffit à elle-même, l’amitié utile, quant à elle, serait en peine de se maintenir sans l’appui et même le cadre d’institutions qui viennent régler les rapports d’échange. Sa précarité, qu’Aristote souligne à plusieurs reprises, se trouve en quelque sorte compensée par des constructions sociales et politiques qui prennent le relai de la relation immédiate et font office de tiers garant qui organise les conditions des transactions. Aussi n’est-il guère étonnant de voir débuter le livre IX de l’Éthique à Nicomaque par un développement portant sur la monnaie : cette dernière est en effet une convention qui donne l’étalon nécessaire pour que le cordonnier puisse échanger ses chaussures contre d’autres objets, ceux du tisserand et des autres artisans. Comme le dit le Stagirite, « on a institué une mesure commune : la monnaie. C’est à elle qu’on se réfère en toutes circonstances ; c’est elle qui sert de mesure »46. De façon plus générale, la relation amicale n’est pas close sur elle-même et débouche sur l’activité législative, c’est-à-dire sur la délibération citoyenne qui donne à chaque cité sa forme propre. De telle sorte que l’on peut affirmer de l’amitié qu’elle est à la fois la condition et l’objet du politique : en effet, la relation amicale est à l’origine de la bonne entente qui permet la délibération ; mais cette dernière, en retour, crée le cadre au sein duquel l’amitié se déploie. De même, l’on peut dire de l’amitié qu’elle est une relation à la fois immédiate et médiate : immédiate, car elle place deux amis en situation de proximité ; médiate pour deux raisons : d’une part, la relation amicale se fonde sur son objet, utilité, plaisir ou vertu ; d’autre part, elle nécessite l’intercession d’institutions telles que l’argent, nous l’avons vu ci-dessus, mais aussi la langue, le droit, etc.
III. La déconstruction ou l’impossible amitié
Nous avons observé comment l’amitié, chez Platon puis Aristote, se trouve au cœur des questions du Bien et de la communauté, en d’autres termes, en position d’essentielle centralité lorsque le thème du Bien commun doit être abordé. Les Romains ont très largement accepté cet héritage ; comme l’affirme Arnaud Suspène, « à Rome, penser l’amitié, c’est d’abord penser la chose commune, c’est-à-dire la République »47. C’est la raison pour laquelle Cicéron composa en 44 avant notre ère un traité sur l’amitié, le Laelius de amicitia, dans lequel le philosophe recueille l’héritage des penseurs grecs et perpétue la compréhension de l’amitié sur ses versants à la fois cosmiques, car « la sagesse exceptée, l’homme n’a rien reçu de meilleur de la part des dieux48, et politique, car « si l’on supprime dans la nature le lien que créent les sentiments, ni maison ni ville ne pourra rester debout »49. Plus encore, on retrouve chez Cicéron le primat éthique du Bien, car l’amitié ne saurait fondamentalement résulter de la faiblesse humaine50, mais émane bien plutôt du magnétisme de la vertu ; et, enfin, ce sentiment unit des gens proches, réunis dans une unité de temps, de lieu et d’action : en effet, « nous sommes tels par nature que tous les hommes ont entre eux un lien de société et qu’il se raffermit dans la mesure où ils plus proches les uns des autres. Ainsi préfèrent-ils leurs concitoyens aux étrangers, les membres de leur famille aux autres »51. En résumé, l’amitié est l’entente qui assure à une communauté donnée sa continuité historique en raison de la stabilité des liens qu’elle fait naître, développe puis entretient.
Il n’entre pas ici dans le cadre de nos propos de retracer une histoire de l’amitié en Occident, mais il s’avère tout de même expédient de noter les points suivants avant d’aborder la phase suivante de notre cheminement. En premier lieu, les médiévaux reçurent de Cicéron les développements antiques sur l’amitié : il constitue en effet, comme l’indique Bénédicte Sère, la « référence incontournable »52 en la matière. Même Jean Bodin, celui par qui le concept moderne de « souveraineté » arriva, écrivait en 1576 dans les Six Livres de la République que l’amitié constitue la finalité du gouvernement ou, dans ses termes, de l’action du Prince :
L’autre point que le sage Prince doit avoir devant les yeux est de trancher les racines, et ôter les semences des guerres civiles, pour maintenir les sujets en bonne paix et amitié les uns envers les autres53.
Et de noter quelques lignes plus bas que l’amitié requiert l’égalité, c’est-à-dire l’équité naturelle et le partage des choses communes. On peut donc affirmer que ce modèle de l’amitié se perpétua à travers les siècles jusqu’à vivre un retrait de la sphère politique, mouvement culminant au xviiie siècle, mais déjà amorcé par la privatisation du sentiment affectif chez Montaigne. Formulons-le ainsi : l’éclatement du cosmos qui résulte des avancées de la science moderne, galiléenne puis newtonienne, engendra en réaction un recentrement de l’homme sur lui-même ; l’amitié, privée de ses repères cosmiques et ontologiques, suivit ce mouvement et gagna alors l’intériorité subjective. En second lieu, il nous faut ici noter quelques éléments historiques de manifestation de l’amitié : car celle-ci n’est pas un programme qui s’appliquerait de façon univoque à toutes les sociétés. Au contraire, elle s’inscrit toujours, comme la prudence, dans un contexte bien particulier : elle se trouva ainsi au fondement de la société carolingienne dont la fides est la clef de voûte54, elle servit également de ciment aux contre‑pouvoirs qui s’opposent aux dérives absolutistes, que ce soit à la fin du Moyen Âge chez Oresme55 ou au xviiie siècle avec l’émergence de corps intermédiaires tels que les salons philosophiques et les loges franc-maçonnes56.
Pourtant, malgré ses mutations et ses déplacements, l’amitié semble conserver ses caractères aristotéliciens que nous détaillâmes plus haut et que Donatien Grau résume, quant à lui, en trois mots‑clefs : la durée, la vertu et la relation interpersonnelle57. En forçant certes le trait, nous pourrions même reconnaître dans ces termes des qualificatifs aptes à rendre compte d’une amitié privée et dépolitisée. Dans quel but avançons-nous ce dernier élément ? Pour faire apparaître, par contraste, la rupture historique que nous vivons actuellement : « Le modèle de l’amitié est en cours d’annihilation ou de révolution », assure ainsi Donatien Grau dès le début de son propos58. Puis l’auteur d’apporter les arguments à l’appui de sa thèse : la remise en cause du caractère électif et aristocratique de l’amitié par une mentalité majoritairement démocratique, ce qui revient à dire que l’égalité arithmétique dame le pion, à l’égalité géométrique ; l’avènement des réseaux sociaux qui rend la proximité spatiale superflue ; l’immédiateté des relations qui rompt avec la durée nécessaire et incontournable à l’édification d’une amitié classique.
Très significativement, Donatien Grau rapproche ce nouveau portrait de l’amitié de « la communauté qui vient » de Giorgio Agamben : en effet, le philosophe italien développe dans le livre éponyme une théorie de la singularité quelconque, ou encore de l’être tel qu’il n’est pas déterminé ou défini et retiré par conséquent de toute appartenance. Et ce quelconque de posséder en outre l’insigne qualité d’être aimable, précisément en raison de son absence de forme : car l’on n’aime jamais quelqu’un pour tel ou tel détail, ses cheveux ou ses manières, mais pour ce qu’il est, tout simplement59. Ici se trouve subvertie l’idée aristotélicienne selon laquelle l’amitié se fonde sur la médiation d’une finalité : utilité, plaisir ou vertu. C’est justement en renonçant à tout objet identifié et désirable que la singularité quelconque en rencontre une autre. Mais l’amitié alors se transforme : elle n’est plus cette puissance de mise en relation et d’attachement du même et de l’autre, elle devient le perpétuel devenir-autre du même qui ne trouve plus à se fixer, ne fût-ce que provisoirement dans une forme : « L’ami n’est pas un autre moi, mais une altérité immanente dans la mêmeté, un devenir autre du même », écrit ainsi fort logiquement Giorgio Agamben dans le petit livre qu’il consacre à l’amitié60. Mais que reste-t-il alors de la communauté si l’amitié n’assure plus le rôle de liant social et politique ? Pour le comprendre, il nous faut emprunter le détour que le philosophe italien prend lui-même, et en revenir à la doctrine de l’univocité telle que Spinoza la développe : en effet, pour Agamben, « rien de plus instructif que la manière dont Spinoza pense le commun »61 ! Le penseur néerlandais considère que tous les corps expriment l’attribut divin de l’étendue sans pour autant que cela ne définisse leur essence, de telle sorte qu’essence et communauté se trouvent ici dissociées. Agamben peut alors en tirer les conséquences : « Décisive est ici l’idée d’une communauté inessentielle, d’une solidarité qui ne concerne en aucun cas une essence. L’avoir lieu, la communication des singularités dans l’étendue, ne les unit pas dans l’essence, mais les disperse dans l’existence »62. On mesure ici à quel point la figure du citoyen, qui par définition appartient et participe à un corps politique, se trouve balayée par la singularité quelconque qui ne soumet son irréductibilité à aucune espèce de loi, à aucune sorte de médiation. Jean-Luc Nancy présente le même raisonnement issu de la doctrine de l’univocité scotiste pour justifier l’idée d’une « communauté désœuvrée » : “Quoi de plus commun qu’être, que l’être ? […] Mais l’être n’est pas une chose que nous posséderions en commun”63. Logique qui aboutit non seulement à nier l’existence historique de formes communautaires (« la communauté n’a pas eu lieu »64) malgré les innombrables travaux sociologiques, mais également à contester la possibilité ontologique de la communauté (« il n’y a pas la communion, il n’y a pas d’être commun »65). La conclusion des démonstrations d’Agamben et de Nancy, ultime corollaire de l’exil de l’amitié de la vie politique, opère le divorce entre l’humain et le citoyen, entre la singularité et l’État : selon les mots de Giorgio Agamben, “la nouveauté de la politique qui vient, c’est qu’elle ne sera plus une lutte pour la conquête ou le contrôle de l’État, mais une lutte entre l’État et le non-État (l’humanité), disjonction irrémédiable des singularités quelconques et de l’organisation étatique”66.
Cette déconstruction radicale et totale de l’amitié par Giorgio Agamben semble plonger ses racines dans l’ébranlement que fut pour les philosophes postmodernes les œuvres de Maurice Blanchot et d’Emmanuel Levinas, ainsi dans l’ouvrage plus tardif que Jacques Derrida consacra à l’amitié, Politiques de l’amitié, qui se trouve justement cité au début du petit livre du penseur italien.
C’est en hommage à Georges Bataille, disparu le 9 juillet 1962, que Maurice Blanchot composa L’amitié, livre qui contient pourtant beaucoup d’essais qui n’abordent pas le thème promis par le titre. Deux citations de Bataille ouvrent l’ouvrage, et la seconde d’entre elles attire immédiatement l’attention, elle qui évoque « cet état d’amitié profonde où un homme abandonné, abandonné de tous ses amis, rencontre dans la vie celui qui l’accompagnera au-delà de la vie, lui-même sans vie, capable de l’amitié libre, détachée de tous liens »67. Dès l’entame se manifeste au grand jour l’ambition de retourner l’amitié classique : l’amitié comme lien qui unit deux personnes différentes est une aliénation de laquelle il est impératif de se délivrer afin de vivre une « amitié libre, détachée de tous liens ». Mais à quoi peut donc ressembler un attachement sans attache ? Une ébauche de réponse se trouve dans le dernier essai, qui donne son titre à l’ouvrage et comporte à peine cinq petites pages. Le premier affranchissement provient de la libération à l’égard du passé et de la mémoire : « Tout ce que nous disons ne tend qu’à voiler l’unique affirmation : que tout doit s’effacer et que nous ne pouvons rester fidèles qu’en veillant sur ce mouvement qui s’efface, auquel quelque chose en nous qui rejette tout souvenir appartient déjà »68. La fidélité ne témoigne pas du maintien de l’amitié qui laisse son empreinte même lorsque l’ami est absent, mais du projet commun de l’absence de projet commun : tout doit être effacé, aucune trace ne doit subsister, l’oubli, et non la réminiscence, donne à l’amitié son inessentielle inconsistance. Mais à qui alors Maurice Blanchot écrit-il cet hommage si ce n’est à Georges Bataille ? Certainement pas à ce dernier, puisqu’il n’est pas certain que ce dernier, lorsqu’il s’exprimait à la première personne dans ses propres livres, parlait vraiment de lui-même, au sens où il est sinon impossible du moins difficile d’identifier ce « Je » qui s’énonce lui-même. L’hommage reste-t-il possible s’il perd son destinataire ? Assurément non : car l’on peut certes parler avec nos amis, mais il est tout à fait interdit de parler sur eux. Pourquoi ? « L’amitié, ce rapport sans dépendance, sans épisode et où entre cependant toute la simplicité de la vie, passe par la reconnaissance de l’étrangeté commune qui ne nous permet pas de faire parler nos amis »69. Le rapport amical se tisse à partir d’une « séparation fondamentale », originelle, irréparable, à partir d’une « distance infinie » qu’aucun pont ne saurait franchir, qui rendent l’hommage à l’ami disparu inconcevable et, par conséquent, irréalisable. Cela mène Maurice Blanchot à faire montre de sophistique : à savoir, à ne parler de rien ni de personne pendant cinq pages de palinodies réitérées, et à tenter de justifier son nihilisme70. Il fallait sans doute rompre avec la conception classique du langage, celle qui affirme avec Platon que l’on ne peut rien dire du non-être, car « toute science essentielle déterminée [est] science d’un être essentiel déterminé »71, ou, avec Aristote cette fois, que l’énoncé dit quelque chose à propos de quelque chose72, pour promouvoir une conception de « l’amitié sans partage comme sans réciprocité, amitié pour ce qui a passé sans laisser de traces »73.
C’est à partir de cette révolution blanchotienne, mais aussi de la pensée levinassienne, qui à la métaphysique du Même substitue l’éthique de l’Autre comme philosophie première74, que Jacques Derrida entreprendra d’écrire ses Politiques de l’amitié, dans lesquelles la déconstruction ne se limite plus à l’amitié grecque, mais inclut de surcroît la fraternité chrétienne. Car, selon lui, « la figure de l’ami semble spontanément appartenir à une configuration familiale, fraternaliste et donc androcentrée du politique »75. Bien sûr, cette affirmation ne peut provenir que d’une lecture partiale d’Aristote qui, s’il place effectivement la proximité au cœur de l’amitié, n’en défend pas moins la thèse que l’amitié utile, la seule qui soit pleinement politique, se fonde sur l’égalité des participants alors que l’amitié qui lie à un père à son fils, un mari à son épouse, ou un maître à ses esclaves, fait partie des relations inégales régies par la loi de la proportion76. Et Cicéron, de son côté, d’affirmer que l’amitié entre parents, en comparaison de celle qui unit les amis, « manque de solidité »77. Mais, peu importe, pour Jacques Derrida, la véracité de son assertion, car la finalité de son raisonnement est de mettre en évidence l’emprise de l’être sur le politique, à travers un syllogisme implicite qui s’appuie sur l’énoncé suivant : « Le concept du politique s’annonce rarement sans quelque adhérence à la famille, sans ce que nous appellerons une schématique de la filiation : la souche, le genre ou l’espère, le sexe (Geschlecht), le sang, la naissance, la nature, la nation – autochtone ou non, tellurique ou non »78. Voici donc : L’amitié est le fondement du politique ; or l’amitié, assimilable à la fraternité, procède du registre familial, c’est-à-dire de la filiation ; donc le politique se pense à partir de la souche et du sang. Elle est par conséquent éminemment condamnable en ce qu’elle reproduit le Même, à l’instar de l’ensemble de la tradition métaphysique inaugurée par Platon, et s’avère incapable d’accueillir l’Autre dans sa radicale étrangeté. Déconstruire l’amitié se révèle être un enjeu de taille, à l’échelle de la civilisation.
Jacques Derrida emploie alors la même stratégie que Maurice Blanchot : il faut avant tout développement ultérieur détacher l’amitié du bien, de l’aimable, être, objet ou vertu. En effet, « on peut penser et vivre l’amitié, le propre ou l’essentiel de l’amitié, sans la moindre référence à l’être -aimé, plus généralement à l’aimable »79. L’amitié se trouve ainsi affranchie, non seulement libérée du joug de la finalité ou du principe, mais en sus délivrée du lien social et communautaire, de telle sorte que l’on trouve ici déjà établir la disjonction de l’homme et du citoyen, de l’amitié et de la communauté, relevée plus haut chez Giorgio Agamben : « Communauté sans communauté, amitié sans communauté des amis de la solitude. Nulle appartenance. Ni ressemblance ni proximité. » assène de façon péremptoire Jacques Derrida80. Voici l’amitié sauvée des rets de l’arraisonnement, car toute communauté et tout être-en-commun sont essentiellement, de tous temps et en tous lieux, des ruses de la raison qui s’approprie l’étranger et rend l’autre pareil au même.
Sans point fixe ni attache, elle peut désormais intégrer le programme révolutionnaire de Jacques Derrida :
Il y a là comme un soulèvement, en effet, et nous voudrions en percevoir les ondes sismiques, en quelque sorte, la figure géologique d’une révolution politique […], une révolution, peut-être du politique. Une révolution séismique dans le concept de politique de l’amitié dont nous avons hérité81.
Mais de quelle révolution est-il plus précisément question ? De celle qui consiste à faire de l’étranger, par-delà toute appartenance familiale, sociale et politique, mon ami ; de celle qui substitue à la fermeté et à la clôture des liens amicaux un appel et une adresse qui précèdent toute rencontre, toute identité, toute reconnaissance ; de celle qui érige l’Autre en Absolu qui échappe, par définition, à toute mesure commune et à qui nous devons, car cela relève de notre responsabilité et de notre « com-parution »82 selon le terme de Jean-Luc Nancy, l’hospitalité. « Amitié : amitié pour l’inconnu sans amis »83, résume Maurice Blanchot. La neutralisation de l’amitié conduit à l’ouverture inconditionnelle aux singularités quelconques si bien que l’éthique signifie, chez Levinas, Blanchot, Derrida, Nancy et Agamben, l’enterrement simultané de l’ontologie et du politique, ou encore les funérailles du registre analogique de l’être, du commun et du bien. Ne subsiste plus alors, en dépit des efforts répétés de Platon et de la tradition philosophique pour maintenir le metaxu, l’entre-deux, qu’« un devenir-autrui qui ne comporte aucune médiation du même et de l’autre »84.
IV. Le management ou le triomphe planétaire du messianisme de l’amitié
Il semble pourtant que les promoteurs de l’amitié sans partage ni réciprocité, de cette amitié anonyme et unilatérale qu’Aristote nommait « bienveillance », pour très précisément la distinguer de l’amitié, soient passés à côté d’un fait essentiel qui structure les sociétés industrielles et post-industrielles : celles-ci, en effet, se bâtissent autour d’une théologie messianique de l’amitié qui présente, ô surprise, bien des points communs avec les pensées de la déconstruction. Je serais d’ailleurs prêt à risquer l’hypothèse, qui, faute de place, demanderait à être étayée dans un autre article, selon laquelle la déconstruction ne serait que l’écho tardif et radicalisé de la révolution industrielle : elle est, sur le plan de la pensée, l’arrachement enfin venu à la longue période agraire inaugurée révolution néolithique et marquée par les schèmes du territoire (qui, par ses frontières, bloque ou ralentit les flux), de la racine (à laquelle Deleuze substitue les rhizomes), de l’arbre (de la philosophie), etc.
Cette présence de l’amitié messianique, dont nous dresserons la généalogie et les contours plus bas, mérite toutefois d’être observée dans son déploiement contemporain. Elle prend tout d’abord la forme visible et grotesque de l’homo festivus, dont Philippe Muray s’est fait le redoutable exégète, de sa recherche forcenée de convivialité, de sa quête d’amusements grégaires, de sa boulimie d’activités sociales et fun. Mais l’amitié moderne se manifeste également dans des lieux que l’on croyait, à tort, destinés au seul impératif économique : l’entreprise. L’arrivée récente des « Responsables du bonheur » (Chief Happiness Officer), les multiples politiques de « reconnaissance » et de promotion du « bien-être au travail », l’ambition de créer un lien fusionnel entre les salariés et les normes organisationnels que l’on nomme « culture d’entreprise », le souci grandissant du « travail en équipe » et en « mode projet », le projet de développer les « compétences relationnelles et collectives », les aspirations à une organisation décloisonnée et collaborative… tout cela témoigne du fait que l’entreprise ne saurait se réduire à un amas d’individus rationnels et calculateurs, et qu’elle cultive, au contraire, « l’amitié » comme ressort du lien organisationnel. Et cette brève phénoménologie de ne pas relever de l’anecdote, étant donnée l’insigne importance du management et des organisations dans les temps présents85.
Ceci ne va pourtant pas de soi. En effet, Dimitri El Murr soutient, quant à lui, que l’individualisme libéral serait à l’origine de l’éclipse de l’amitié ; plus précisément, « l’individualisme impliqué par la théorie des échanges dans la société commerciale produit d’autres conditions sociales pour la pratique du lien amical et aussi d’autres modes de questionnement présidant à l’analyse des relations interpersonnelles »86. Le philosophe constate dans un premier temps que le nombre de publications qui traitent spécifiquement de l’amitié s’effondre tout au long du xixe siècle au moment même où la société bourgeoise s’affirme avec de plus en plus. Il émet alors l’hypothèse explicatrice suivante : la conciliation des relations concurrentielles, c’est-à-dire des intérêts privés, et des liens amicaux est périlleuse tant la nature de ces rapports apparaît incompatible. Dimitri El Murr se réfère enfin à Hannah Arendt et à l’analyse détaillée que cette dernière propose des modalités de la vie active dans la Condition de l’homme moderne : dans cette lignée, il affirme que l’amitié trouve naturellement sa place dans une société, la grecque en l’occurrence, qui accorde le primat au registre de l’action, c’est-à-dire au service de la cité (et du bien commun, ajouterions-nous volontiers), mais qu’elle souffre d’être écartée à une époque où le travail fait office de principe cardinal. Même les différentes théories des sentiments moraux développées par les Lumières écossaises, contre toute attente, confirment ce verdict : en effet, à l’amitié se substitue ici, comme dans les pensées de la déconstruction, la bienveillance à l’égard d’autrui en général qui compense les défaillances et l’incomplétude du marché. Dit en d’autres termes, cela revient à rabattre l’amitié sur la sphère privée et à la vider de toute substance ou visée politique. Dimitri El Murr peut alors conclure de la façon suivante :
On peut donc affirmer que même si le libéralisme ne détruit pas la possibilité théorique de l’amitié, même s’il tend au contraire à l’inscrire dans la nature humaine, son intégration dans le principe de sympathie ou de bienveillance ne permet plus de justifier la spécificité de son statut87.
Il n’en reste pas moins dommageable que Dimitri El Murr, tout comme Hannah Arendt d’ailleurs, ne se penche pas davantage sur la nature et les soubassements du travail moderne : cela lui aurait permis d’observer non pas la disparition de l’amitié, mais son déplacement de la cité vers l’entreprise. Mais quelles transformations l’amitié connaît-elle dans ce transfert de la polis vers l’oikos ? Quelles modifications affectent son passage du politique vers l’organisationnel ?
Partons d’un constat88 : dans les Principes du management scientifique parus en 1911, l’ingénieur américain Frederik Winslow Taylor se donne pour objectif d’offrir à ses lecteurs, et surtout aux dirigeants d’entreprise, une synthèse des acquis de ce nouveau mode de gouvernement des entreprises et des ateliers qu’il nomme « management scientifique ». Il revient naturellement sur des choses bien connues : la séparation de la conception et de l’exécution, la spécialisation des tâches et leur optimisation spatio‑temporelle (one best way), la sélection des ouvriers, la rémunération à la pièce, etc. Ce que l’on oublie plus facilement, c’est que cet ensemble de mesures et de dispositifs sert une vision du monde que Taylor résume de la façon suivante :
Harmony, not discord. Cooperation, not individualism89.
Le management scientifique se révèle être, au fond, une troisième voie entre l’individualisme libéral, qui renvoie le fondement de la société à la raison du sujet sous ses multiples figures, économique, juridique et politique, et le marxisme qui établit la lutte des classes, c’est-à-dire la négativité, comme moteur de l’histoire. Ni atomisme ni antagonisme, le management scientifique s’inscrit dans le projet de la coopération industrielle que Claude-Henri de Saint-Simon thématisa entre 1802 et 1825. Pour ce dernier, en effet, la Révolution Française n’accomplit que la moitié du chemin vers la société parfaite : elle s’est certes débarrassée de l’emprise de la théologie et a promu la science au rang de nouvelle référence de la civilisation moderne et industrielle, mais elle ne vint pas à bout de ces légistes et de ces juristes qui persévèrent dans des réflexes métaphysiques, abstraits et stériles, plutôt que de se tourner vers l’horizon de l’efficacité. Les industriels doivent désormais leur succéder. C’est ainsi que l’âge féodal sera définitivement et péremptoirement dépassé, et que l’époque industrielle triomphera ; alors la paix et la coopération se substitueront à la guerre et à la hiérarchie :
Dans l’ancien système, le peuple était enrégimenté par rapport à ses chefs. Dans le nouveau, il est combiné avec eux. De la part des chefs militaires, il y avait commandement. De la part des chefs industriels, il n’y a plus que direction. Dans le premier cas, le peuple était sujet. Dans le second, il est sociétaire90.
Par conséquent, l’industrialisme se caractérise par une modification radicale des relations sociales ; ces dernières, abandonnant tout rapport de force, délaissant toute conflictualité, émergeront de la coopération et viseront l’association :
Mais dans une coopération où tous apportent une capacité et une mise, il y a véritablement association, et il n’existe d’autre inégalité que celle des capacités et des mises, qui sont l’une et l’autre nécessaires (c’est-à-dire inévitables), et qu’il serait absurde, ridicule et funeste de faire disparaître91.
Si Taylor inscrit ses pas aussi facilement dans ceux de Saint-Simon, si le management scientifique est la poursuite de l’industrialisme, c’est que les deux personnages partagent une même référence fondamentale, et même religieuse : les Quakers, que l’on nomme encore « Amis ». Cela est évident du côté de l’ingénieur américain, né en Pennsylvanie, le fief historique des Quakers, et qui reçut une éducation religieuse poussée de la part de sa mère, Emily Winslow. Du côté de Saint-Simon, cette influence se découvre à la lecture de sa Première Lettre à un Américain, dans laquelle il n’hésite pas à écrire « que le caractère de l’un de ses premiers fondateurs des colonies anglaises dans le Nouveau Monde, le célèbre Penn, était le caractère dominant de la nation américaine ; que cette nation se montrait en général essentiellement pacifique, industrieuse et économe92 ». De son périple aux États-Unis, Saint‑Simon en a gardé une admiration sincère pour une nation jeune et profondément égalitaire, marquée par les préceptes du « célèbre Penn » qui n’est autre que le fondateur quaker de l’État de Pennsylvanie à l’origine de la « Sainte Expérience » qui demeure le mythe des origines des Amis.
En quoi la religion de l’amitié a-t-elle influencé de façon décisive l’industrialisme de Saint-Silmon et le management scientifique de Taylor ? La réponse se trouve dans l’Apologie de la véritable théologie chrétienne rédigée par Robert Barclay en 1675 dans laquelle l’auteur présente les principes et préceptes des Trembleurs93. La thèse II porte, à notre sens, l’essentiel du message dans son titre qui évoque la « Révélation immédiate »94 : puisque ni Dieu ni son Fils ne sont à la portée de notre connaissance, c’est par le contact direct avec le Saint Esprit, par lequel le croyant reçoit la « Lumière intérieure », que se produisent l’illumination, qui provoque le tremblement des corps, et la révélation, qui livre la connaissance suprême. Les Écritures, auxquelles les Protestants sont attachés, et les sacrements, qui manifestent la hiérarchie de l’Église dans le catholicisme, ne sont que des connaissances ou des expériences secondes, car elles ne proviennent pas directement de la Source Suprême : dans la lignée du messianisme spiritualiste de Joachim de Flore, les Quakers remettent ainsi en cause l’ensemble des médiations qui structurent la religion chrétienne. D’une part, la relation à Dieu est immédiate par le contact direct avec le Saint-Esprit ; d’autre part, les rapports entre croyants prennent la forme d’une interaction horizontale et égalitaire, que l’on peut nommer « amitié », et qui consiste précisément à partager ou à transmettre l’« Étincelle divine ». C’est, à notre sens, la manière la plus adéquate de rendre de l’utilisation que Taylor fait de l’adjectif « amical » dans les Principes du management scientifique, comme dans les expressions « coopération amicale » (friendly cooperation95) et même « coopération intime et amicale » (intimate friendly cooperation96), ainsi que dans ce passage plus complet : « L’essentiel du présent article montrera que pour travailler selon des lois scientifiques, le management doit assumer et effectuer le gros du travail qui, à présent, est pris en charge par les hommes ; presque chaque acte de l’ouvrier devrait être précédé par un ou plusieurs acte(s) préparatoire(s) qui lui permettra ou permettront d’accomplir son travail d’une meilleure manière et plus rapidement. Et chaque personne devrait recevoir un enseignement et l’aide la plus amicale de la part de ceux qui le dirigent, au lieu d’être, d’un côté, guidée et forcée par ses patrons, ou, à l’autre bout, livrée à lui-même97 ».
S’il fallait à présent résumer le chemin que nous venons de parcourir, alors je le formulerais de la façon suivante : l’amitié industrielle, plutôt que de préparer le terrain à la délibération politique et à la recherche du bien commun dans l’espace de la cité, sert de vecteur à la révolution industrielle en se présentant d’une part comme la relation humaine vouée à se substituer aux pulsions féodales, et d’autre part comme la condition de la coopération efficace, c’est-à-dire de la production et, par conséquent, de la consommation. Alors qu’elle était pour les Anciens garante de la stabilité et de la continuité des communautés, elle s’est transformée en outil de la révolution permanente ; et il n’est guère étonnant, de ce point de vue, de ne trouver aucune trace des corps intermédiaires dans les écrits de Saint-Simon et de Taylor.
Il nous reste toutefois à observer la présence de l’amitié dans le management contemporain, et donc à en identifier les nouvelles manifestations. Je procéderai selon les deux directions suivantes : en premier lieu les relations entre individus ; dans un second temps la relation de l’individu à l’organisation.
Comme nous le vîmes précédemment, le management se caractérise par l’organisation de la coopération entre les hommes utiles, c’est-à-dire d’une relation qui soit constructive et efficace. Ce projet n’est pas seulement un trait que l’on décèle dans les écrits des fondateurs (Taylor, Fayol, Mayo, Barnard), mais constitue bien plutôt une essence qui se déploie à travers toute l’histoire de la société industrielle puis postindustrielle. Henry Mintzberg, théoricien majeur du management, propose une synthèse des mécanismes de coordination des structures organisationnelles : on y trouve, c’est une liste exhaustive, « la supervision directe » (la hiérarchie), « la standardisation des procédés de travail » (travail prescrit), « la standardisation des résultats » (le management par objectifs), « la standardisation des qualifications » (diplômes et niveaux de compétences), « la standardisation des normes » (le management de la qualité) et enfin « l’ajustement mutuel » (relations informelles)98. La prédominance de l’un de ces mécanismes se trouve à l’origine d’une configuration organisationnelle particulière ; or, l’organisation dite « innovatrice » ou encore « adhocratie », « est la structure de notre époque »,99 car, reposant sur l’ajustement mutuel, elle possède les qualités de fluidité, d’innovation, d’adaptation en temps réel, nécessaire à la survie dans des environnements complexes caractérisés par des technologies de pointe et de fortes expertises. Dans ce cadre, le manager « passe une grande partie de son temps en tant qu’agent de liaison pour coordonner les travaux de façon latérale entre les différentes équipes et unités »100. L’ajustement mutuel désigne donc cet idéal d’une adaptation au mouvement d’autrui intégrant les paramètres des perturbations de l’environnement et des objectifs de l’organisation : une interaction qui, pour être efficace, se passe de tout tiers – la hiérarchie, la loi, la profession, etc. – et réduit à l’homme à sa part comportementale. L’amitié se trouve ici vidée de toute finalité, mais aussi de toute raison délibérative, et rétrogradée à une pure fonction biologique de survie des plus aptes.
Quant au lien de l’individu à l’organisation, il fait l’objet de la discipline qui se nomma tout d’abord « comportement administratif » puis ensuite « comportement organisationnel ». Ce nom fait déjà entendre l’appréhension comportementale de l’être humain, c’est-à-dire son étude du seul point de vue de ses actes visibles, sans aucune prise en compte de l’intériorité, de l’intention, de l’inconscient voire de la spiritualité. Herbert Simon, qui est le père fondateur du comportement administratif, fut récompensé du Prix de la Banque de Suède pour ses travaux sur la rationalité limitée, et fit également partie, dans les années 1950, des pionniers de l’intelligence artificielle. Comment alors rendre compte de l’unité de la pensée de cet auteur en embrassant ces trois dimensions du comportement administratif, de la rationalité limitée et de l’intelligence artificielle ? Rationalité limitée : cela signifie que nos capacités cognitives ne nous permettent pas de récolter toute l’information présente dans l’environnement (on parle d’information imparfaite ou d’information asymétrique) et que, quand bien même nous y parviendrions, nous ne serions pas en mesure de la traiter pour rendre une décision optimale. On comprend que Simon s’oppose ici aux économistes néoclassiques qui émettent le postulat d’une information parfaite et d’une rationalité absolue. Mais l’on saisit également que l’intelligence artificielle a précisément pour rôle de venir combler cette lacune cognitive, d’une part en installant des capteurs artificiels qui pallient les limites de nos sens, d’autre part en créant des algorithmes capables de traiter l’information récoltée de telle façon qu’un cerveau humain ne pourrait le faire. Mais qu’en est-il du comportement administratif rebaptisé plus tard comportement organisationnel ? Eh bien, le raisonnement demeure strictement identique : alors que l’intelligence artificielle joue le rôle d’une prothèse extérieure, quand bien même elle se glisserait aujourd’hui sous notre peau, le comportement organisationnel, quant à lui, étudie les différentes formes de prothèse interne : à savoir l’intériorisation des buts organisationnels par l’individu que Simon nomme encore « identification », « processus par lequel l’individu substitue les objectifs de l’organisation à ses propres buts »101. En effet, une plus grande efficacité de décision est atteinte, eu égard à la performance de l’organisation, quand le salarié a internalisé les buts et les normes de cette même organisation. Ce phénomène, Herbert Simon le nomme encore « docilité » qu’il définit comme « la tendance à se conduire d’une façon qui est approuvée socialement et à réfréner les conduites qui vont dans un sens qui est désapprouvé »102 et en fait même, dans une veine darwinienne revendiquée, la base de l’altruisme. La docilité se nomme aujourd’hui, dans les articles et les ouvrages de comportement organisationnel, « implication organisationnelle », « engagement organisationnel », « attachement organisationnel », « socialisation organisationnelle », « contrat psychologique » et même « justice organisationnelle » ou « citoyenneté organisationnelle »103, tous concepts qui renvoient d’une façon ou d’une autre à l’intériorisation des normes et des buts de l’organisation par l’individu.
Nous voici en mesure, pour conclure cette partie, d’assurer le départ entre l’amitié politique et l’amitié industrielle, entre l’utilité (aristotélicienne) et l’efficacité (managériale). Car l’on pourrait à juste titre nous objecter que la seconde ne constitue ni plus ni moins que la poursuite de la première puisqu’elles visent toutes deux une forme de « gain » ; mais ce serait là assurément s’arrêter à une première analyse par trop superficielle. En effet, ces deux formes d’amitié diffèrent de façon absolue pour deux raisons : tout d’abord, parce que la finalité des organisations (entreprise, association, collectivité, etc.) n’est pas assimilable au Bien commun, quand bien même certains courants théoriques prétendraient l’y substituer104 ; ensuite parce les deux formes d’amitié entretiennent un rapport tout à fait différent à la médiation et aux institutions : alors que l’amitié politique se développe dans le cadre juridico-politique de la cité et a pour finalité la perpétuation ou le renouvellement des lois, le droit (du travail, notamment) apparaît comme un obstacle à la réalisation de l’utopie de l’amitié industrielle, car toutes les contraintes qu’il impose tendent à rigidifier des relations et à freiner l’ajustement mutuel en temps réel.
Conclusion : neutralisation de l’être, polarisation de l’amitié, éclipse du bien commun
Voici ce qu’il nous semble avoir mis en évidence au terme de ce parcours : l’amitié, qui fut reconnue comme à la fois la condition de possibilité et la finalité de l’activité politique, c’est-à-dire de la recherche du bien commun, se trouve aujourd’hui dissoute dans le triomphe sinon planétaire du moins occidental de la déconstruction et du management scientifique.
Le succès de la déconstruction s’observe par le foisonnement des Critical Studies qui gagnent l’ensemble des disciplines scientifiques. Puisque tout est construit et que rien n’est naturel, en particulier dans les domaines humains que sont la société, la politique ou l’économie, alors il faut dégager la généalogie de chaque situation afin de défaire l’arbitraire domination et de promouvoir la libre affirmation de chaque subjectivité. Opération de dénaturalisation à reconduire pour chaque forme d’assignation identitaire qui serait vécue comme une insupportable entrave à l’émancipation. De ce point de vue, l’amitié, qui est une attache, un attachement, un lien, une obligation, et qui, par conséquent, implique le devoir de réciprocité, constitue une hétéronomie qui ne saurait en aucun cas fonder le « nouvel ordre social ».
Quant au management, il règne bien sûr dans les entreprises comme unique modalité d’organisation du travail, mais s’infiltre en outre dans les associations, dans le secteur médico-social, dans les différentes institutions publiques (armée, université, hôpital), dans l’État lui-même. Partout se trouve promues des relations immédiates, soit entre individus au nom de la réactivité des équipes, soit entre l’individu et l’organisation au nom de la croyance dans les normes de cette dernière. Il s’agit donc une amitié qui s’étale dans la stricte immanence, qui donne lieu à des relations duelles sans l’intervention d’un tiers symbolique et/ou institutionnel.
De façon plus générale, il convient de rattacher la crise contemporaine de l’amitié à l’ébranlement de la métaphysique grecque. À l’être, cette puissance de mise en relation, Maurice Blanchot (et Gilles Deleuze à sa suite) oppose en effet le neutre, cet in-différent qui se moque des formes et demeure dans l’indétermination : « Neutre, ce mot apparemment fermé, mais fissuré, qualificatif sans qualité, élevé (selon l’un des usages du temps) au rang de substantif sans subsistance ni substance… le neutre, qui, portant un problème sans réponse, a la clôture d’un aliquid auquel ne correspondrait pas de question. Car peut-on interroger le neutre ? Peut-on écrire : le neutre ? Qu’est-ce que le neutre ? Qu’en est-il du neutre ? »105. Nulle différenciation ne vient caractériser l’être : ce dernier est « ni, ni » : sans qualités, comme l’homme de Robert Musil.
Alors, sans puissance de mise en relation pour assurer leur liaison, chaque terme du cadran cosmique, exposé dans la première partie de cet article, se trouve délié et libre de vagabonder : l’Autre ne vaut plus que par lui-même, fuyant, tel le sophiste, toute tentative d’identification, et le Même, quant à lui, redonne consistance au grand rêve parménidien que le parricide platonicien avait pourtant écarté pour laisser éclore la philosophie. La neutralité de l’être, qui est en même temps sa neutralisation, engendre par conséquent la polarisation de l’amitié : soit sur l’Autre, qui requiert son inconditionnelle reconnaissance en dehors de toute appartenance ; soit sur le Même dont on exige de semblables compétences d’adaptation et d’ajustement à autrui. On aura ici reconnu les deux figures résiduelles qui demeurent une fois l’amitié et l’être révoqués : la déconstruction et le management.