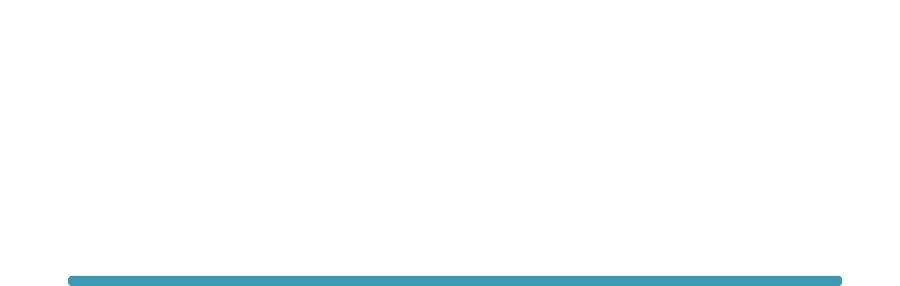La mythologie pour le droit. À la lecture du programme de cette matinée, il semblerait ainsi que le sens de la peine serait donc un mythe, au service du droit.
Ainsi présentée, notre intervention pourrait tourner court, tant il n’y aurait que peu à dire, une fois le postulat rappelé.
Toutefois, et l’on décèle ici l’ingéniosité des organisateurs de colloque, la question est loin de se résumer à la seule existence de ce mythe, que l’on pourrait décrire, tant les interrogations portant sur le sens de la peine sont nombreuses, certains s’interrogeant même sur le point de savoir si la peine a un sens.
La réponse à cette question est éminemment difficile, d’abord car « la peine » recouvre une réalité bien plus riche qu’il n’y paraît, et sans doute impossible à réduire à une simple catégorie de mesures qui poursuivraient le même objectif, qui auraient le même sens.
En effet, la peine renvoie presque instinctivement à la peine privative de liberté, à l’emprisonnement ou à la réclusion criminelle, peine principale et de référence des crimes et de la plupart des délits.
L’on pense ensuite à la peine d’amende, cette autre peine principale et de référence, cette seule autre peine principale et de référence puisque la contrainte pénale, dite encore la peine de probation n’a pas pu ou su accéder à ce rang lors de la réforme du 15 août 2014 (si on laisse de côté le TIG pour le tag).
Mais l’on pense aussi à l’ensemble des peines visées par l’article 131-3, à savoir la contrainte pénale, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, certaines peines privatives ou restrictives de droits (l’article 131-6 en liste 15), qui peuvent être prononcées à titre principal, mais aussi les peines complémentaires, ou la sanction-réparation.
L’on devine alors que le sens de la peine de réclusion criminelle est sans doute différent de celui de la sanction-réparation, ou de celui du retrait de permis de chasse (131-6, 8°). Et que dire alors de la dispense de peine, qui est prononcée à titre de « peine », selon les modalités prévues par l’article 132-59 du Code pénal ?
Pourtant, sans distinguer selon la peine en cause, le nouvel article 130-1 du Code pénal, issu de la réforme du 15 août 2014, prévoit que, « afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
Ainsi, selon ce texte, pour répondre à certains objectifs (la protection de la société et la prévention de la récidive), la peine doit être punitive et resocialisante. On s’interroge immédiatement sur la punition résultant d’une dispense de peine. On s’interroge surtout sur le point de savoir si ces fonctions correspondent au sens de la peine. Le sens de la peine se résumerait-il à ses fonctions ?
Pour définir le sens de la peine, il est classique de revenir sur le sens des termes en présence.
Dans son acception commune, le sens est « la signification qu’a une chose pour une personne et qui en constitue la justification », mais c’est aussi la direction, l’orientation que l’on souhaite donner à quelque chose.
La peine, vient du grec poids, c’est un fardeau porté par le délinquant, c’est la sanction pénale infligée au délinquant en réponse à l’infraction commise.
Le sens de la peine pourrait, selon ces définitions, recouvrir deux significations : le sens que la personne condamnée trouve dans la sanction prononcée à son encontre ou le sens que la personne qui l’établit et/ou la prononce souhaite donner à la peine. Le sens de la peine pourrait donc rejoindre le rôle qui lui est alloué par la société, en espérant que ce rôle soit compris et accepté par le délinquant, objet de la sanction.
Or, une fois que ceci est dit, les choses ne sont pas forcément plus simples puisque les fonctions dévolues à la peine sont multiples et évolutives.
La peine est un symbole du droit de punir de l’État, détenteur du monopole de la violence légitime. Elle est donc comprise comme la « rançon de l’acte antisocial », la réponse à la violation des règles de la société mise en place pour l’instauration et le maintien de la paix sociale. Elle permet d’affirmer les valeurs défendues par la société, de montrer l’efficacité du système pénal et de dissuader le délinquant comme la population de commettre une nouvelle infraction. Elle est ainsi à la fois expressive, rétributive, dissuasive, mais aussi resocialisante, puisque pour que le délinquant ne renouvelle pas l’infraction commise, il doit retrouver ou trouver sa place dans la société. L’on retrouverait ainsi les deux branches de l’article 130-1 du Code pénal.
Mais, il est complexe de recouvrir des fonctions aussi variées dans une même peine. L’évolution législative a d’ailleurs montré que l’équilibre entre ces trois fonctions était instable, voire inatteignable, une priorité étant donnée alternativement à l’un ou l’autre de ces rôles.
Si l’objet est précisé, la question reste donc entière, la peine, sans distinction a-t-elle un sens ? Et même, en distinguant, les différentes peines ont-elles un sens ?
L’on retrouve ici ces interrogations, touchant au sens ou au non-sens de la peine, lesquelles interrogations renvoient au caractère mythique ou mystique du sens de la peine.
Pour tenter d’apporter une réponse à ces interrogations, si tant est que la réponse existe, il est possible, en premier lieu, d’étudier le mythe, de revenir sur la mythologie du sens de la peine (I), afin d’en venir, en second lieu, au mystique, et peut-être à la mystification du non-sens de la peine (II).
I. La mythologie : le sens de la peine
Sur le sens de la peine et sa mythologie en premier lieu, la peine est un châtiment ; de ce point de vue, elle a un caractère rétributif, une logique punitive qui pourrait en être le sens (A). Cela étant, et puisqu’il s’agit de Crimes et de Châtiments, on peut s’intéresser ensuite à la vertu rédemptrice de la souffrance acceptée, selon la belle formule de Dostoïevki, à cette logique resocialisante, renforcée peut-être lorsque le consentement du condamné est recueilli (B).
A. Le mythe du châtiment : la punition
S’agissant d’abord de la punition et du mythe du châtiment, le châtiment est une punition sévère à celui qui a commis une faute pour le corriger. Il cache donc l’idée de souffrances pour répondre de l’infraction commise.
Cette fonction de la peine est la plus ancienne et n’est que la traduction du système ancestral de la vengeance privée où primait la loi du talion « œil pour œil, dent pour dent ». Elle n’est pas tournée vers l’avenir, contrairement aux autres fonctions de la peine, mais vers le passé, la faute commise, le trouble causé à la société dans son ensemble.
L’individu déviant doit être sanctionné, il doit rembourser la dette qu’il a à l’égard de la société – on retrouve alors la fonction rétributive de la peine. Il peut même être éliminé de la société s’il est trop dangereux pour sa stabilité – on voit ici la fonction d’élimination de la peine.
La rétribution, tout d’abord, est guidée par un sentiment de justice et par la volonté de rétablir l’équilibre social qui a été rompu lors de l’infraction. Si la souffrance n’est plus aujourd’hui physique, la survie du groupe ayant commandé de limiter l’intensité de la vengeance, la peine n’a pas pour autant perdu ce rôle. Il s’agit simplement plutôt aujourd’hui d’une souffrance morale.
L’élimination a pour rôle de protéger la société contre des individus qui, en raison de leurs crimes, apparaissent comme suffisamment dangereux pour ne pas pouvoir réintégrer la société sans risquer à nouveau de troubler l’ordre social.
Si cette fonction d’élimination a été amoindrie avec l’abolition de la peine de mort en 1981, elle perdure tout de même avec la peine de réclusion criminelle à perpétuité ou encore la rétention de sûreté, la « peine » après la peine.
La neutralisation de l’individu est en principe provisoire, mais entraîne l’élimination du condamné jusqu’à ce que soit envisagée une resocialisation réussie.
La punition, le châtiment ont donc un rôle essentiel dans le système pénal. Ils sont la crédibilité du système pénal censé protéger la société, mais ils sont aussi l’outil de compensation nécessaire à l’acceptation par la population de l’amendement du condamné.
La logique semble évidente, mais l’on retrouve l’interrogation déjà entraperçue tout à l’heure : toutes les peines sont-elles punitives ?
L’on s’interrogeait alors sur la logique punitive de la dispense de peine, et l’on pourrait y ajouter d’autres « peines », qui ne sont pas punitives, stricto sensu.
Ainsi, la sanction-réparation interpelle, tant l’objectif premier semble être la réparation du préjudice causé à la victime, bien plus que la sanction de l’auteur, même si l’intitulé de cette mesure veut allier l’une et l’autre.
À dire vrai, il semblerait que cette logique punitive ne soit plus recherchée, du moins systématiquement, dans les nouvelles peines introduites dans le Code pénal.
Tel était le cas de la sanction-réparation, tel est encore le cas de la contrainte pénale, cette peine quelque peu pléonastique introduite par la loi du 15 août 2014.
Poursuivant l’esprit de la conférence de consensus, laquelle avait proposé l’introduction d’une peine de probation « à la française », la réforme pénale de 2014 a en effet créé cette nouvelle peine, quoique les mesures qui la composent ne soient pas nouvelles.
Surtout, elle lui a assigné des objectifs spécifiques, puisque, selon l’article 131-4-1 du Code pénal, la contrainte pénale emporte obligation pour le condamné de se soumettre « à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société ».
Exit la référence au caractère rétributif : la peine de contrainte pénale de l’article 131-4-1 privilégie la réinsertion (et l’on comprend cet objectif), au détriment de la punition. Les deux objectifs de l’article 130‑1 semblaient contradictoires, la peine de contrainte pénale a choisi le sien.
Ainsi, si le sens de la peine est celui de la punition, le châtiment semble parfois n’être qu’un mythe, toutes les fois où la peine mise en œuvre n’est pas une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende, qui elles conservent cette logique punitive.
Faut-il réfuter le mythe ? Faut-il pour autant dénoncer cela ? Sans doute pas. Si cette distorsion porte atteinte au sens de la peine, à supposer qu’il existe, elle permet d’adapter la peine à la situation du condamné, afin de ne pas privilégier la punition au détriment de l’efficacité. Car s’il faut punir, il faut aussi prévenir, et lorsque les deux objectifs sont contradictoires, l’efficacité et l’apaisement du corps social imposent de rechercher la prévention, par la réinsertion.
Cette recherche d’efficacité est somme toute louable, mais elle est aussi difficile, voire illusoire dans certains cas. C’est la raison pour laquelle, au nom de cette recherche d’efficacité, les différents dispositifs viennent parfois rechercher le consentement du condamné.
B. Le mythe de la rédemption : le consentement
S’agissant ensuite du consentement à la peine, et du mythe de la rédemption, Emmanuel Gounot rappelle que « la volonté n’est ni la cause efficiente ni la cause finale du droit, elle n’en est que la cause instrumentale ». Cette volonté, assimilable au consentement, a été mythifiée pour donner à la peine son rôle d’amendement. Le condamné souhaitant obtenir la rédemption, c’est-à-dire racheter sa faute, accepterait la peine à laquelle il est condamné.
D’origine chrétienne – la doctrine de l’Église a toujours reposé sur une peine tournée vers l’avenir et vers la régénération morale de l’homme –, cet objectif alloué à la faute serait indispensable pour que la peine soit efficace et que la personne ayant fauté retrouve une place dans la société, sans commettre à nouveau les mêmes erreurs.
Or, ce consentement à la peine considéré comme un acquis repose lui-même sur un mythe plus général, celui du Contrat social. Étape nécessaire à la construction de toute société organisée et au maintien de la cohésion sociale, le contrat social serait accepté par tous et surtout par chacun. Pour vivre en paix et être protégés contre les autres, les hommes acceptent de sacrifier une part de leur liberté et de la déléguer à l’État, qui devient alors dépositaire du droit de punir, part essentielle du dispositif de sécurité permettant d’assurer la paix sociale et de lutter contre la déviance des individus.
C’est donc au nom de cet impératif supérieur que le citoyen « consent à toutes les lois, même à celles que l’on passe malgré lui, et même celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu’une » (Rousseau).
Ce mythe est jugé nécessaire pour affirmer que la base de la construction sociétale repose sur la liberté de l’individu, qui a consenti pour assurer sa sécurité et son bonheur, à se regrouper sous forme de société et à s’exprimer par le biais de la volonté générale. Or, l’objectif de tout individu qui commet une infraction n’est évidemment pas d’être puni, mais l’espoir d’un gain et d’échapper à la sanction. Et, s’il est condamné et qu’il consent à la peine, ce n’est pas par volonté, mais plutôt par obligation de se soumettre à la loi. Toutefois, le droit, pour assurer la cohérence de l’ordre juridique construit notamment sur la liberté individuelle, a besoin d’estimer que chaque condamné consent à la peine au nom de l’intérêt général.
Mais ce consentement général, presque absolu, n’est-il qu’une fiction ? N’est-il pas supplanté, remplacé par la recherche d’un consentement particulier ?
Dans les lois récentes, on observe de plus en plus une volonté du législateur de s’assurer un consentement réel de la part du condamné.
Ainsi les articles 131-5-1 et 131-8 consacrés au stage de citoyenneté et au travail d’intérêt général précisent que ces peines ne peuvent être prononcées contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience.
De même, lors de la composition pénale créée en 1999 applicable aux contraventions et à quelques délits ou lors de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, procédure créée en 2004, applicable à la majorité des délits, si la personne poursuivie reconnaît sa culpabilité et accepte la peine proposée par le procureur de la République, elle peut éviter la lourdeur du procès et de l’examen en audience.
Ainsi, le condamné consent à la peine, soit parce que celle-ci lui semble, en elle-même, profitable, soit parce que la réduction de son quantum lui semble profitable. Et un tel consentement pourrait traduire une plus grande acceptation de la sanction subie, et donc une meilleure responsabilisation, une meilleure rédemption. De ce point de vue, le consentement renforce l’efficacité de la peine, et il renforce aussi l’efficacité de la procédure, en la simplifiant.
Toutefois, s’agissant du consentement à la peine, l’on retrouve ici deux interrogations, sur sa réalité, mais aussi sur les motivations du condamné.
En effet, dans certaines hypothèses, l’on peut se demander si un tel consentement n’est pas contraint. Pour répondre à cette question, il faut s’intéresser aux conséquences du refus, et l’on constate alors que, bien souvent, face au refus, face à l’impossibilité de pouvoir prononcer une peine alternative, la juridiction en revient bien souvent à la peine de référence, à savoir l’emprisonnement ; la menace d’une privation de liberté interpelle donc sur la liberté du consentement donné.
Certes, la contrainte qui pèse sur le consentement de l’intéressé ne le prive pas pour autant d’effet, il ne s’agit pas de transposer ici les solutions du Code civil, des articles 1111 et suivants, bientôt des articles 1140 et suivants. Mais il n’en demeure pas moins que la vertu rédemptrice semble quelque peu illusoire, tant l’adhésion du condamné à sa peine est moins libre qu’il y paraît.
À l’inverse, dans d’autres hypothèses, l’on se demande si le consentement n’est pas intéressé ? Au-delà de la contrainte, il faut aussi tenir compte d’une réalité, celle d’une logique économique présidant l’acceptation de la peine par l’intéressé. Bien loin d’accepter sa souffrance, avant de s’amender, le condamné, surtout lorsqu’il a de l’expérience, procède à un bilan coût/avantage et accepte la peine lorsqu’il y trouve un intérêt.
Ce bilan, et le consentement qui en est le fruit sont alors plus le choix d’un moindre mal que la traduction d’une véritable rédemption.
De nouveau, cette logique économique atténue la vertu d’amendement qui semblait pourtant gouverner le consentement à la sanction.
Ainsi, si le consentement à la peine est désormais fréquent et recherché, la rédemption semble-t-elle aussi n’être qu’un mythe, tant le consentement apparaît tantôt contraint, tantôt intéressé.
La peine ne serait donc pas nécessairement un châtiment, et même lorsque la souffrance est acceptée, la peine ne permet pas nécessairement cette rédemption que l’on espérait. Ni châtiment, ni rédemption, quel est alors le sens de la peine ? A-t-elle seulement un sens ? C’est toute la question du non-sens de la peine.
II. La mystification : le non-sens de la peine
S’agissant, en second lieu, du non-sens de la peine, l’on se demande en effet si cette question du sens et du non-sens ne traduit pas une certaine mystification.
Qu’il s’agisse de la fonction rétributive ou de la fonction resocialisante, les peines, réunies au sein d’une catégorie extrêmement hétérogène, ne semblent pas correspondre toute à la même logique, elles ne semblent pas avoir toutes le même sens. Plus encore, à ne raisonner que sur la peine d’emprisonnement, que sur la peine prononcée, le sens de la peine semble avoir disparu, tant les hypothèses d’aménagement sont nombreuses et variées (A). Toutefois, l’on peut ensuite s’interroger sur le point de savoir si la peine ne pourrait pas retrouver un sens, son sens (B).
A. Le sens disparu
Tout d’abord, la fonction rédemptrice de la peine semble s’être amoindrie, voire même avoir disparu pour nombre de peines. En effet, la peine semble avoir perdu son sens pour l’individu condamné, auquel la société ne croit plus et ne laisse aucune chance de réintégration, ou encore pour les individus malades et donc condamnés alors même qu’ils ne sont pas capables de comprendre la peine subie.
Pour les premiers, le dispositif législatif mis en place depuis trente ans montre clairement à leur égard une volonté de neutralisation.
Déjà, en 1978, avec l’article 720-2 du CPP, le législateur a permis au juge de fixer des périodes de sûreté lors du prononcé de la peine d’emprisonnement, c’est-à-dire de fixer un laps de temps durant lequel le condamné ne peut bénéficier d’aucune mesure d’aménagement de peine telles la libération conditionnelle ou la semi-liberté. Loin d’être symbolique, cette période de sûreté peut être portée à trente ans lors de meurtres ou d’assassinats punis de la réclusion criminelle à perpétuité selon les articles 221-3 et 221-4 du CP. Ces articles vont même jusqu’à permettre au juge de prononcer une peine à perpétuité sans possibilité d’aménagement, rendant alors la peine à perpétuité incompressible.
Cette possibilité de perpétuité réelle, loin d’être un cas d’école, a elle aussi été progressivement étendue, que ce soit pour les cas d’assassinats prévus à l’article 221-3 du CP ou pour les cas de meurtres prévus à l’article 221-4. Ce dernier a d’ailleurs été modifié 11 fois depuis sa création en 1994 transformant la liste initiale des circonstances aggravantes permettant de condamner un meurtrier à la peine de réclusion criminelle à perpétuité en un véritable catalogue. On passe de 5 circonstances aggravantes en 1994 à 12 aujourd’hui.
De plus, poursuivant toujours cet objectif de neutralisation, la loi du 25 février 2008 a créé un autre dispositif, la rétention de sûreté. Prévue aux articles 706-53-13 et suivants du CPP, elle consiste dans le placement en centre médico-socio-judiciaire de sûreté des personnes condamnées pour des crimes très graves, à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle, dont il est établi qu’elles présentent, à la fin de l’exécution de leur peine une particulière dangerosité. Le condamné peut donc, à l’issue de sa peine, c’est-à-dire lorsqu’il a en principe déjà racheté sa faute à la société, être maintenu à l’écart de cette même société.
Cette neutralisation supplémentaire, bien que prononcée pour un an, est renouvelable sans limites, tant que les critères initiaux permettant la rétention de sûreté sont remplis (présenter une particulière dangerosité, critère relativement flou et difficilement définissable), permettant alors une neutralisation définitive de l’individu.
De surcroît, si la rétention de sûreté n’est pas prononcée ou renouvelée, une mesure de surveillance de sûreté peut être prononcée pour deux ans, renouvelable une fois encore, laissant planer une épée de Damoclès au-dessus de l’individu pouvant être, en cas de comportement déviant ou de non-respect des obligations qui lui sont imposées (injonction de soins, interdiction de certains lieux ou de fréquenter certaines personnes), à nouveau retenu.
Si la possibilité d’une perpétuité réelle a été jugée constitutionnelle en 1994 et conventionnelle en 2014, du seul fait que le JAP puisse mettre fin à ce régime particulier, au regard du comportement du condamné et de l’évolution de sa personnalité en application de l’article 720-4 du CPP, une telle sanction permet‑elle de remplir la fonction rédemptrice de la peine ? Quel sens un individu peut-il donner à une peine d’exclusion dont il ne connaît pas l’échéance ou lorsque celle-ci est si éloignée qu’il est impossible pour lui de se projeter si loin ? Et alors, comment préparer sa réintégration dans la société, sa réinsertion, lorsqu’elle ne peut même pas être envisagée ?
On se rapproche ici des postulats relatifs à la peine de mort, à savoir l’exclusion à vie. C’est donc un renoncement à la foi que l’on doit avoir dans l’homme, et si la société ne croit plus en lui, comment le délinquant pourrait-il croire au rachat de sa faute et à sa rédemption ?
La peine à vie nie tout libre arbitre à l’être humain et toute faculté d’évolution, perdant ainsi tout rôle d’amendement. Puis, même si le condamné réintègre un jour la société, sa peine, très longue, n’aura‑t‑elle pas contribué à sa désocialisation plutôt qu’à la préparation de sa réintégration ? Ne s’éloigne-t-elle pas une fois encore de son objectif de resocialisation ?
En outre, la prison est un lieu où le taux de pathologies psychiatriques est 20 fois supérieur à celui de la population générale, et elle est un facteur d’aggravation des troubles mentaux.
Alors que la refonte des articles 122-1 et 122-2 du CP a conduit à une pénalisation plus forte des personnes atteintes de troubles mentaux, une simple « altération » des facultés mentales lors de la commission de l’acte infractionnel n’empêchant plus le prononcé d’une peine, le taux d’irresponsabilité pénale est passé de 17 % il y a vingt ans à moins de 1 % aujourd’hui.
20 % des détenus seraient atteints de maladies psychiatriques que seul l’hôpital peut soigner, et nous savons que les soins en prison, s’ils existent, sont loin d’être optimum.
Quel sens donné à la peine pour ces personnes malades ? Peuvent-elles comprendre la sanction prononcée à leur encontre pour essayer de s’amender envers la société ?
Dans les deux cas évoqués, avec cette disparition de la perspective d’un amendement, ou avec cette impossible compréhension par l’intéressé de sa sanction, et donc son impossible amendement, la peine perd donc son sens pour le condamné.
Dans d’autres cas, c’est le sens qu’elle peut avoir pour la société qui disparaît.
La perte de sens, pour la société, se retrouve sans doute dans la disparition de la rétribution, non plus dans la peine elle-même, dans les types de peines, mais dans la possibilité d’aménager la peine prononcée, au nom de la société.
En effet, les décisions pénales sont rendues au nom du peuple français, et l’on pourrait considérer que la peine, issue de la condamnation, est ce châtiment vu comme juste, nécessaire pour assurer la rétribution de la souffrance causée, d’un point de vue bien évidemment conceptuel.
Cette peine n’est plus nécessairement punitive, on a pu voir que certaines peines visaient plus la rétribution et la réinsertion que la punition, mais la peine prononcée prétend toujours être cette réponse apportée à l’infraction, pour atteindre les objectifs assignés.
Or, il est surprenant de constater que cette peine, à peine prononcée, peut être immédiatement aménagée, transformée.
L’article 132-57 du Code pénal permet en effet, lorsque la condamnation porte sur une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois au plus, de demander au juge d’application des peines d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette peine et qu’elle soit « convertie », en peine de travail d’intérêt général. Elle peut également être convertie en jour-amende.
La loi du 17 août 2015 avait même voulu étendre cette possibilité de conversion, pour pouvoir convertir la peine de six mois d’emprisonnement ferme en peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, ou en peine de contrainte pénale. Retoqué par le Conseil constitutionnel, ce cavalier législatif n’a finalement pas été transcrit en droit positif, mais l’on voit ici la logique.
Cette même logique se retrouve encore et toujours s’agissant de la peine privative de liberté, dans l’article 723-1, ou encore dans l’article 723-7, du Code de procédure pénale qui permettent de prévoir qu’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure à deux ans, ou dont la durée restant à effectuer est inférieure à deux ans, s’exécutera sous le régime d’une semi-liberté, d’un placement extérieur, ou d’un placement sous surveillance électronique. Et l’article 723-15 du même Code permet ensuite de convertir ces modes d’exécution des peines entre eux !
À l’évidence, ces différents modes de conversion ou d’exécution des peines modifient sensiblement la peine prononcée par la juridiction. Que reste-t-il de l’autorité de la chose jugée ? Surtout, que reste-t-il de l’autorité de la peine, de son sens rétributif, si celle-ci, une fois prononcée, est immédiatement remplacée par une autre ?
La question se pose, mais sans dogmatisme, car il faut se garde de rechercher la sévérité ou l’autorité, au détriment de l’efficacité.
Quoiqu’il en soit, dans un cas, comme dans l’autre, la peine semble perdre son sens, ou ses sens, si l’on distingue le sens qu’elle peut avoir pour le condamné, ou pour la société. N’en retrouve-t-elle toutefois pas un autre ?
B. Le sens retrouvé ?
La réforme pénale de 2014 semble avoir tenté de donner un nouveau sens à la peine. Intervenue suite à la mise en place d’une conférence de consensus sur la prévention de la récidive, processus de réflexion original et transdisciplinaire, elle apparaît comme une réforme réfléchie, loin de la précipitation des réformes précédentes survenues à chaque fois en réponse à des affaires médiatiques.
Déjà, lorsque cette conférence a rendu son rapport, est apparue une volonté de rendre la peine plus efficace en travaillant son individualisation et en la tournant vers la réinsertion. L’objectif affiché était alors de faire de la prison seulement une peine parmi d’autres et non plus la peine de référence, puisqu’elle n’offre qu’une « sécurité provisoire » à la société.
Si toutes les propositions effectuées par la conférence de consensus n’ont pas été retenues par le législateur, les débats sur la réforme pénale ayant été particulièrement animés, la loi d’août 2014 s’inscrit tout de même de manière marquée dans cette logique.
D’abord, elle met en place un article nouveau, expliquant le sens qu’il faut donner à la peine, l’article 130‑1 du CP.
Répondant à une lacune antérieure du Code pénal qui n’établissait pas clairement quel était le sens de la peine, cet article distingue le rôle de la peine et ses fonctions.
Si son rôle n’évolue guère, il s’agit d’« assurer la protection de la société », de « prévenir la commission de nouvelles infractions » et de « restaurer l’équilibre social », rappel de l’aspect pacifique, rétributif et dissuasif de la peine, ses fonctions sont clairement affichées comme doubles : « sanctionner l’auteur de l’infraction » et aussi « favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ». Ainsi, la peine doit donc punir et réinsérer, punir et amender.
De prime abord, on revient ici au mythe initial.
Pourtant, si l’on s’interroge sur l’équilibre entre ces deux fonctions, et même si la punition apparaît toujours en premier, il ne semble plus qu’elle soit la fonction principale de la peine.
En effet, la loi de 2014 montre un réel souhait de tourner prioritairement la peine vers la réinsertion afin de lutter contre la désocialisation et la récidive. Elle veut faire sortir les condamnés de la spirale de la délinquance.
Ainsi, elle continue le travail commencé par la loi de 2009 qui avait inscrit à l’article 132-24 alinéa 3 du CP qu’« en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». En supprimant l’article 132-19-1 relatif aux peines planchers pour les récidivistes, le caractère automatique de la révocation du sursis simple en cas de récidive de l’article 132-36 du CP, et le passage consacré à ces derniers dans l’article 132-24, elle assimile aujourd’hui le régime des récidivistes à celui des non-récidivistes. La peine de prison en matière délictuelle devient l’exception.
Par ailleurs, si toutefois une telle peine est prononcée, elle doit dans la mesure du possible faire l’objet d’aménagements comme la semi-liberté, le placement à l’extérieur, le placement sous surveillance électronique ; et, si le choix d’un emprisonnement ferme est effectué, il doit être spécialement motivé par le juge « au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale »
Dans le même esprit, le législateur a développé les alternatives à la peine d’emprisonnement de l’article 131-3 du CP et créé la contrainte pénale à l’article 131-4-1. Si son rôle d’alternative à la prison n’est pas explicite, il ressort de manière certaine des travaux législatifs. Mécanisme permettant à la suite d’un processus d’évaluation de la personnalité et de la situation du condamné, de prononcer des obligations et interdictions particulières (TIG, injonction de soins, stage de citoyenneté, interdictions de fréquenter certains lieux ou certaines personnes…), la contrainte pénale est tournée essentiellement vers la resocialisation ; la peine prononcée étant modulable en fonction du comportement du condamné et l’emprisonnement encouru n’étant effectué qu’en cas de non-respect des obligations établies.
Cette peine a ainsi trois volets – privatif de liberté, surveillance et médico-social- et englobe tous les objectifs de la peine : rétribuer la société, punir, protéger la société et réinsérer. Mais elle fait tout de même le choix de privilégier la réinsertion en essayant de fournir les outils nécessaires pour que le condamné retrouve sa place dans la société et ne récidive pas, et en faisant de la neutralisation une solution de dernier recours. Cette peine répond donc exactement aux objectifs de l’article 130-1 du CP.
Elle n’a toutefois pas été consacrée comme une peine de référence par le législateur malgré le projet initial. Applicable aux délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement, elle devrait toutefois être étendue à tous les délits d’ici 2017.
Avec cette réforme, la lutte contre la désocialisation et la récidive est donc clairement affichée comme un objectif prioritaire.
Surtout, à travers de logique de lutte contre la désocialisation et la récidive, l’on voit poindre l’objectif assigné à la peine, celui d’être efficace.
L’efficacité ne s’entend plus de la sévérité de la peine, de son châtiment, de ses caractères afflictifs et infamants, comme cela était le cas.
L’efficacité ne s’entend plus de la rétribution, d’une souffrance causée au détenu équivalente à celle causée à la société.
Elle privilégie désormais l’amendement et la réinsertion, quelles que soient les proclamations incantatoires du Code pénal ou du politique.
L’objectif est difficile à atteindre, tant les intérêts en présence sont nombreux, et parfois antinomiques, mais il nous semble louable.
Si la peine doit avoir un sens, c’est celui d’être efficace, pour restaurer le lien social, pour mettre fin au trouble résultant de l’infraction et surtout pour permettre à chacun de retrouver une place au sein de la société.
L’objectif est difficile, il suppose une adaptation perpétuelle, une malléabilité de l’appareil répressif. Si la peine a un sens, si ce sens est un mythe, c’est sans nul, du point de vue de cet objectif, le mythe de Sisyphe.