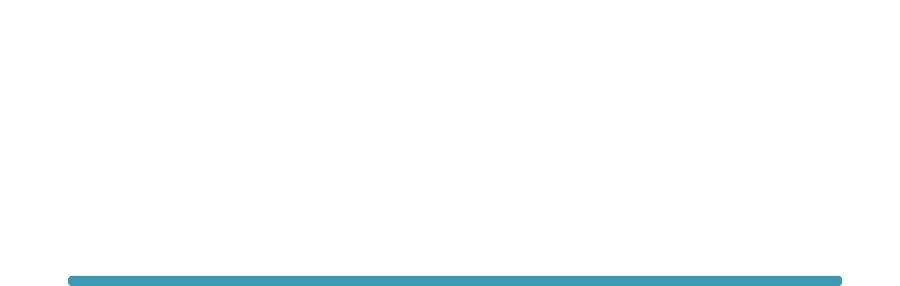L'affaire Ferrand défraya la chronique judicaire de la première moitié du xviiie siècle, tant par la famille mise en cause, que par le cas d’espèce et le parfum de scandale qu’il dégagea. En 1735, mademoiselle de Vigny, quarante-neuf ans, intenta un procès contre dame Anne Bellinzani1, soixante-dix-huit ans, veuve de Michel Ferrand, Président aux Requêtes du Palais, pour se faire reconnaître comme la fille légitime du couple Ferrand, née en 1686.
Les archives de la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont-Ferrand conservent un ensemble de onze documents, qui à l’origine composaient une partie des archives familiales du comte et de la comtesse de Canillac de Pont du Château2 et qui se rapportent à cette affaire :
- Huit d’entre eux sont des mémoires judiciaires émanant des différentes parties :
- « Mémoire pour Dame Anne Bellinzany, veuve de Messire Michel Ferrand, Président en la première Chambre des requêtes du Palais/ contre Demoiselle de Vigny, demanderesse », 1735,
- « Mémoire pour la comtesse de Canillac, marquise de Pont du Château et Monsieur le Président de la Faluère, défendeurs/ contre la demoiselle de Vigny, demanderesse », 1736,
- « Mémoire signifié pour dame Marie Françoise-Geneviève Ferrand, épouse autorisée par justice de Messire Denis Michel de Canillac, Marquis du Pont du Château, demanderesse en séparation de biens/ contre le Sieur Marquis du Pont du Château, son mari », 1737,
- « Mémoire pour la Comtesse de Canillac, la marquise du Pont du Château et Monsieur le Président de la Faluère, Défendeurs/contre la Demoiselle de Vigny, fille majeure, demanderesse », 1737,
- « Mémoire pour la demoiselle Ferrand, Intimée/ contre Madame la Présidente Ferrand, appelans dame Élisabeth Ferrand, veuve de monsieur le Comte de Canillac, Monsieur le Marquis du Pont du Château et dame Marie Françoise Ferrand, son épouse et Monsieur le Président de la Faluère », 1738,
- « Mémoire pour Anne de Bellinzani, veuve de Michel Ferrand, Président aux Requête du Palais, appelante/ contre la demoiselle de Vigny, Intimée », 1738,
- « Mémoire pour Michelle Ferrand, demoiselle, demanderesse/ contre maître Pierre de May, Conseiller du Roi, Notaire au Châtelet, défendeur », 1742,
- « Mémoire signifié pour Denis Michel de Montboisier Beaufort Canillac, Marquis du Pont de Château, appelant d’une sentence de séparation de corps et de biens rendue au Châtelet de Paris le 4 septembre 1744/ contre Messire Nicolas de Baillé, prêtre Chanoine de l’Église des Comtes de saint de Lyon, légataire universel de Dame Marie‑Françoise‑Geneviève Ferrand, marquise du Pont du Château, Intimé », 1746 ;
- Il y a une réflexion personnelle sur l’affaire émanant de la Présidente Ferrand : « Réflexions de Madame la Présidente Ferrand », 1736 ;
- Un plaidoyer de l’avocat de madame Ferrand : « Plaidoyer pour madame la Présidente Ferrand/ contre demoiselle de Vigny », 1736 ;
- Une addition à un mémoire de mademoiselle Vigny : « Addition au Mémoire pour demoiselle Michelle Ferrand, fille majeure, demanderesse/ contre Dame Anne de Bellinzani, veuve de Monsieur le Président Ferrand et dame Élisabeth Ferrand, veuve de monsieur le Comte de Canillac, M. Marquis du Pont du Château et dame Marie Françoise Geneviève Ferrand, son épouse et messire Antoine René Le Fèvre de la Faluère, Défendeurs », 1736.
La chronologie de cet ensemble de documents commence en 1735, alors qu’un arrêt fut rendu et qu’il renvoya les deux parties à appointer en preuves i.e. à présenter plus de preuves pour appuyer leurs arguments devant les juges du Châtelet. Le Châtelet est le tribunal de première instance à Paris3. Le dernier document date de 1742, mademoiselle Ferrand (ex mademoiselle De Vigny) voulu alors faire annuler le testament de madame Ferrand qui la déshéritait.
Ces documents sont les témoins d’une affaire célèbre qui a partagé les juristes de Paris4 au xviiie siècle.
Ils nous permettent de reconstituer une partie de l’argumentation présentée aux juges par les deux parties, tout en observant que cette argumentation ne se teinte véritablement d’éléments juridiques qu’après que les juges eurent demandés l’appointement en preuve. Avant cela, les parties ne se contentaient que de relater leurs interprétations des faits.
I. L’affaire judiciaire
A. Les faits établis
Cette affaire est complexe par l’importance des témoignages a posteriori des faits, puisqu’il s’agit de reconstituer une histoire qui eut lieu quarante‑neuf ans auparavant.
Toutefois, certains faits sont avérés, puisqu’ils sont repris par les deux parties.
Le père d’Anne de Bellinzani tomba en disgrâce royale peu avant 1686. Cette disgrâce toucha ses biens et les membres de sa famille, dont sa fille Anne mariée au Président5 Ferrand depuis 1676. Ces derniers avaient déjà eu trois enfants, un garçon et deux filles. Le Président Ferrand s’appuyait sur la dot de sa femme pour entretenir sa maisonnée. Or, cette situation provoqua des troubles dans le couple Ferrand et madame Ferrand demanda la séparation de corps, avec consentement de son mari, bien qu’elle fût enceinte. Elle accoucha le 28 octobre 1686, d’une fille dans la paroisse de Saint Sulpice, à Paris. Puis, non remise de ses couches, elle fut exilée hors de Paris, sur ordres du Roi. Elle vécut dans divers couvents. Le nourrisson ne suivit pas sa mère. Il fut confié à madame de Bellinzany, sa grand‑mère. Il mourut rapidement selon les dires de cette dernière qui en informa madame Ferrand lors de son exil.
La première partie du problème est que madame Ferrand ne peut pas produire d’extrait mortuaire, quarante‑neuf ans après les faits. Elle justifie cela en disant que ce fut son mari qui eut le document et qu’il a dû le brûler par erreur.
La seconde partie du problème est que les circonstances du baptême sont obscures : le 28 octobre 1686 sur les registres baptismaux de la paroisse, une fille fut baptisée sous le prénom de Michelle, sans aucune mention du père et de la mère6. Les parrains et marraine étaient des mendiants. Le père était absent et une note du curé de saint Sulpice, en bas de page du registre, précise qu’il crût devoir ne pas mettre le nom du père et de la mère car personne digne de foi, ne pouvait en attester. Il prévint monsieur Ferrand qui lui interdit de déclarer cette fille à son nom.
Des années plus tard, monsieur Ferrand fit un acte notarié pour allouer une rente à cette enfant en y joignant une copie de l’extrait baptistaire7.
En 1693, dame Bellinzany confia à madame Ferrand, sa fille, le projet de faire conduire une bâtarde de son frère8 au couvent de Rhodez. Elle lui demanda alors de lui prêter sa femme de chambre pour que le secret soit plus en sûreté que si elle avait employé ses propres domestiques. À sa mort, dame Bellinzany pria madame Ferrand de continuer de s’occuper de cette bâtarde.
À quarante-neuf ans, cette personne, mademoiselle de Vigny, voulut faire reconnaître sa légitimité comme fille du Président et de la Présidente Ferrand. Elle aurait été mise au courant de ses origines par monsieur de Bellinzany, le frère de madame Ferrand, et en l’occurrence son oncle. Il lui aurait ouvert les yeux avec la complicité de l’Abbé de Goué et du curé Carion qui lui auraient également fourni des preuves pour faire valoir ses droits9.
Selon madame Ferrand, son frère aurait mis au point cette machination pour capter sa fortune en faisant épouser à mademoiselle de Vigny, une fois reconnue, son propre fils.
Monsieur de Bellinzany meurt et mademoiselle de Vigny entama quand même la procédure.
B. L’évolution de l’argumentation juridique
Les premiers mémoires écrits à partir des plaidoyers ne reprennent pratiquement que ces faits et leurs interprétations car ils se basent sur l’absence de preuve de mademoiselle de Vigny pour justifier sa demande et les vides de la reconstitution de sa vie de couvent en couvent. L’avocat de madame Ferrand insiste sur le fait que les preuves testimoniales ne sont pas recevables en matière d’état, cela, en vertu du droit public et des ordonnances du royaume. Il ne cite pas ses références en détails, sauf lorsqu’il fait référence à la jurisprudence de la cour. Il cite en effet l’arrêt Sazilly pour appuyer son argumentation. L’affaire Sazilly avait été portée devant des premiers juges qui « avaient admis la preuve par témoins […] qui a ensuite été infirmée par d’autres juges et la demande fut déboutée10 ».
Après le premier arrêt rendu par le Châtelet, le 27 août 1737, les parties sont renvoyées à fournir plus de preuves. Dès lors les mémoires deviennent de plus en plus étoffés d’argumentation juridique.
Les mémoires des deux parties enrichissent, dès lors, leurs argumentations en se référant aux auteurs et interprètes du droit qui admettent trois faits principaux comme preuve de la paternité lorsque la possession d’état n’est pas avérée :
- Le denominationem, c’est la preuve la plus importante et ce serait, en l’espèce, l’acte baptistaire ;
- Le tratcatum i.e. les soins reçus ;
- La famam i.e. comment apprend-on sa filiation légitime.
Dans ces documents, le droit n’est pas à la première place et n’est finalement pas très détaillé. C’est assez rare surtout dans les mémoires du xviiie siècle, parvenus jusqu’à nous, qui sont normalement de véritables encyclopédies du droit. La raison en est l’état du droit sur ces questions.
II. Le droit de la famille par le prisme de ces documents
Le problème de mademoiselle Ferrand est lié à l’onomastique, peut-elle ou non porter le nom de son père ?
A. Le nomen
Or, depuis le Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, il n’y a que très peu de règles en la matière11. Selon le droit canonique, le nom par excellence reste celui du baptême. Quelques statuts synodaux précisent l’attribution et le choix du nom. L’Église laisse alors une grande part à l’usage profane12.
Le « nomen sert à établir la possession d’état d’un enfant légitime. C’est le fait que les parents ont attribué à l’enfant le nom de fils ou de fille devant des tiers, par exemple des voisins ou encore dans un testament, c’est‑à‑dire qu’ils aient reconnu publiquement la filiation13 ».
Anne Lefebvre-Teillard précise encore que ce n’est pas le fait pour l’enfant de porter le nom de son père que le nomen vise, comme cela sera le cas dans le Code Civil de Napoléon.
Dans les argumentations juridiques des mémoires en faveur de mademoiselle Ferrand, on voit cette évolution. En effet, maître Cochin répète dans ces arguments que mademoiselle De Vigny est la fille légitime de ses parents car elle fut inscrite dans plusieurs couvents, entre autres, sous le nom de Ferrand, et donc qu’elle est légitime puisqu’elle a porté le nom de son père.
Le fait que mademoiselle de Vigny change plusieurs fois de nom est totalement banal puisqu’elle est assimilée à une bâtarde. Il est courant que les bâtards soient baptisés d’un nom et élevés sous un autre14. En revanche, ce qui est plus rare, c’est d’avoir été mise en nourrice et que ce soit sa grand-mère qui assure les frais des couvents. En général, ce sont les pères qui assurent les frais d’entretiens des enfants illégitimes15.
B. La séparation d’habitation
C’est le paradoxe de cette affaire : mademoiselle Ferrand est née lors du mariage de ses parents et pourtant, elle est traitée comme une enfant adultérine.
Dès avant sa naissance, la situation entre ses parents était compliquée puisqu’ils se séparèrent. Madame Ferrand expose que ce fut d’un commun accord avec le Président Ferrand pour cause de mésentente de ménage, accentuée par la disgrâce royale touchant sa famille16. Toutefois, c’est une version dont nous mettons en doute la totale véracité des causes allouées à cette séparation. Madame Ferrand est enceinte de deux mois lorsque l’acte notarié est signé par les deux époux. Il n’est fait aucune mention de sa grossesse dans celui-ci, mais surtout si la cause de la séparation n’était que de la mésentente et des rixes, monsieur Ferrand aurait-il interdit au curé d’écrire son nom sur le registre baptismal ?
Depuis le Moyen Âge, la séparation des époux existe et elle est justifiée par des textes évangéliques qui renvoient le conjoint adultérin17. Mais le lien du mariage, le matrimanium consummatum est indissoluble. Toutefois, le droit canonique proposa quelques solutions pour les couples en difficulté. La première de celle-ci est la tentative de réconciliation : la reconciliatio18. Lorsqu’elle est impossible, le droit canonique autorise l’official à séparer les époux sans toucher la pérennité du lien sacré du mariage19.
Il y a deux sortes de séparation : la séparation de corps et la séparation d’habitation.
La séparation de corps20 peut être prononcée par le juge d’Église soit en cas d’adultère ; en cas d’hérésie ou d’apostasie. Peu à peu, au cours du Moyen Âge, un autre cas de séparation de corps fut admis lorsque la vie était d’un conjoint était en cause ou que des sévices graves étaient prouvées21.
La mésentente n’était alors pas envisagée comme motifs de séparation de corps. Les juges étaient très respectueux du droit canonique et n’autorisaient aucun autre motif22.
Mais la séparation de fait demeurait. Cela aboutit à l’extension de la catégorie des sévices graves à celle de l’incompatibilité d’humeur qui regroupa des sévices simples où des actes répétés23. Alors, les juges accordèrent la séparation d’habitation24, qui est une séparation de corps laissant subsister le lien matrimonial et l’obligation du devoir conjugal. La conséquence en est la fin de la vie commune et la liquidation du régime matrimonial, mais sans sanction pour l’époux fautif. Cette pratique fut très fréquente à Paris dès le xvie siècle. De 1384 à 1387, il y eut 116 séparations d’habitation prononcées, par l’officialité épiscopale, sur un total de 124 séparations25. Pendant l’Ancien Régime, le juge s’immisça dans ce domaine par le biais des pactes entre époux26. Et, au xviiie siècle, la pratique de la séparation d’habitation resta d’actualité. Les mémoires de madame Ferrand sont étonnants car cette séparation fut passée devant un notaire et non devant un juge27, mais surtout parce qu’elle fut justifiée par une simple mésentente. Monsieur Ferrand eut pu se séparer de sa femme définitivement en mettant en question l’origine de sa grossesse, puisqu’il douta de sa paternité à la naissance de l’enfant, ce qui est le point névralgique de l’affaire. Il dû avoir peur de l’opprobre et peut-être avoir quelques doutes. La séparation eut lieu alors que madame Ferrand était enceinte et que la grossesse était publique. Il y eut une dissolution du régime matrimonial puisque monsieur Ferrand retourna vivre au sein de sa famille et que madame Ferrand vécut au couvent puis seule dans un appartement à Paris.
Madame Ferrand accoucha à Paris dans la paroisse Saint Sulpice. L’accouchement fut difficile et elle eut du mal à se relever de ses couches. L’enfant était une fille. Elle fut baptisée. Elle ne fut pas pour autant légitime.
C. L’acte baptistaire
En 1686, les registres paroissiaux servaient déjà d’état civil. L’Ordonnance de Villers-Cotterêt prescrit la tenue des registres de baptême le 10 août 153928. L’Ordonnance de Blois de 1579 ajouta la tenue des registres des mariages et celle des registres de décès. Elle renouvela aussi le dépôt des registres au greffe des juridictions pour éviter les abus. L’Ordonnance civile de 1667, transforma les registres paroissiaux en véritable état civil car désormais ils prouvaient la naissance, le mariage et le décès mais aussi l’état des personnes29. D’ailleurs les mentions que devaient porter les actes étaient précisément énumérées30. Leur rédaction doit être immédiate, sur un même registre selon l’ordre des jours et sans laisser aucun blanc31.
Dès lors de grandes précautions furent prises pour l’inscription des noms des pères et des mères. Les curés ne purent plus inscrire le nom des parents sur simple déclaration de la mère ou de la sage‑femme. Ils ne durent y inscrire le nom du père que dans deux cas, lorsqu’on lui présente une sentence du juge qui déclare le père et que cette présentation est faite par quelqu’un digne de foi ; ou bien lorsque le père est présent physiquement32.
Dans notre affaire, tout est réuni pour que le curé s’interroge sur le baptême de cette enfant : aucun parent et deux mendiants pour témoins. Il est donc normal que le curé ait averti le Président Ferrand pour vérifier la paternité d’autant que ce dernier lui avait écrit pour lui interdire de baptiser un enfant en son nom.
C’est un cas de désaveu de paternité.
Mais dans cette affaire, aucune partie n’emploie ces termes.
Normalement, est légitime, l’enfant qui naît de parents unis par les liens du mariage. Le mari est présumé être le père de l’enfant. C’est l’héritage d’une loi romaine « pater is est quem nuptiae demonstrant33 » reprise par le droit canonique puis par le droit français34. Le père fait normalement baptiser l’enfant sous son nom. Pour l’enfant c’est un droit de porter le nom de son père. Cela n’est plus possible en cas de désaveu de paternité : l’enfant ne plus porter le nom de son père et d’ailleurs le père demande à ce que l’enfant ne soit pas baptisé sous son nom, soit en refusant de signer l’acte de baptême, soit en interdisant au curé d’accepter de baptiser un enfant sous son nom35.
Il est également normal que le curé n’ait pas inscrit le nom de la mère. En effet, lorsque le père était inconnu, jusqu’au début du xviiie siècle, le nom de la mère était inscrit, lorsqu’elle le voulait car l’honneur des familles était menacé. Puis, il devint traditionnel que les curés n’inscrivent pas le nom de la mère à moins que cela soit la maïeuticienne ou quelqu’un d’une réelle probité qui déclare et qui signe.
La réaction du curé fut donc conforme à la loi. La situation de cette enfant était compliquée dès ses premières heures puisque désavouée par le mari de sa mère.
Il est intéressant qu’aucune des parties n’ose clairement énoncer le désaveu de paternité. Cela se comprend pour mademoiselle Ferrand qui perd son procès si elle soulève qu’elle est, ou que son père l’a crue adultérine. Mais, c’est bien plus étonnant pour madame Ferrand qui aurait alors mis fin aux prétentions de la partie adverse. Les mémoires et le plaidoyer en faveur de celle-ci, essaient de camoufler la séparation d’habitation et le désaveu de paternité, ce qui est normal d’une part, pour gagner le procès et d’autre part pour sauver l’honneur.
Les mémoires de maître Cochin pour mademoiselle Ferrand n’insistent pas non plus sur ces deux faits car alors cela ruinerait les prétentions de celle-ci puisqu’étant adultérine, elle ne pourrait pas porter le nom Ferrand et ne pourrait prétendre à aucun héritage.
Mademoiselle Ferrand fut donc élevée comme une bâtarde par sa grand‑mère. L’enfant naturel n’a droit qu’à des aliments. Lorsque le père prend l’enfant avec lui, il peut porter son nom, il en est de même lorsqu’il participe à son entretien et surveille son éducation. En revanche, c’est beaucoup plus rare lorsque l’enfant reste avec la mère et a fortiori avec sa grand-mère. Mademoiselle Ferrand, encore petite fille, fut inscrite dans un couvent sous ce patronyme avant d’en changer. Elle ne jamais porta le nom Bellizany ce qui aurait dû se produire si elle était la fille naturelle du frère de madame Ferrand, mort à l’époque du procès. Il est évident que cette théorie était une défense imaginée par madame Ferrand.
Pourquoi les juges reconnurent-ils finalement la filiation de mademoiselle Ferrand en 1738 ? Ils durent faire prévaloir l’acte baptistaire avec les commentaires du curé sur le désaveu de paternité qui tomba devant l’acte notarié, fait par le Président Ferrand, qui accordait une pension à l’enfant né ce jour-là, sans toutefois le reconnaître, une copie de l’acte baptistaire était jointe à l’acte.
Madame Ferrand mourut peu de temps après 1738 et dans son testament, elle déshérita mademoiselle Michelle Ferrand, ce qui donna lieu à une autre procédure judiciaire.
Conclusion
Cette affaire délicate fit grand bruit à son époque. Les mémoires judiciaires et autres documents nous ont ouvert une fenêtre dans l’intimité de cette famille et ils nous ont permis de comprendre l’argumentation juridique de chaque partie.
Ces mémoires judicaires sont aussi des textes travaillés conservés soit pour la qualité de leur l’argumentation juridique, soit pour constituer les archives privées d’une famille.
Ces documents font partie de la seconde catégorie. Cette affaire a atteint les familles Bellinzany, Ferrand, Canillac et jeté l’opprobre sur leur nom.
Ces mémoires furent conservés avec d’autres documents qui n’ont rien de juridique comme les « Réflexions » de Madame Ferrand, rédigées avant le 27 août 1736, mais la version qui nous est parvenue a été imprimée après puisqu’elle est suivie de l’arrêt du 27 août 1736 qui renvoie les parties à apporter plus de preuves.
Ils furent imprimés à partir de textes manuscrits et on apporta du soin à leur rédaction et à leur impression, comme le prouve la rature manuscrite, à la dernière page, qui rectifie un mot mal employé dans l’« Addition au mémoire de mademoiselle de Vigny ».
Le soin pris pour l’impression de ces mémoires se retrouve également dans leur présentation et plus particulièrement dans leur enluminure.
Le plus souvent, les enluminures des mémoires judiciaires sont assez simples : rectangulaires avec des motifs végétaux ou géométriques toujours empruntes d’une grande symétrie. Or, tel n’est pas le cas de certains de nos documents. En effet, le mémoire du 1738, rédigé par maître Cochin, avocat de mademoiselle de Vigny, imprimé à l’imprimerie de la veuve d’André Knappen, au bas du pont saint Michel, en 1738, mais aussi le mémoire signifié de 1737, de la comtesse de Canillac36, issu de l’imprimerie Paulus du Mesnil, rue sainte Croix en la Cité, et enfin, le plaidoyer de 1736, prononcé par maître Gueaux de Reverseaux, avocat de la Présidente Ferrand, et imprimé aussi par l’imprimerie de la Veuve Knappen, ont la même enluminure.
Cette enluminure est remarquable37. Elle est imposante et importante par sa taille. Elle est figurative : un ensemble de coupe des fruits et de divers végétaux dont des feuilles d’acanthe. Elle est parfaitement symétrique dans toute sa composition.
En outre, ces deux textes ont été imprimés dans deux imprimeries différentes (celles de la Veuve d’André Knappen et celle de Paulus du Mesnil). L’impression des mémoires judiciaires était un commerce fréquent de ces ateliers puisqu’on les retrouve souvent citées dans les colophons des mémoires. Il est évident que cette impression ne répond pas à une mode mais qu’elle a été demandée. On peut supposer que c’est par le clan Ferrand puisqu’on la retrouve sur le plaidoyer. Cela nous amène à penser que c’est également le clan Ferrand qui a fait imprimer le Mémoire pour la demoiselle Ferrand38 de 1738 pour garder une trace du déroulement de l’affaire et des arguments de la partie adverses qui ont finalement convaincus les juges39. Cette impression n’a pu avoir lieu qu’après l’arrêt du 24 mars 1738, et par conséquent après le procès, qui légitime la filiation de mademoiselle de Vigny qui devint Michelle Ferrand, fille légitime de feu Monsieur Le Président Ferrand.