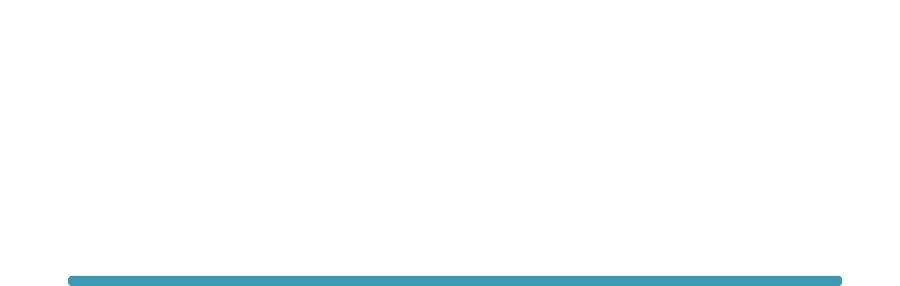I Le mythe du juge administratif serviteur de la loi
Le mythe peut correspondre à une représentation de fait réelle ou admise déformée ou amplifiée par l’imaginaire collectif : ici, le mythe de la loi souveraine, né d’une déformation de la philosophie rousseauiste. Les révolutionnaires ont emprunté au philosophe une partie seulement de sa théorie utopique, à savoir l’idée de loi, expression de la volonté générale, sans la lier avec la démocratie directe si chère au philosophe. Or, selon Jean-Jacques Rousseau, la loi ne serait l’expression de la volonté générale que lorsqu’elle n’est pas instrumentalisée par des intermédiaires élus ou désignés censés représenter le peuple1. Le travestissement de cette théorie a été regardé comme ayant pour unique but de fournir aux révolutionnaires une légitimité du régime institué2.
L’idée de la subordination du juge au législateur sera mise en évidence de façon insistante et répétée au cours du xviiie siècle. C’est au nom d’une séparation rigide des pouvoirs et d’une méfiance accrue à l’encontre des juges que ce dogme sera théorisé. Les Assemblées révolutionnaires interdisent alors directement aux juges toute immixtion dans l’élaboration ou l’application de la loi3.
Sur le fondement des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, deux axiomes ont pu être formulés : celui de la souveraineté de la loi, et celui de la subordination du juge au législateur4. Le premier avait eu pour répercussion directe l’article 5 du Code civil prohibant aux juges de se « prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises », le second d’édifier un encadrement des pouvoirs des juges, alors considérés comme seule « bouche qui prononce les paroles de la loi, êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la vigueur »5. On sait à quel degré de sacralité le philosophe Jean-Jacques Rousseau a élevé ces principes. On se souvient de l’une de ses célèbres formules : « la volonté générale ne peut errer »6, formule suivant laquelle la loi ne pouvait subir ni contrainte ni contrôle de la part des juges. Pourtant, la vérité de ceux-ci semble aujourd’hui moins évidente, ce diktat du légicentrisme a été atténué par une nouvelle interprétation plus souple de la séparation des pouvoirs favorisant l’idée de collaboration entre les pouvoirs.
Toutefois, l’affaiblissement du dogme notamment par la Constitution du 4 octobre 1958 encadrant les pouvoirs du législateur n’a pas fait disparaître les hésitations des juges face au mythe de la loi, « expression de la volonté générale »7. De plus, en vertu de l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel détiendrait une compétence exclusive pour exercer ce contrôle de constitutionnalité des lois8. Ainsi, l’extension des procédures de contrôle du juge administratif n’a pas dépassé une certaine limite comme en témoigne la théorie de la loi-écran. Celle-ci est une création à la fois jurisprudentielle et doctrinale. À partir de fondements jurisprudentiels, la doctrine va théoriser, va former cette théorie portée telle une idéologie. L’existence d’un écran législatif encadrant le contrôle du juge administratif a été abordée dans les conclusions du commissaire du gouvernement Agid en 1950 : ce « bienheureux écran permet[trait] au juge d’éluder un problème difficile ». Le refus d’admettre le contrôle de constitutionnalité d’une loi s’exprimera en des termes incisifs par le Conseil d’État dans deux arrêts de principe de 1936, « Dame Coudert » et « Arrighi »9. Il est énoncé que, « en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État ». Si la jurisprudence administrative accepte d’apprécier la constitutionnalité d’un acte administratif, elle refuse de procéder à cet examen lorsque l’acte a été édicté en application d’une loi, estimant que ce contrôle l’amènerait inéluctablement à apprécier la constitutionnalité de la loi elle-même. Roger Latournerie, alors commissaire du gouvernement, indiquait que, « dans la théorie et aussi dans la pratique de notre droit public, le Parlement reste l’expression de la volonté générale et ne relève à ce titre que de lui-même et de cette même volonté »10. Il en résulte que l’irrégularité éventuelle touchant les actes du souverain ne peut qu’être exclue devant le juge administratif.
Cependant, la souveraineté du Parlement n’est plus aussi évidente, tant à l’égard du droit interne que du droit international. Nous concentrerons notre propos sur les aménagements apportés à cette théorie dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois. La technique du contrôle de constitutionnalité va permettre au juge administratif d’organiser la soumission de l’Administration au principe de juridicité. Il est envisagé comme un moyen de « concilier les exigences juridictionnelles de l’État de droit avec la tradition française prohibant le contrôle des normes de valeur législative avec les règles constitutionnelles »11.
Deux étapes peuvent être identifiées dans le dépassement du mythe de l’infaillibilité de la loi et de la théorie de la loi-écran en découlant, pour satisfaire aux exigences de l’État de droit. Le juge administratif a, dans un premier temps, entrepris de neutraliser la loi pour éviter tout blocage dans son contrôle de la constitutionnalité d’un acte administratif pris sur son fondement. Dans un second temps, le juge va repenser son contrôle pour devenir le premier rempart du contrôle de constitutionnalité d’une loi dans le cadre d’une QPC.
Premièrement, par plusieurs mécanismes, le juge administratif a pu dépasser cette censure et éviter tout blocage dans son contrôle de la constitutionnalité d’un acte administratif pris sur le fondement d’une loi. La construction une nouvelle fois jurisprudentielle et doctrinale de l’écran transparent va permettre de désamorcer l’écran législatif. Tel que le précise Ronny Abraham dans ses conclusions sous l’arrêt Quintin, cette notion « s’applique à une loi qui, tout en renvoyant à l’autorité réglementaire le soin de définir certaines règles, ne contient en elle-même aucune règle de fond »12. De plus, le juge administratif va accepter de remettre en cause une loi promulguée qui méconnaîtrait une disposition constitutionnelle en raison de sa caducité, ou de son abrogation implicite13. Il élimine alors par la même occasion l’écran qu’elle réalisait avec une disposition administrative. Mais cette technique va plus loin, car elle permet de contourner l’interdiction de contrôler la constitutionnalité de la loi tout en prenant en considération les nécessités de l’État de droit, en permettant de neutraliser une loi en contradiction directe avec la Constitution. Cette théorie découlerait du principe selon lequel la loi ancienne dont le texte est inconciliable avec celui de la Constitution doit être considérée comme ayant été abrogée par l’entrée en vigueur de cette Constitution. Le raisonnement a d’ailleurs été théorisé dans l’avis du 4 nivôse an VIII rendu par le jeune Conseil d’État : « c’est un principe éternel qu’une loi nouvelle fait cesser toute loi précédente ou toute disposition de la loi précédente contraire à son texte ; principe applicable, à plus forte raison, à la Constitution, qui est la loi fondamentale de l’État »14.
Deuxièmement, il faut s’intéresser au contrôle de constitutionnalité des lois que le juge administratif va réaliser lorsqu’il sera saisi d’une QPC. On le sait, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution l’article 61-115 permettant à tout justiciable d’invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi par voie d’exception16 à l’occasion d’un litige soulevé devant le juge ordinaire. La loi organique du 10 décembre 2010 distingue l’office des juges de premier ressort et celui des juges suprêmes17. Nous concentrerons nos recherches sur l’examen du caractère sérieux. La juridiction de première instance ou d’appel devra examiner si la question n’est pas « dépourvue du caractère sérieux ». Ce critère, devant ce juge, n’a pour fonction que d’écarter les « questions fantaisistes, dilatoires ou dépourvues de consistance »18. Le Conseil d’État devra seul déterminer si la question est nouvelle ou présente une difficulté sérieuse. Il s’agit du motif principal de non-renvoi devant le Conseil constitutionnel (à hauteur de 75 %). Le contrôle qu’exerce le Conseil d’État a été qualifié de filtre ; en effet, si les conditions sont réunies, il transmettra la question au Conseil constitutionnel. Mais en étudiant le caractère sérieux et nouveau de la QPC, le CE va se livrer à un premier contrôle de la constitutionnalité des dispositions législatives à deux niveaux.
Le premier niveau est envisagé lorsque le juge administratif suprême refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Il fait alors part d’un premier examen, et avalise la constitutionnalité des dispositions législatives. Ainsi, tel qu’a pu le formuler le professeur André Roux19, si le Conseil d’État ou la Cour de cassation s’abstiennent de saisir le Conseil constitutionnel, ils sont conduits à reconnaître implicitement la constitutionnalité de la disposition législative contestée. Le second niveau peut être analysé lorsque le Conseil d’État transmet la QPC au Conseil constitutionnel : là encore, le Conseil d’État préjuge de la décision en ce qu’il reconnaît, par le biais du sérieux de la question, la pertinence de l’inconstitutionnalité invoquée. Il exerce ainsi un « pré-contrôle » de l’inconstitutionnalité des dispositions législatives qu’il transmet au Conseil constitutionnel20.
L’office du juge administratif suprême pourrait alors être assimilé à celui du juge l’urgence, du juge de l’évidence.
Par ce nouveau rôle, le juge administratif, juge de la pertinence de l’inconstitutionnalité d’une loi, dépasse le mythe de la souveraineté de la loi, qui l’empêchait de s’imposer comme le garant de l’État de droit. Le justiciable pourra ainsi facilement contourner la théorie de la loi-écran en invoquant par le biais d’une QPC l’inconstitutionnalité d’une loi dont découle l’acte administratif contesté.
II. Le mythe du juge gardien des libertés fondamentales ?
Le juge administratif n’a que tardivement été considéré comme un juge gardien des libertés fondamentales. Pour qu’il soit érigé en protecteur de ces libertés, il a donc fallu qu’il convainque qu’il persuade et désarme les méfiances qui pesaient originellement sur lui. La fin du XXe et le début du XXIe siècle seront alors déterminants tant pour solidifier son assise, renforcer son office que pour forger le mythe d’un juge garant des droits fondamentaux.
Ainsi, ni les origines de sa création, ni ses missions principales ne pouvaient laisser présager qu’il en serait ainsi. Longtemps, l’image du juge administratif a été dégradée par les critiques relatives à son indépendance, à son impartialité. Pour gagner la confiance des justiciables et correspondre aux exigences fixées par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des DH et LF, la juridiction administrative a tout d’abord été contrainte d’assainir les bases de son fonctionnement. Son indépendance a été confirmée par le Conseil constitutionnel, son inamovibilité, consacrée par le législateur21, et ses procédures internes se sont trouvées réglementairement encadrées22. C’est aussi le cas de la dualité des fonctions administratives et contentieuses des conseillers d’État23, également de la présence du rapporteur public lors du délibéré avec une solution différente pour les juridictions de premier ressort et le Conseil d’État24.
De plus, durant cette même période, son office a été renforcé par le législateur et élargi par la jurisprudence. En effet, le législateur s’est attaché à réduire la distorsion existante entre les pouvoirs reconnus au juge judiciaire et au juge administratif. Il a pour cela doté le juge administratif du pouvoir d’adresser des injonctions25 et des astreintes26 à l’Administration récalcitrante. Le déficit criant de procédure d’urgence efficace a également été corrigé avec l’instauration de la loi du 30 juin 200027. Parallèlement, le juge administratif a lui-même étendu son champ d’action en adoptant une conception étroite des actes de gouvernement et en participant au recul des mesures d’ordre intérieur28.
Toutefois, son contrôle dans le cadre de l’état d’urgence tend très largement à démythifier cette représentation du juge administratif, gardien des libertés fondamentales.
Rappelons que l’état d’urgence a été décrété en conseil des ministres par le gouvernement le 14 novembre 201529. Appliqué initialement au département d’Île-de-France30, son périmètre a progressivement été étendu à l’ensemble du territoire métropolitain31, puis sur le territoire des collectivités d’outre-mer32. Suite à cela, la loi du 20 novembre 201533 a permis de proroger l’état d’urgence et d’étoffer les mesures prévues par la loi du 3 avril 195534. Les pouvoirs du ministre de l’Intérieur, tant en ce qui concerne les mesures d’assignation à résidence (article 6) que les mesures de perquisition administrative (article 11), se trouvent fortement renforcées. L’état d’urgence vient à nouveau d’être prorogé pour une durée de trois mois par une loi du 19 février 2016 contenant un article unique35.
Cette partie induit alors une étude du rôle surestimé du juge administratif quant à la garantie des droits et des libertés fondamentales des justiciables suite à la loi du 20 novembre 2015. Ceci d’autant que, à l’exception de la commission des infractions reconnues à l’article 13 de la loi, le législateur l’a doté d’un contrôle exclusif des mesures de police prises par le ministre de l’Intérieur ou les préfets. Il est alors important de s’attarder sur ce renvoi explicite, quasi exclusif au juge administratif et plus particulièrement au juge des référés.
En gage de rapidité, l’autorité judiciaire y apparaît totalement muselée. Les magistrats de l’autorité judiciaire ont dénoncé publiquement cette méfiance à leur égard et fait part de leurs inquiétudes les plus vives concernant les mesures législatives encadrant l’état d’urgence36. Il nous semble important de vous livrer l’amorce de leur déclaration :
« Dans un pays tragiquement endeuillé et attaqué dans ses fondements démocratiques les plus précieux, l’autorité judiciaire doit, plus que jamais, assumer le rôle et la place qui lui sont reconnus par la Constitution » dans la défense des libertés individuelles.
En effet, dans la loi du 20 novembre 2015, l’autorité judiciaire n’intervient plus préventivement aux perquisitions administratives. Philippe Bas, rapporteur du projet de loi devant le Sénat, a alors qualifié le régime des perquisitions administratives de mesure « problématique au regard du cadre constitutionnel »37. Historiquement, lors de la prorogation de l’état d’urgence en novembre 2005, cette même mesure avait fait l’objet d’un débat en séance publique. Les parlementaires avaient alors révélé la nécessité que ces mesures de police ne soient pas soustraites à l’autorité judiciaire. Pascal Clément, alors garde des Sceaux, affirmait solennellement que les préfets ne pourraient décider une perquisition en application de l’état d’urgence « qu’après accord – et non avis – du procureur de la République »38. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a rapproché à plusieurs reprises la possibilité de diriger des perquisitions de jour ou de nuit du contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle39. Pourtant, dix ans plus tard, malgré la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les parlementaires ont substitué à une autorisation préventive de l’autorité judiciaire un contrôle postérieur du juge administratif. Saisi de cette procédure par question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a censuré une partie des dispositions du 3e alinéa de l’article 11 comme contraire à la Constitution40. En dehors de ces dispositions, le CC a validé les restrictions apportées à la compétence de l’autorité judiciaire.
Saisi du contrôle exclusif des mesures de police prises dans le cadre de l’état d’urgence, il faut déterminer si le juge administratif est à la hauteur de la mission qui lui a été confiée, et s’il a les moyens de la mener à bien. À ces deux questions, il semble qu’il faille répondre par la négative.
A priori, le juge administratif a tâché de renforcer son contrôle pour assurer l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et la préservation des libertés fondamentales dès qu’il en a eu l’opportunité. Dans plusieurs ordonnances rendues le 11 décembre 201541, le Conseil d’État a, premièrement, considéré que, dans le cadre de la contestation d’une assignation à résidence, la condition d’urgence inhérente au référé-liberté était présumée, et, deuxièmement, exercé un contrôle entier sur les motifs et les modalités de mise en œuvre de l’assignation à résidence. Xavier Domino, alors rapporteur public, appelait les membres de la section à effectuer une telle revalorisation du contrôle en s’exprimant ainsi :
Il nous semble important que votre décision envoie le signal clair, tant à l’égard de l’administration, des citoyens que des juges, que le contrôle exercé par le juge administratif sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence n’aura rien d’un contrôle au rabais, et que l’État de droit ne cède pas face à l’état d’urgence.
La valeur symbolique de cette annonce de revalorisation ne doit pas être négligée, car à cette même date la section de l’Intérieur du Conseil d’État rendait un avis validant le projet de loi constitutionnelle inscrivant dans le marbre constitutionnel les conditions de déclaration et de prorogation de l’état d’urgence42. La compétence du juge administratif en la matière aurait de ce fait un fondement constitutionnel. Le juge administratif avait ainsi intérêt à se présenter comme l’arbitre légitime de l’état d’urgence.
Plusieurs suspicions pèsent cependant sur le contrôle qu’il exerce et nous conduisent à cette considération du mythe de la garantie des libertés et DF.
Premièrement, à la lecture des décisions rendues, il est possible de le suspecter d’exercer un contrôle frileux, imprégné du climat d’angoisse et de suspicion instauré par l’état d’urgence. Il convient d’indiquer que seules peu d’ordonnances rendues en référé ont suspendu la mesure de police : environ 16 % seulement selon les chiffres communiqués par le Conseil d’État au 25 février 201643. En matière d’assignation à résidence, le juge administratif des référés réalise une appréciation de la mesure prise par l’autorité administrative « compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence »44. Le juge des référés a également pu ajouter dans certaines ordonnances « qu’il lui appartient de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l’état d’urgence, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu’il importe de prévenir »45. Il semblerait ainsi que le contrôle de proportionnalité réalisé par le juge administratif s’adapte à l’état d’urgence, faisant preuve d’une plus grande souplesse dans l’appréciation des excès de l’autorité administrative.
De plus, sa faible marge de manœuvre a été dénoncée par certains juges administratifs dans un témoignage anonyme publié sur le site Mediapart. Ces derniers affirment : « lorsque la loi, comme c’est le cas de celle portant application de l’état d’urgence, instaure un état d’exception […], le pouvoir du juge est limité : il doit seulement vérifier si les mesures exceptionnelles autorisées par l’état d’urgence pouvaient être prises à l’encontre des personnes concernées ». La garantie des droits fondamentaux ne serait assumée par le juge administratif que pour autant que la loi l’y autorise.
Deuxièmement, il est possible de critiquer la validation par le juge administratif de l’extension des mesures d’assignation à résidence à l’encontre de certains militants écologistes. On peut s’interroger sur l’effet d’aubaine pour l’exécutif de pouvoir user de l’arsenal sécuritaire pour des motifs étrangers à ceux ayant légitimé l’état d’urgence. Dans son rapport de 2015, Amnesty International a pointé du doigt cette pratique visant à user de l’état d’urgence à des fins autres que celles l’ayant initié46. La Commission nationale consultative des droits de l’homme parle d’un « détournement de l’état d’urgence » dans son avis du 18 février 201647. Pourtant, le Conseil d’État, dans ses décisions du 11 décembre 2015, a validé cette extension en se référant au texte de la loi et à la différence que cette dernière établit entre les motifs justifiant la déclaration de l’état d’urgence et les motifs permettant une assignation à résidence prévue à l’article 6. Pourtant, si l’on s’intéresse aux travaux parlementaires, ni l’étude d’impact, ni l’exposé des motifs de la loi n’étendent le champ de l’assignation à résidence à d’autres personnes que celles suspectées d’appartenance à la mouvance terroriste. De plus, le professeur Agnès Roblot-Troizier a soulevé une incohérence dans le dispositif de ces ordonnances48. Le CE était saisi à la fois d’un appel et de plusieurs pourvois dans le cadre de la procédure du référé-liberté. L’un des militants écologistes avait également demandé au Conseil d’État de transmettre au CC une QPC portant sur la conformité des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 aux droits et libertés garantis par la Constitution. Alors que la juridiction administrative suprême considère que les assignations à résidence ne portent pas une « atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté d’aller et venir des administrés, et que les affaires ne nécessitent pas l’adoption de mesures de sauvegarde, il décide de saisir le CC de l’article 6 de la loi en raison du caractère sérieux du moyen d’inconstitutionnalité. Pour le formuler autrement, alors que le précontrôle de constitutionnalité que le CC exerce sur la conformité de l’article 6 de la loi à la liberté constitutionnelle d’aller et venir, le pousse à reconnaître la pertinence de l’inconstitutionnalité, il ne retient pas l’assignation à résidence découlant de l’article 6 de la loi comme portant une « atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté d’aller et venir en tant que liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du CJA.
Troisièmement, il faut se questionner sur la prise en compte des notes blanches fournies par l’Administration. En effet, le juge administratif accepte de les prendre en considération et donc de les verser au débat contradictoire dès lors « qu’aucune disposition législative ni aucun principe ne s’y oppose »49. Il a toutefois été suspecté de reprendre purement et simplement les moyens développés par les services de renseignement de l’Administration, sans examen critique. La charge de la preuve serait ainsi inversée et l’administré, faisant l’objet d’une mesure privative de liberté, contraint d’apporter la preuve de la fausseté de ces notes. Le syndicat des avocats de France, dans l’analyse du contrôle réalisé sous l’état d’urgence, condamne l’admission par le juge administratif de « ces preuves préconstituées et invérifiables produites par les services de renseignements ». La preuve de l’absurdité de ces notes constituerait une démonstration impossible selon laquelle « l’inexistant n’existe pas »50. Le plus souvent, il s’agit du seul élément étayant la mesure de police.
Cependant, dans certaines espèces, le juge se veut rassurant dans la mesure où il ne prendra en compte ses notes que lorsqu’elles seront « suffisamment précises et circonstanciées »51, et s’attache « à ce que seuls les éléments de faits contenus dans la note soient regardés comme probants, à l’exclusion de toute interprétation ou extrapolation »52. Nous avons également trouvé une ordonnance en date du 6 janvier 2016 dans laquelle le juge administratif refuse de se fonder sur ces notes en raison de leur imprécision53.
L’importance du rôle du juge administratif ne doit pas être négligée, ainsi que l’a souhaité le législateur et avalisé le Conseil constitutionnel : il sera l’arbitre exclusif entre les volontés sécuritaires des pouvoirs publics et la préservation des droits fondamentaux des justiciables.
Un arbitre qui, bien qu’usant des instruments qui lui ont valu la qualification de gardien des libertés fondamentales, reste contraint par les dispositions de la loi du 20 novembre 2015. Un juge dont le contrôle frileux semble empreint du climat d’inquiétude suscité par l’état d’urgence, un équilibriste dans l’embarras de la définition de l’équilibre, entre sécurité et liberté. Un administrateur qui n’oserait « pas prendre la responsabilité de remettre en cause l’efficacité de la politique menée par les pouvoirs publics pour protéger la population des menaces terroristes »54.