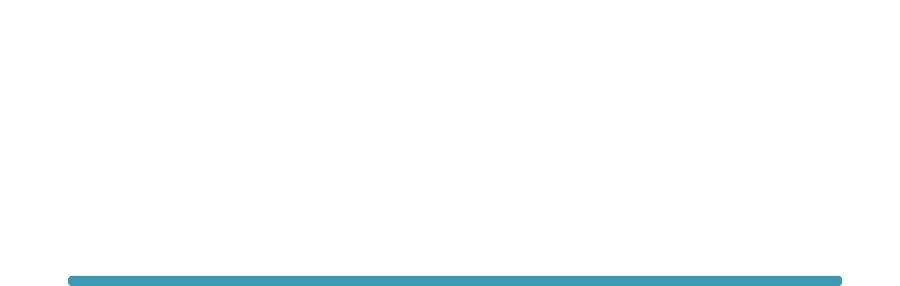Un rocher qu’on est condamné à hisser au sommet d’une montagne. Une sournoise apesanteur qui ruine tous efforts, et oblige à recommencer l’ouvrage sans jamais parvenir au but. Entreprise absurde confiée à Sisyphe, héros de la mythologie grecque.
Sisyphe, exhumé par Albert Camus, au cœur du XXe siècle, Camus analysant la vie comme un éternel recommencement confinant à l’absurde. L’issue ? La révolte, unique moyen de vivre sa vie dans un monde absurde. La révolte en soi, pour soi, plus importante que les causes la justifiant.
Sisyphe est l’homme absurde ; nous devons tous être des hommes absurdes, habitant un monde dans lequel nous devons accepter que « tout l’être s’emploie à ne rien achever ».
La fin justifie les moyens, sans doute, mais qui justifie la fin ? Et Camus d’asséner : « à cette question que la pensée historique laisse pendante, la révolte répond : les moyens ».
L’État de droit est-il une fin ou un moyen ?
On pourrait le discuter. Y voir un moyen, tout d’abord, au service d’une fin que l’esprit, dépouillé de la logique camusienne, irait sans doute rechercher dans l’au-delà du droit, dans une dimension métajuridique. La légalité au service de la légitimité.
Mais l’orientation donnée à cette intervention, par la sagacité des organisateurs de cette magnifique journée, commande de voir dans l’État de droit la fin, celle vers laquelle on tend, en confiant au Droit objectif le soin d’en prévoir et organiser les moyens.
C’est conter ce supplice de Sisyphe auquel nous sommes conviés, narrer cette situation absurde et répétitive d’une quête à jamais aboutie.
L’instauration de l’État de droit constituerait cette fin inaccessible ?
C’est dans la production kelsenienne que l’on s’accorde, aujourd’hui, à trouver la conception la plus pure de l’État de droit, défini comme un « système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit », précisément comme un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée. L’État de droit est le rempart contre l’arbitraire du pouvoir.
La hiérarchie des normes est l’alpha, mais sans doute pas l’Omega de l’État de droit, car la lutte contre l’arbitraire suppose aussi et impose en outre, l’égalité des sujets de droit devant les normes juridiques, implique l’existence de juridictions indépendantes des pouvoirs exécutif et législatif, commande l’affirmation et le respect de droits fondamentaux profitant aux sujets de droit.
Hiérarchie des normes, égalité des sujets de droit, séparation des pouvoirs, droits fondamentaux ? Combien cette litanie est familière à nos oreilles de juriste. Au point que, dans une première approche rapide du sujet, l’on pourrait penser que la référence au mythe de Sisyphe est parfaitement inadaptée. Le rocher a roulé jusqu’au sommet, l’homme est dépouillé de l’absurdité de sa vie, la révolte n’a plus lieu d’être, Camus est enterré, la fin est atteinte : l’État de droit est.
Pourtant, pour qui suit Camus, l’État de droit ne peut pas être. Son instauration demeurera toujours, par essence, une quête inaboutie (I).
Ce constat, implacable constat, suscite-t-il déception, tristesse, colère ou bien Sisyphe était-il, doit-il être heureux (II) ?
I. Un constat : une quête inaboutie
L’instauration de l’État de droit, nul n’en disconviendra sans doute, est une quête (A) ; mais cette quête n’a jamais abouti et n’aboutira jamais (B).
A. Une quête
La quête de l’État de droit est visible et sensible. Le droit objectif y œuvre, toujours plus fermement, jouant pour ce faire sur les normes, les institutions, les sujets de droit.
1. Les normes, tout d’abord
L’affirmation d’une hiérarchie des normes est un moyen de canalisation de la puissance de l’État. Dans ce modèle, chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures.
L’allégeance au principe de hiérarchie des normes semble parfaite. Affirmée, ingérée, digérée, la hiérarchie des normes est aujourd’hui érigée en principe, sur lequel nos plus hautes juridictions n’hésitent plus à s’appuyer expressément pour assurer la primauté et l’efficience d’une norme hiérarchiquement supérieure.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation s’y est encore tout récemment référée, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2015 (n° 14-14.256) pour imposer au service fiscal le jeu de la Convention franco‑monégasque signée le 1er avril 1950, au profit du contribuable.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile, le 28 janvier 2015 (n° 13-50.059), la Cour de cassation est même allée jusqu’à évoquer « le principe habituel de la hiérarchie des normes ». Voici un principe bien campé dans les habitudes du juge comme dans celles de tous juristes. Et n’omettons pas le fort propos de Radiguet, selon lequel « c’est dans l’habitude, non dans la nouveauté, que l’on trouve les plus grands plaisirs ».
Ite missa est… Le principe de hiérarchie des normes, armature fondamentale de l’État de droit, est bien en place, à sa place au cœur du système juridique.
2. Les Institutions
C’est encore en façonnant les Institutions que l’on parvient à l’affermissement de l’État de droit en assurant la séparation des pouvoirs qu’elle véhicule.
L’exigence de séparation des pouvoirs nichait déjà dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, cette dernière martelant, en son article 16, que « Toute société dans laquelle la Garantie des Droits n’est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée n’a point de Constitution ».
On ne doute plus de l’inscription de la séparation des pouvoirs tout en haut de la pyramide kelsenienne, au moins depuis que le Conseil Constitutionnel, réalisant sa mue au cœur de l’été 1971, a inscrit le préambule de la Constitution dans le bloc de constitutionnalité, préambule renvoyant, notamment, à la déclaration de 1789.
Et la séparation des pouvoirs demeure un aiguillon important pour le Conseil Constitutionnel. Saisi au titre de son contrôle a priori, de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution, relative à l’organisation de la Haute Cour, le Conseil, dans sa décision du 19 novembre 2014 a encore une fois sollicité l’article 16 de la déclaration de 1789 pour affirmer que « la séparation des pouvoirs commandait de ne pas apporter aux prérogatives du Président de la République d’autres atteintes que celles expressément prévues par l’article 68 ».
La séparation des pouvoirs postule, encore, la totale indépendance du pouvoir judiciaire, dégradé, il est vrai, en simple autorité, par la Constitution de 1958. Cette indépendance qui, selon le fort mot de Gérard Cornu et de Jean Foyer « fait la force principale de la justice », est servie par une kyrielle de dispositions de droit interne comme de sources internationales (et l’on songe, bien sûr, à l’article 6 CEDH).
La juridiction doit juger par elle-même et ne pas abandonner son pouvoir d’appréciation au profit d’une autre autorité. Le juge doit exercer sa mission en liberté. Cette liberté est affirmée et garantie dans sa double dimension : d’une part, parce qu’il est indépendant, le juge ne peut recevoir d’ordres de personne, ce qui tient à son statut et impose une indépendance objective à l’égard de l’État qui l’emploie, de ses collègues, des parties au litige comme des tiers qui interviennent au procès. D’autre part, c’est l’indépendance subjective du juge qui est garantie, qui veut qu’un juge ne puisse être véritablement indépendant que s’il apparaît comme tel aux yeux du justiciable. Nul n’a oublié ce dictum de Lord Hewart : « la justice ne doit pas seulement être rendue, mais il doit être manifestement et indubitablement visible qu’elle a été rendue ».
L’indépendance du juge, dans sa double dimension, est aujourd’hui garantie, protégée et sanctionnée.
3. Les sujets de droit, enfin. Leur sort contemporain révèle, là encore, l’affermissement sinon l’affirmation de l’État de droit
La proclamation de droits fondamentaux de la personne, la protection de ces droits par un imposant arsenal normatif, le signe.
L’État de droit suppose, tout d’abord, l’égalité de tous devant la norme. Comment ne pas voir dans la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, ouvrant, via la QPC, sur un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, à l’initiative de tous justiciables un grand progrès de l’État de droit ?
En outre, le Conseil a livré une lecture très large de ces pouvoirs. En considérant, dès le 14 octobre 2010, que l’interprétation faisait corps avec le texte interprété, il a admis qu’en posant une QPC, le justiciable avait le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective d’une norme qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.
Ne peut-on admettre qu’une telle doctrine sert la sécurité juridique et l’unité du droit ?
Au-delà du principe d’égalité, c’est encore au phénomène de fondamentalisation des droits subjectifs que l’on a pu assister, à l’ancrage et à la protection des droits fondamentaux de la personne, qui œuvrent à la préservation du corps et de l’esprit de celle-ci face à d’éventuels assauts de l’État ou d’autres sujets de droits.
En agissant sur les normes, les Institutions et les sujets de droit, la quête de l’État de droit semble avoir été fructueuse.
Et pourtant, cette quête est inaboutie.
B. Une quête inaboutie
La multiplication des moyens n’a pas permis d’aboutir à la fin.
Cela parce que l’État de droit est un idéal inaccessible (1).
On pourrait, au demeurant, s’interroger sur le point de savoir s’il n’est pas aujourd’hui un idéal dont on s’éloigne (2).
1. Un idéal inaccessible
Camus, décidément, avait raison. La fin et le sommet de la montagne ne pourront jamais être atteints.
La raison en est simple : l’État de droit imposerait, dans l’absolu, le respect de principes, d’exigences, par essence incompatibles.
Le propos doit être illustré.
L’État de droit appelle à la fois au respect du principe de hiérarchie des normes et à celui de la séparation des pouvoirs.
L’un et l’autre peuvent, parfois, être servis ensemble ; mais, en d’autres circonstances, l’un et l’autre s’opposent de manière irréductible.
C’est sûrement l’arrêt Jacques Vabre, rendu en chambre mixte par la Cour de cassation le 24 mai 1975 (n° 73-13.556), qui le révèle de la manière la plus éclatante.
Étaient en cause, dans un contentieux douanier, l’application de l’article 95 du Traité du 25 mars 1957 (traité instituant la CEE), et celle de l’article 265 du Code des douanes, édicté par une loi française postérieure au Traité, loi du 14 décembre 1966.
Quand il s’agit pour le juge de faire prévaloir le Traité sur une loi qui lui est antérieure, le juge sert le principe de la hiérarchie des normes sans atteindre la séparation des pouvoirs, puisque, finalement, il respecte aussi la dernière manifestation de volonté du législateur, qui a entériné le Traité.
En revanche, quand, comme dans l’arrêt Jacques Vabre, le juge, sous couvert du principe de hiérarchie des normes, écarte la dernière manifestation de volonté du législateur français, il foule du pied le principe de séparation des pouvoirs.
Le respect d’un principe commande la négation d’un autre.
Une même observation peut être faite au regard du pullulement des droits fondamentaux reconnus au sujet de droit. Michel Villey avait prévenu : la multiplication des droits de l’homme emporte la négation des droits de l’homme.
Qui nierait, aujourd’hui, la prescience de ce grand auteur ? On s’en convaincra à partir d’un exemple : celui du droit au respect de la vie privée opposé au droit à l’information, lui aussi qualifié de « droit fondamental de l’homme ». La première chambre civile fut bien obligée de reconnaître que l’un et l’autre droits revêtaient une identique valeur normative (Cass. 1re civ., 9 juillet 2003, n° 00-20.289).
Or, la protection de l’un des deux droits peut emporter la contrariété voire la négation de l’autre. La résolution du conflit passe, en théorie, par l’affirmation de la supériorité de l’un sur l’autre ou par une tentative de conciliation de l’un et de l’autre.
L’affirmation de la supériorité de l’un sur l’autre implique l’éviction d’un droit fondamental ; la conciliation appelle à un jugement en termes de proportionnalité, mais, dans l’absolu, implique une atteinte à l’un au moins des droits, droit qui sera écorné pour pouvoir coexister avec l’autre.
La conclusion s’impose : tous les droits fondamentaux en concurrence ne peuvent être pleinement et égalitairement protégés, concomitamment.
L’idéal d’un État de droit supposerait un parfait service de tous les droits fondamentaux, comme un parfait respect des principes de hiérarchie des normes et de séparation des pouvoirs.
Or, par la nature même des choses, ce parfait service et ce plein respect ne peuvent jamais être assurés.
L’État de droit demeure, et demeurera, un idéal vers lequel il faut toujours tendre, mais qu’on ne parviendra jamais à atteindre.
Je vois Camus sourire et se réjouir. Bienvenue en absurdie !
2. Un idéal dont on s’éloigne
Le constat ne pourrait-il être parfois fait que le droit positif s’éloignerait de l’idéal d’un État de droit ?
Le propos ne tournera pas, volontairement, autour des réactions épidermiques de l’exécutif comme du législateur au fléau terroriste. Encore que l’État d’urgence, les nouveaux développements procéduraux en matière pénale pourraient, sans doute, nourrir le débat d’une régression de l’État de droit, au moins dans l’acception que nous avons retenue.
Le propos ne se nourrira pas non plus de ces manifestations prégnantes et persistantes du fait du Prince en droit français, qui s’est encore vu dans la grâce accordée par le chef de l’État, investi d’un pouvoir quasi divin d’ignorer et de dépasser le verdict de deux jurys populaires.
Le raisonnement sera ici entrepris à partir d’exemples plus classiques, mieux ancrés dans le droit positif, mais qui pourraient eux aussi révéler ce glissement vers le bas de la montagne.
On ne peut ici passer sous silence le phénomène, en expansion, des autorités administratives indépendantes. Par leur nature, elles ne seraient pas des juridictions, encore que certaines (et l’on pense à l’ACPR) n’ont pas hésité à s’autoproclamer telles, notamment pour admettre le jeu de la QPC (décision de la commission des sanctions du 13 mai 2011). On admettra cependant, après Roland Drago, que ces autorités sont en voie de juridictionnalisation avancée.
Or, il est saisissant de voir combien, en elles, peut exister une totale concentration des pouvoirs que la Déclaration des droits de l’homme de 1789, après Montesquieu, voulait pourtant tant voir séparés ! Certaines autorités, songeons à l’AMF, concentrent dans leurs mains des pouvoirs exorbitants, législatif, exécutif et juridictionnel. Certains parlementaires s’en sont même émus (ce fut le cas de Messieurs Dosière et Vaneste) et de belles plumes (notamment celle de Monsieur Canac) sont allées jusqu’à crier au déni démocratique, posant, crûment, cette question : qui garde les gardiens ? Quid du contrôle démocratique des experts, et donc des autorités indépendantes ?
3. Recul de l’État de droit ?
Il est jusqu’au principe de hiérarchie des normes qui vacille. D’abord, parce que le contrôle du respect de cette hiérarchie est parfois très déficient. On doit bien admettre que les frontières des articles 34 et 37 de la Constitution ne sont plus gardées par un douanier attentif. Le Conseil constitutionnel, pourtant voulu garde-barrière par les Constituants de 1958, ne joue plus ce rôle-là, et le sentiment vient souvent que la répartition des matières entre la loi et le règlement s’opère au petit bonheur la chance, sans plus de sanction effective.
C’est encore le contrôle de constitutionnalité du règlement qui s’avère bien déficient, comme est fragile celui du respect de la constitution par les traités et accords internationaux.
Mais il faut, hélas, aller plus loin. C’est la hiérarchie même des normes qui est en débat. La définition des étages de la pyramide n’est pas partout la même. La Constitution française peut bien être vue comme la norme supérieure, depuis Paris ou Clermont, elle ne sera pas vue à cette place à Bruxelles ou à Luxembourg, siège de la CJUE. Il n’y aurait pas une, mais des hiérarchies, différentes selon celui qui la contemple. Il n’y a plus de hiérarchie.
L’analyse pourrait faire frémir. Non seulement l’État de droit est une quête inaccessible, mais en plus il se pourrait qu’on se détourne, peu ou prou, de la recherche de son établissement.
Le constat est là. Quel sentiment peut-il engendrer chez nous ?
II. Un sentiment : l’inaccessible État de droit, supplice ou libération ?
Quel sentiment engendre le constat que l’État de droit est un idéal inaccessible ?
Si l’on saisit Sisyphe dans la mythologie grecque, le sentiment sera celui de l’affliction.
Si l’on saisit Sisyphe, sous la plume de Camus, le sentiment sera celui du bonheur.
A. L’affliction
Sisyphe a été puni par les Dieux.
Pour le juriste, tel Sisyphe, le constat cru que l’État de droit, comme une fin, ne pourra jamais être atteint pourrait engendrer chez lui de l’affliction.
Qu’a-t-il fait aux Dieux pour être privé de cet aboutissement, lui qui livre le Combat pour le Droit, pour évoquer Ihering, ou encore qui témoigne de sa passion pour le droit, comme le fit Jean Carbonnier ?
Ce sentiment d’affliction pourrait être aggravé si, dépassant la stricte sphère du droit pour s’aventurer sur celle de la science politique, le juriste se convainquait que l’État de droit est le principe caractéristique du système démocratique.
Et voilà l’un et l’autre emportés par ce constat glaçant qu’ils sont des fins à jamais accessibles.
Ce qu’a vécu Sisyphe fut un supplice ; les juristes le partagent, et croulent sous le poids de ce rocher qui s’entête à dévaler la pente.
Sans doute, pourtant, devons-nous, nous, juristes, relire Camus. À l’affliction succéderait le bonheur.
B. Le bonheur
Sisyphe était-il heureux ? Il aurait dû l’être. Camus considérait qu’il fallait le considérer ainsi. Son bonheur, il le trouvait dans l’accomplissement de la tâche qu’il entreprenait, et non dans la signification de cette tâche.
« La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme ».
Le juriste qui combat pour l’État de droit, qui se révolte contre l’arbitraire, trouve dans ce combat en soi, dans cette révolte, son bonheur et son épanouissement.
Si la fin devait être atteinte, quel serait son moteur ? Sa passion ? Son engagement ? Ayons conscience de cette absurdité que nous nous battons pour une cause qui ne s’imposera jamais pleinement, et trouvons notre bonheur dans ce combat pour le droit, pour l’État de droit, qui est notre aiguillon, notre moteur. La fin atteinte, il n’y aurait plus de progrès du droit à escompter. Toute l’intelligence des juristes ne serait plus ordonnée à la quête du progrès. À quoi servirait-elle alors ?
Le mythe de Sisyphe donne tout son sens au travail et à l’investissement des juristes, qui doivent prendre conscience que ce sont les moyens qui justifient la fin et que ce sont leurs incessantes révoltes qui confèrent au droit grandeur, noblesse et progrès.
Merci Camus.