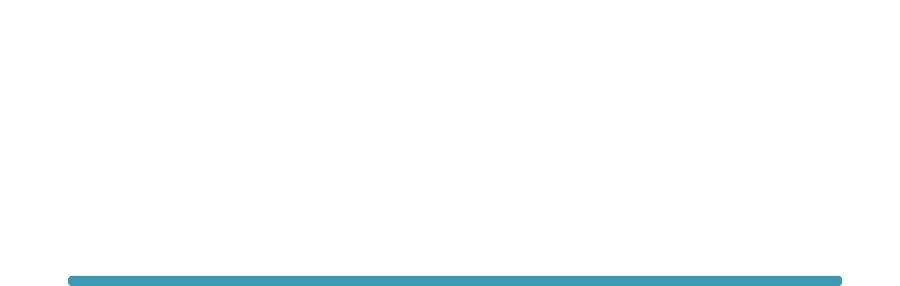I. Du débat juridique au débat public
La sanction des violences conjugales est‑elle à la hauteur ? À la hauteur de quoi ? De son histoire ? Du débat public actuel ? L’histoire de la sanction des violences conjugales existe‑t‑elle avant les années 1970‑1980 ? L’étude historique d’un tel sujet de société, très contemporain et mêlant ordre public et stricte intimité, n’est pas aisée. Le danger anachronique est double :
- Juger des comportements sociaux et juridiques du passé à la lumière des débats actuels ;
- Juger des comportements sociaux et juridiques du présent avec le corset d’arguments juridiques du passé.
Une historienne du droit, Victoria Vanneau, a dédié un ouvrage au sujet, auquel je renvoie malgré les réserves que j’émettrai sur quelques conclusions1. Sa thèse est la suivante : la justice a construit la répression des violences conjugales dès le xixe siècle. Le législateur et les juges ont dû bâtir cette catégorie juridique des violences conjugales qui ont donc été un fait de droit avant de devenir un fait de société2. Pour cela, il a fallu que les droits civil puis pénal, avec plus de difficulté, pénètrent la sphère intime et la jugent, au‑delà des manifestations extérieures de troubles à l’ordre public qui étaient jusque‑là l’unique voie juridictionnelle3.
Au cours des xviiie et xixe siècles, la domination politique et sociale masculine est indiscutable mais l’exercice de la violence maritale dans le couple apparaît comme un archaïsme indigne4. On pourrait égrener, depuis le Code d’Hammurabi, les textes qui autorisent et légitiment la violence des maris sur leurs femmes, ce droit de correction qui est en partie une reconstruction a posteriori permettant d’établir la modernité du droit par rapport à de prétendues mœurs féodales5. La violence dans le couple médiéval est pourtant assez bien documentée au travers des lettres de rémission qui, même si elles dressent de nombreux biais d’analyse, révèlent autant la variété des situations que la construction et la reproduction des stéréotypes sociaux par la langue juridique6. Avec la montée de l’individualisme, l’emprise directe de l’État sur les individus, le déclin des principes de statut personnel et d’honneur familial, la brèche s’ouvre pour qu’un tiers, un juge, vienne sanctionner des violences ou des meurtres commis par des conjoints, non parce que cela trouble l’ordre hiérarchique social mais parce que l’on va considérer les parties comme des individus à part entière qui commettent des violences dans ce cadre singulier du couple. Le couple et la vie de couple sont faits de raison et de contradictions que le droit s’est bien gardé de régler pendant la majorité de l’histoire de l’humanité. Encore au xixe siècle, le juge demeure attaché à l’unité du couple et à la possibilité de réconciliation7.
La perspective de créer des incriminations de genre, de réduire les violences conjugales aux violences sur les femmes, ne constitue pas une suite logique historique, toujours fantasmée. Les praticiens du droit ont œuvré à déconstruire les carcans familiaux qu’ils avaient eux‑mêmes contribué à bâtir. Pour Victoria Vanneau, « genrer » les violences conjugales reviendrait à reconstruire des statuts différenciés, à trahir la construction juridique et jurisprudentielle de la catégorie des violences conjugales et à laisser de côté les hommes victimes de violences conjugales8. C’est l’objet de sa conclusion qui dénonce la vision « où triomphent sans partage la “victimisation” du féminin et la “pénalisation” du masculin9 ». Certes, nier cette violence, ou la considérer moins répréhensible que la violence masculine, revient à perpétuer le stéréotype des femmes faibles, victimes, douces, serviables, sans autonomie d’action ni existence dans la sphère publique. Néanmoins, l’étude de cette violence, sous prétexte d’égalité, pourrait être interprétée comme un Cheval de Troie qui détournerait le regard du fait de société, l’arbre qui viendrait masquer la forêt de la violence masculine statistiquement majoritaire. On touche ici aux limites de l’histoire du droit au sens étroit, mais aussi de l’analyse statistique et sérielle10, qui a son intérêt pour certaines applications mais qui désépaissit et amenuise les « détails » qui sont autant de vies.
II. Six affaires, combien de conclusions ? L’écheveau judiciaire
Afin d’apporter un peu d’eau au moulin, sans tomber dans le piège des injonctions contradictoires actuelles, il convient de poursuivre l’œuvre de mise en épaisseur par la pratique judiciaire plutôt que par la dogmatique. J’ai donc étudié six affaires criminelles du Puy‑de‑Dôme au tournant des xixe‑xxe siècles qui, prises dans un dépouillement sériel que je n’ai pas eu le loisir de mener, ne seraient que des exemples ou des exceptions d’un mouvement général. Les six dossiers s’inscrivent dans le même contexte de la IIIe République, entre 1878 et 190811. Il s’agit d’un échantillon réduit aux homicides, donc à la cour d’assises, une source très spécifique, avec ses propres logiques de procédure et de rédaction. Il n’est pas représentatif des violences conjugales dans leur ensemble, si l’on songe au contentieux correctionnel, mais aussi à tout ce qui échappe aux yeux de la justice, voire de la police, même si les dossiers criminels révèlent des histoires de violence continue qui auraient pu être résolues avant l’issue meurtrière12. La question de l’unité du couple ne se pose plus, mais elle apparaît en fond dans le passé qui a construit ces homicides.
À la question de savoir si la sanction des violences conjugales était à la hauteur, dans ces cas d’homicide, la réponse est mitigée. Néanmoins, le sondage archivistique témoigne d’un traitement assez différencié des meurtres conjugaux commis par des hommes par rapport à ceux commis par des femmes, démontrant une tension entre la personnalisation de la peine et le maintien de stéréotypes sociaux et de genre bousculés par la poussée des revendications et acquis féministes au tournant du siècle13. La personnalité de l’accusé et son activité sociale pèsent, jusqu’à l’extrême, dans un verdict qui est parfois décorrélé des faits, même si les magistrats ont tendance à dégrader les assassinats en simples meurtres afin d’assurer la condamnation14.
Examinons d’abord les accusés masculins. Jean Courtadon est connu pour être dangereux et violent et a été condamné à deux reprises pour coups et blessures15. Le journal La Croix d’Auvergne du 1er mars 1908 le décrit à l’audience comme apparaissant « tel qu’il est, brutal et menteur16 ». François Bazin est, lui, décrit comme un ivrogne, craint par ses voisins, tandis que son épouse est dépeinte comme une femme laborieuse, douce, prévenante et fidèle17. Ces portraits caractérisent typiquement les attendus d’une « bonne » épouse et d’un « mauvais » époux, a fortiori dans un contexte d’accroissement de la pression étatique et morale sur l’alcoolisme18. La presse rapporte qu’à son procès, la « tâche de l’avocat général est bien facile, celle du défenseur bien ingrate19 ». Enfin, Antoine Grissolange est connu pour être violent et sa femme avait déposé plusieurs demandes de séparations de corps retirées « sur les instances du mari20 ». Les chroniques judiciaires rapportent un « réquisitoire d’une logique impeccable [qui] réclame contre l’accusé un verdict d’une extrême sévérité, un verdict sans pitié, qui aura l’approbation de tous les honnêtes gens » donc la peine capitale21. Le jury écarte la préméditation et sauve sa tête tout en réclamant, hors séance, le maintien et l’application rigoureuse de la peine de mort22.
Tous trois sont condamnés aux travaux forcés, à temps pour Courtadon (douze ans) et Grissolange (quinze ans), à perpétuité pour Bazin, du fait de l’absence de circonstances atténuantes. Ils tuent avec leur poing ou une arme contondante basique. L’utilisation du couteau par Grissolange s’explique par leur travail dans un atelier de coutellerie au moment des faits. Ils frappent de nombreux coups, comme ils en avaient l’habitude. Il n’est pas possible de cerner la réalité d’une relation conjugale qui a duré des années, dont on ne perçoit que ce qu’ont pu rapporter les témoins. Néanmoins, les témoins en nombre important, aux liens très variables avec le couple (proches, famille, voisins, policiers et juges de paix, relations professionnelles) brossent un portrait qui éclaire le verdict23.
Dans un quatrième dossier24, Pierre Tixier est condamné à seulement cinq ans de réclusion pour avoir frappé son épouse sans intention de donner la mort, avec circonstances atténuantes, alors même que l’autopsie révèle des coups nombreux, une longue lutte et une strangulation, ce qui montre l’incapacité à vouloir établir judiciairement un lien entre des coups et le décès. De tels écarts de peine entre des faits qui sont, somme toute, assez semblables, ne peuvent se comprendre que par la personnalité de l’accusé, sa capacité à reconnaître les faits et le portrait social du couple dressé lors des interrogatoires. Pierre Tixier est présenté comme un personnage méprisable et cupide, mais guère nuisible à la société publique. Il ne causait pas de tort à son entourage et au voisinage. Il exerçait une violence circonscrite au cadre domestique dans lequel son épouse était captive, décrite selon le stéréotype de la bonne épouse, d’un « caractère bon et serviable ». Cette sanction est‑elle donc à la hauteur ? Notre humanité autant que notre sens de la justice et du droit nous interdisent de le penser, car son épouse décédée sous ses coups n’est pas moins victime que les autres. Elle aurait même pu susciter un émoi judiciaire en son temps, mais cette affaire rappelle combien la justice pénale française a été conçue pour punir des auteurs et non pour rendre justice à une victime. La peine est indexée sur une évaluation de l’auteur et non pas sur un désir de réparation de la mémoire de la victime.
Ce choc historique n’est pourtant pas lié à un biais de genre au sens strict. Certes, les épouses victimes sont toujours décrites comme de « bonnes » victimes alors que l’évaluation judiciaire, morale et sociale des auteurs s’étalonne du « bon » au très « mauvais ». Les dossiers d’homicides commis par des femmes offrent alors des éclairements utiles. Marie Décombat et Louise Mignot, toutes deux accusées du meurtre de leur mari, sont acquittées alors que les meurtres ont eu lieu devant témoin et les faits ne laissent aucune place au doute, même à un siècle de distance. Les époux de ces femmes, surtout celui de Louise Mignot, ne sont pas décrits de manière aussi défavorable, précise, circonstanciée et unanime, que les accusés évoqués plus haut.
Certes, dans le dossier Décombat25 sont évoquées des querelles conjugales « dont les torts semblent surtout en incomber à l’homme ». Il est décrit comme ivrogne et paresseux, et sa fille dit de lui qu’il est « très méchant pour ma mère et pour moi26 ». Après l’avoir aperçu, elle s’est enfuie de Châteaugay où elle avait été placée en sécurité chez ses grands‑parents maternels pour se réfugier auprès de sa mère à Cébazat. Marie Décombat avait demandé une séparation de corps, s’était réfugiée chez son frère au moment des faits et indique que ses cicatrices sont dues aux coups de son mari. La légitime défense n’est jamais évoquée dans le dossier27, alors que le droit français la connaît depuis fort longtemps, dans les critères que nous connaissons aujourd’hui. Répondre à une prise à la gorge par trois coups de revolver, dont un dans la nuque, arme qu’elle portait sur elle et disait avoir acquis par crainte de son mari, n’entre pas dans les critères de proportionnalité. La prise à la gorge n’est d’ailleurs pas prouvée, d’autant que le rapport médical ne révèle aucune blessure récente, mais des marques anciennes susceptibles d’être le fruit de coups violents. Un homme est mort, les éléments matériels sont indiscutables, mais cela aboutit à un acquittement.
Marie Décombat apparaît comme un symbole d’une émancipation qui fait son chemin dans l’esprit des juristes depuis la seconde moitié du xixe siècle28, une femme qui a cherché à protéger sa fille au prix d’une mobilité géographique et professionnelle importante et qui entretenait financièrement son époux, lequel est donc une « mauvaise » victime. Elle ne correspond pas au profil des femmes victimes qui n’ont pu s’extraire de leurs tâches sociales assignées, du huis clos domestique qui demeure le plus souvent le lieu du crime. C’est pourquoi les femmes victimes sont décrites dans nos affaires de manière idéalisée, ce qui traduit non pas une bienveillance ou une empathie sociale, mais plutôt le fait qu’elles remplissaient leurs fonctions, économiques et affectives auprès de leur mari, et que leur mort n’est donc pas justifiable aux yeux de la justice.
Le dossier de Louise Mignot est encore plus délicat29. Décrite comme une ménagère, mère de cinq enfants, elle paraît davantage correspondre au profil de la femme victime plutôt qu’autrice d’un homicide conjugal. L’affaire se déroule dans une atmosphère familiale de proximité et de tension, notamment autour d’une querelle successorale. Le jour des faits, le mari de Louise Mignot aurait menacé la sœur de l’accusée d’une hache. Elle aurait alors employé un bâton pour le désarmer puis saisi la hache pour lui asséner trente coups avec une force telle que des témoins ont cru entendre « fendre du bois ». Quelques jours avant le meurtre, Louise Mignot avait déjà été vue en train de frapper son mari à coups de marteau, avec une issue mortelle interrompue par un tiers. Elle aurait hurlé :
Laissez‑moi encore lui donner quelques coups, il faut que ça finisse.
Cela plaide pour la préméditation du crime à venir30. Un tel déchaînement de violences est révélateur d’une volonté de détruire totalement l’individu et de « mettre fin » selon les propres termes de l’accusée. Lors de son interrogatoire, elle dit avoir « perdu la tête » et ne plus se souvenir de ce moment de rage où elle pense avoir frappé « quatre, cinq ou six coups ». Elle ne cesse de répéter, comme une forme d’amnésie traumatique qui ne correspond pas aux vagues dénégations de mauvaise foi des dossiers masculins :
Je ne sais pas, je ne sais plus.
J’étais folle.
La victime, Hippolyte Denèfle, est décrite comme paresseux et ivrogne mais de manière fort peu unanime31. D’autres témoignages avancent le contraire, dont l’ensemble des débitants de boissons de Rochefort‑Montagne, et le couple n’était pas connu pour ses querelles. Certains disent même qu’ils les trouvaient unis. Il serait fort étonnant qu’une querelle successorale, une simple mésentente dans un couple, aboutisse à un tel déchaînement de violence. « L’acharnement meurtrier », selon l’expression récemment consacrée32, pourrait s’analyser comme une réponse à une violence extrême subie par Louise Mignot ou une manifestation de désordres personnels inconnus. La vérité de la vie de ce couple et de la personnalité des protagonistes, n’est pas dans le dossier. Toutefois, elle est bel et bien acquittée alors que les magistrats penchaient sans doute pour la condamnation, si l’on considère les questions posées au jury. Subdiviser les questions et ne pas se contenter d’un oui/non sur le seul point de l’homicide volontaire est un moyen habituel d’assurer une condamnation, même réduite. Pourtant, dans nos affaires, les questions sont subdivisées dans les cas les moins extrêmes comme si les magistrats avaient voulu, dans les affaires « Bazin » et « Mignot », « faire tapis » et ne poser que la question de l’homicide volontaire, sans préméditation, afin d’assurer une lourde peine. Stratégie à double tranchant puisque Bazin écopa des travaux forcés à perpétuité et Mignot de l’acquittement. Dans la chronique judiciaire du journal La Croix d’Auvergne du 3 décembre 1905, on lit que malgré la volonté formelle de l’accusée de tuer son mari, le jury prononce l’acquittement, « impressionné par la clémence du réquisitoire et par la défense chaleureuse de son avocat, évoquant surtout l’existence des cinq enfants qu’il ne faudrait laisser complètement orphelins ». On apprend aussi dans le Riom républicain du 30 novembre que l’avocat général a prononcé « un réquisitoire des plus éloquents et qui cause une profonde émotion. Il demande au jury d’être sévère mais d’accorder à l’accusée les circonstances atténuantes ». Le journal rappelle que :
[La] femme Denèfle, malgré les larmes qu’elle ne cesse de verser, ne semble pas regretter profondément l’acte qu’elle a commis.
Les juges ont donc maintenu ce qu’il reste de la famille, au mépris du droit, ce qui donne matière à penser par rapport à des conclusions issues de dépouillements sériels régionaux. En effet, pour Victoria Vanneau, la cour d’assises « ne s’est pas vouée, alors, contrairement aux tribunaux correctionnels, à la défense des valeurs familiales et conjugales. […] Les qualités de l’accusé, son sexe et sa situation sociale en particulier ont alors peu compté […]. À l’endroit des épouses qui maltraitent, estropient ou tuent, point de cette indulgence spéciale, pétrie de paternalisme, qu’on prête si volontiers aux assises du xixe siècle33 ». Ces modestes contre‑exemples devront être étayés et enrichis par d’autres ainsi que par des développements sociologiques et criminologiques car, hier comme aujourd’hui, l’appréhension du sujet par le seul prisme juridique mène à des impasses et des conflits nuisibles à la cohésion du corps social.