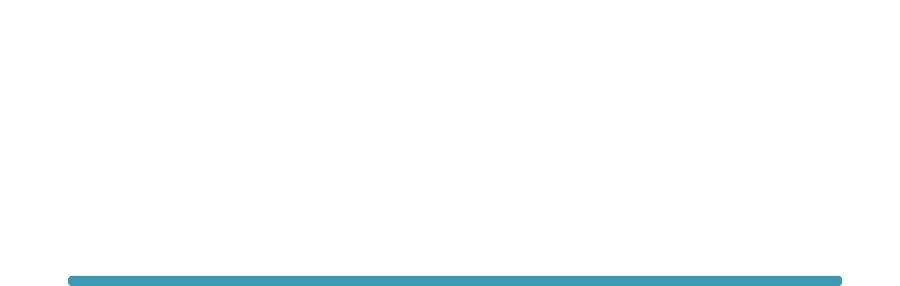Introduction
Le Grand siècle voit la France accroître sa présence en Amérique, après le contrôle du Québec et de la région des Grands Lacs et de celle des grands fleuves du continent. Cavelier de la Salle atteint le delta du Mississippi en avril 1682, proclamant ce nouveau territoire propriété du roi de France, en l’honneur duquel il le nomme « Louisiane ». La monarchie peut désormais contrôler l’accès des terres couvrant le continent américain du nord au sud, ce qui lui offre un puissant avantage sur ses rivales anglaise et espagnole. Guère préoccupée de son développement au début, la France réagit aux ambitions d’outre‑Manche et colonise le territoire, encourageant en vain ses sujets à émigrer en Louisiane. Un édit de 1712 octroie la concession de la Louisiane à Crozat1, cette nouvelle politique favorisant la croissance de la population locale2 même si le nombre d’habitants reste insuffisant pour garantir l’avenir de la colonie. La zone d’influence française est bien moins grande que ne le suggère une carte géographique, une petite portion de territoire étant effectivement contrôlée avant la fondation de La Nouvelle‑Orléans en 1718. La coutume de Paris3 et les grandes ordonnances de la monarchie, notamment l’ordonnance sur la procédure civile de 1667 et l’édit de mars 1724 ou « Code Noir », sont alors appliquées jusqu’en 17634. Craignant qu’elle tombe entre des mains anglaises, Louis XV vend la colonie à l’Espagne par un accord secret avec Charles III, confirmé par le traité de Paris. Le nouveau souverain veut appliquer localement la Recopilacion de las Indias (le droit des Indes) et les Siete Partidas5, mais les habitants se rebellent contre la nouvelle administration. L’Espagne ne contrôle effectivement le territoire qu’après l’intervention de O’Reilly en 1769, alors que les Louisianais parlent toujours français et se considèrent comme tels. Au demeurant, le changement juridique est très relatif car les lois espagnoles sont proches du droit colonial français6. En 1800, l’Espagne cède à nouveau le territoire à la France par le traité de San Ildefonso, dont la signature reste secrète jusqu’en 1802, ce « retour » officiel n’étant effectif qu’au 30 novembre 1803... soit vingt jours avant que Bonaparte cède la Louisiane aux États‑Unis d’Amérique7. Le droit français n’a donc jamais été rétabli en Louisiane en 1803. Familiarisés avec un droit civil d’origine franco‑espagnole, les habitants redoutent à l’arrivée des Américains, leur langue et leur droit inspiré du common law8, notamment dans ses effets sur le droit de propriété9. La Louisiane conserve l’influence juridique française et espagnole grâce à l’action de juristes diplômés de l’université de Paris ou formés localement selon la tradition civiliste. Le Code civil de 1808, adopté sous la forme d’un Digeste, est le premier adopté après le Code Napoléon dont il est partiellement inspiré. Refondu en 1825, le code est substantiellement révisé en 1870 et régulièrement mis à jour depuis le milieu du xxe siècle. Les codes de 1808 et de 1825 sont initialement rédigés en français, leur version promulguée comprenant une traduction anglaise. Le code révisé de 1870, publié seulement en anglais, marque officiellement la fin du bilinguisme en Louisiane. Les projets actuels de retraduction du Code civil en français sont motivés par l’intérêt scientifique de l’étude renouvelée du bilinguisme juridique10.
L’existence d’un code civil11 sur le territoire américain est plus que symbolique12 sur le plan culturel, car elle apporte sa légitimité à la tradition civiliste locale. Le Code de 1808 s’inscrit dans un contexte politique fédéral d’hésitation dans le choix du modèle à adopter13, le droit américain en construction se différenciant largement du droit anglais, Roscoe Pound14 ironisant sur le rôle historique de l’« ignorance ». Avant même l’indépendance, certains États fondent leur droit sur la Bible, quand d’autres s’en remettent à l’interprétation des juges. En réaction à l’arbitraire de ces derniers, des codes sont adoptés dès le xviie siècle au Massachusetts (1634) et en Pennsylvanie (1682), qui expriment un attachement à la loi écrite comme source de droit alternative à la jurisprudence. Ce n’est qu’au siècle suivant que le common law, héritage commun aux peuples anglophones et valorisé par la lutte contre l’influence française, acquiert une meilleure image. Par ailleurs, les conditions de vie locales qui s’améliorent appellent un droit moins rudimentaire. Après l’indépendance, l’émancipation par rapport à la couronne anglaise conduit les Américains à affirmer leur propre identité juridique. Dès 1787, les États‑Unis se dotent d’une constitution qui a vocation à être complétée par des codes, au nom de l’idéal républicain et du droit naturel. Le début du xixe siècle est une période de flottement entre une codification civiliste et l’adoption du common law fédéral ou de celui pratiqué par les États. Aussi le droit français est‑il envisagé pendant un temps de manière favorable, alors que le droit romain jouit d’un certain prestige auprès des hauts magistrats15. Quelques États se dotent d’un code pénal et d’un code de procédure pénale, sans adopter intégralement un modèle civiliste. Les États hispaniques comme le Texas16 et la Californie se rallient au common law, les nombreux immigrants issus de cultures différentes n’y étant pas adeptes du droit anglais. Lors de la cession de la Louisiane en 1803, le droit colonial espagnol en vigueur compte plus de 20 000 textes et de multiples dispositions souvent contradictoires, intégrées dans onze codes distincts. Le droit colonial français antérieur à 1763 est alors fondu dans le droit espagnol, officiellement non abrogé. La complexité d’un droit aussi prolifique est accentuée par l’absence d’ouvrages doctrinaux de référence jusqu’à la fin du xixe siècle. L’influence civiliste déclinant, le droit américain se construit autour d’un common law adapté qui triomphe après 185017, sauf sur la rive est de la rivière Sabine.
Par l’intégration progressive des apports du common law, la Louisiane hérite d’une double culture juridique (ou « bijuridisme ») qui complique les effets et la portée d’un droit parfois mal maîtrisé. Le Code civil reste la source principale du droit local, bien qu’il emprunte aujourd’hui d’importants éléments du common law américain, y compris dans sa terminologie. La mise en œuvre des réformes successives contribue à ce que les juristes ressentent la nécessité de conserver la maîtrise du droit civil et de ses principes, afin de rendre le common law compatible avec le Code civil18. Après les grandes révisions de 1960 et 1992, la dernière modification a été réalisée en 201619. La révision du droit échappe rarement à un détour intellectuel par ses racines les plus profondes, ce qui vaut surtout pour les codes, lesquels « se font avec le temps » (Portalis). Au‑delà d’une approche positiviste ou technique, le Code civil de Louisiane apparaît comme le fruit de la codification d’un droit pluriculturel20, conservant une tradition civiliste d’origine française et portant l’empreinte espagnole (I). À défaut d’« importer » des pans entiers du système juridique romano‑germanique comme mode de production normative, la Louisiane a bâti son droit dans un relatif équilibre entre la volonté de défendre son héritage juridique franco‑espagnol et la nécessité d’assumer son identité politique d’État américain. Il est donc moins question de système que de modèle juridique, car c’est à partir de la culture francophone que les autorités locales et les juristes, porteurs d’une culture juridique européenne, ont construit et pensé leur propre modèle de droit civil, à rebours d’un système transposé par une politique coloniale. Que le Code Napoléon soit postérieur à la Louisiane française est une réalité qui pose avec plus d’acuité la question des modalités de formation du modèle civiliste louisianais à partir de son premier Digeste. Par ailleurs, si la langue de Molière a été porteuse de la culture juridique française en Louisiane, c’est la nature mixte du droit local qui inspire aujourd’hui d’audacieux projets de recherche dans la linguistique juridique. À travers les langues, anglaise et française, et les traditions juridiques européennes, tant de droit civil que de common law, la doctrine et la jurisprudence peuvent ainsi faire dialoguer les cultures juridiques (II).
I. Le Code civil comme héritage d’un droit pluriculturel en Louisiane
Les auteurs des codes civils de 1808 et 1825 puisent une grande partie de leur inspiration dans les droits espagnol et français (A). En dépit d’une certaine continuité, le Code civil de 1870 et les révisions postérieures marquent la fin du bilinguisme officiel et un début d’émancipation par rapport au modèle français de production du droit, qui amènent la Louisiane à forger sa propre identité dans la tradition civiliste (B).
A. L’inspiration franco-espagnole des premiers codes louisianais
Les codes civils de 1808 et de 1825 forment presque un tout cohérent, les codificateurs prenant alors modèle essentiellement sur le Discours préliminaire de Portalis et sur le Code civil de 1804, même si l’influence du droit espagnol hérité de la période précédente est présente dans l’esprit romain de certaines dispositions. Par une loi votée en mai 1806, le Conseil législatif de Louisiane, composé majoritairement de francophones, déclare que les lois en vigueur sont « le Code civil romain, qui est le fondement du droit espagnol sous le régime duquel ce territoire vivait avant sa cession à la France puis aux États‑Unis », ainsi que le droit espagnol21. Après deux ans d’affrontement sur la question du droit applicable, le Conseil décide de faire préparer un code pour l’ensemble du territoire. Le droit colonial espagnol antérieur apparaît aux notables locaux comme moins familier que la culture juridique française, entendue comme une perception collective, spontanée et traditionnelle22. La bourgeoisie créole de La Nouvelle‑Orléans défend la tradition civiliste comme une part importante de son identité : le Digeste des lois civiles actuellement en force dans le territoire d’Orléans23 rattache symboliquement le droit local à la tradition civiliste européenne. Rédigé par les avocats Brown, Moreau‑Lislet et Livingston24, et promulgué le 31 mars 180825, le premier Code civil de Louisiane – qui concerne plus de 50 000 Français et est promulgué en deux versions, française et anglaise26 – puise son inspiration dans notre Code civil de 180427, mais aussi, ce qui est moins connu, dans le Discours préliminaire de Portalis28. Cette impulsion donnée à son esprit29 est initialement nécessaire à son application par des juges souvent étrangers à la tradition civiliste. La pensée juridique de Portalis semble même avoir pris corps en Louisiane plus qu’en France, où elle n’est restée qu’un symbole doctrinal. Inspiré de la famille romano‑germanique, le contenu du Code louisianais est proche du droit français et porte l’empreinte espagnole30. Le Digeste de 1808 apparaît beaucoup plus « doctrinal » que le Code Napoléon par le fait qu’il contient un plus grand nombre de définitions, qui sont censées rendre le droit civil plus accessible aux juristes de common law installés après l’indépendance. Au demeurant, les codificateurs s’écartent parfois de leur modèle et adoptent des solutions inspirées de la doctrine de l’ancien droit : le Code de 1825 fait ainsi l’objet de nombreux amendements inspirés de Domat, Pothier, Toullier et d’autres commentateurs français31.
Afin d’anticiper les problèmes d’interprétation linguistique, le Parlement de Louisiane décide qu’en présence de « toute obscurité ou ambiguïté, faute ou omission, les deux textes [français et anglais] devront être consultés et devront servir mutuellement à l’interprétation l’un par rapport à l’autre ». Il est vrai que l’applicabilité des deux versions entraîne des confusions en raison de leur disparité. Dans un premier temps, la Cour suprême de Louisiane respecte la décision du Parlement l’enjoignant de comparer les deux textes afin d’appliquer le plus complet. Ultérieurement, elle affirme que les deux versions font autorité et que le respect des dispositions de l’un ou de l’autre doit être considéré comme suffisant, ce qui aggrave la confusion juridique locale. La jurisprudence devient alors beaucoup moins prévisible, un avocat pouvant écarter une disposition claire de la version française du code en invoquant un article de la version anglaise mal traduit, mais favorisant son argumentation. La Cour suprême de Louisiane ne simplifie pas les choses par son arrêt Cottin v. Cottin de 181732, selon lequel l’acte du Parlement adoptant le Digeste de 1808 n’abroge que les lois françaises antérieures incompatibles avec ce dernier, mais non le droit espagnol censé rester en vigueur, sauf abrogation expresse. Cette décision fait rapidement ressentir le besoin de réviser le premier code. Afin de redonner sa cohésion au droit louisianais souffrant d’un manque de rigueur et de précision, le Parlement vote la révision du Code de 1808, confiée à Moreau‑Lislet, Derbigny et Livingston. Leur mission est de préparer un code complet dans le but de libérer les tribunaux de la tâche « d’examiner les lois, ordonnances et usages espagnols », quasiment tous abrogés au moment de la rédaction du deuxième code33. Le Code civil de 1825 compte 3 522 articles contre 2 160 pour le précédent, leur comparaison montrant que le code révisé traite une série de questions nouvelles. Les deux codes sont conçus sur le modèle tripartite du Code civil français. Le Code de 1825 est initialement préparé en français, le Parlement ordonnant qu’il soit publié en anglais et en français. La traduction anglaise est généralement considérée comme médiocre, la Cour suprême estimant que « la définition sur laquelle se fonde la partie anglaise d’un des articles du code ne prouve rien d’autre que l’ignorance de la personne qui l’a traduit du français34 ».... Décidant qu’en cas de divergence le texte français devra prévaloir, la Cour suprême de Louisiane abandonne sa jurisprudence de 1817. Les codes de 1808 et de 1825 reprennent la tradition française en droit des biens, en droit des régimes matrimoniaux et en droit de la preuve. On y retrouve ainsi l’antichrèse, la dation en paiement, ainsi que l’importance de l’acte authentique, pourtant assez éloigné de la culture juridique anglo‑américaine. Les rédacteurs portent aussi l’empreinte du droit romain et du droit canonique35, tant par le biais de la tradition juridique française qu’à travers l’empreinte des lois castillanes.
Techniquement, la transition du droit français vers le droit espagnol après 1763 est facilitée36 par la proximité des deux droits civils, plus ou moins imprégnés du droit romain, dont la Louisiane connaît quelques survivances37. Les rédacteurs du Code de 1808 abrogent les fueros, les Siete Partidas et les Recopilaciones espagnols considérés comme incompatibles avec le droit français. Dans une étude ancienne mais toujours pertinente, Batiza avait relié 87 % des 2 160 dispositions du Code de 1808 à des sources françaises et seulement 8 % d’entre elles à des sources espagnoles. L’influence castillane est présente en droit des successions38, dans le régime de la communauté des acquêts ou des gains (sociedad de ganancias) et dans la vente d’immeubles. L’esprit de la cinquième Partida sur le droit des contrats et le droit commercial se retrouve ainsi dans le Code de 1825 à travers la communauté d’acquêts espagnole39. En matière successorale, les causes d’exhérédation rappellent également celles qu’admettent les Siete Partidas40. La difficulté de comparer ces deux influences est due à la similarité entre les droits français et espagnol, tous deux héritiers du droit romain et du droit canonique, d’où la formule désignant le code louisianais comme « une fille espagnole habillée à la française41 ». Le Code civil de 1870 et les révisions postérieures montrent une volonté de s’émanciper du modèle français tout en conservant la tradition civiliste pour mieux en approfondir l’identité dans son environnement économique, social et linguistique.
Malgré le contenu du Code civil de Louisiane de 1870 qui reproduit, intégralement ou partiellement, environ 1 800 articles du Code Napoléon, la volonté d’émancipation par rapport au mode français de production du droit se ressent dans ce dernier code et les révisions postérieures. Dans un contexte politique fédéral tendant à l’harmonisation des droits des États, l’influence du common law en tant que source de droit externe commence alors à s’exercer à l’échelle locale, plus dans les techniques et les méthodes que sur le fond du droit civil.
B. L’émancipation locale par rapport au modèle civiliste français
Après la Guerre de Sécession, la Louisiane révise à nouveau son Code civil pour des raisons politiques, le Parlement devant « purger les démons de l’esclavage » des lois locales. Le nouveau Code de 1870 commence par supprimer les dispositions traitant de l’esclavage, aboli en 1865. Ses auteurs incorporent tous les amendements adoptés depuis 1825 et intègrent les actes du Parlement de Louisiane votés la même année. Dans l’essentiel de ses dispositions, le Code de 1870 est le même que celui de 1825, mais il est adopté et promulgué uniquement en anglais, sans traduction française. La jurisprudence continue malgré tout d’accorder une place importante à la langue de Molière dans l’interprétation du Code, ce qui est un facteur déterminant dans l’approche terminologique des civilistes. Or, un début d’émancipation du droit louisianais par rapport à son modèle français d’inspiration s’explique par ces mêmes raisons linguistiques, au regard du choix politique de la langue employée pour le droit. Alors que les anciens juristes lisaient le français ou l’espagnol, ceux qui arrivent en Louisiane au moment de la conquête de l’Ouest ou qui ne parlent que l’anglais se réfèrent spontanément aux traités de common law et aux recueils de jurisprudence publiés en anglais42. Depuis, les décisions de la Cour suprême de Louisiane citent beaucoup plus le common law américain. Les références au Code civil ne sont plus systématiques, les tribunaux citant de plus en plus les jugements rendus antérieurement et la doctrine en langue anglaise.
L’usage et la transmission du français déclinant continuellement43, l’absence de traités de droit civil traduits détermine la Cour suprême de Louisiane à s’inspirer des ouvrages de common law et de la jurisprudence comme source de droit (case law). La doctrine, tout comme la jurisprudence, a horreur du vide... Faute de théoriciens du droit civil à la fin du xixe siècle, la haute juridiction commence à citer sa propre jurisprudence au détriment du Code civil. Vers 1900, les jugements détaillés accompagnés de longs extraits de témoignages deviennent une pratique courante, alors que le common law en matière de responsabilité (tort) est intégré au droit louisianais. Les différences de conception de l’institution judiciaire entre la France et les États‑Unis expliquent aussi que le droit local se soit progressivement émancipé de son modèle d’origine. Dans la foulée de la décision Marbury v. Madison rendue en 1803 par la Cour suprême des États‑Unis, les cours suprêmes des États fédérés sont devenues compétentes pour apprécier la constitutionnalité des actes législatifs44. Les juridictions de Louisiane ont été alors amenées à œuvrer à l’harmonisation du droit de l’État par le biais du common law fédéral, par l’adaptation de la tradition civiliste.
Les États fédérés ont toujours progressé de manière assez spontanée, certes par des voies différentes, vers l’harmonisation juridique. Le common law a pénétré en Louisiane par un certain nombre de réformes et par la jurisprudence fédérale. La loi écrite (statute law) permet de « standardiser » une matière, ce qui en fait un mode normatif assez éloigné de notre tradition civiliste européenne, même si les auteurs de common law distinguent parfois mal statute law et codification45. Sur la forme, il s’agit de « rassembler en un “code” des textes déjà unifiés et d’en profiter pour moderniser le droit46 ». En droit des affaires, le droit local de la vente ressemble aujourd’hui davantage au droit américain qu’au droit français. Il existe de nombreuses « lois uniformes » spécialisées, dont la plus connue est le « Code de commerce uniforme » (Uniform Commercial Code) de 1952. L’U.C.C., qui contient des principes généraux comme l’interprétation téléologique et la bonne foi, sert de modèle au common law au point qu’il en est parfois considéré comme l’expression47. Ce texte est typique du pragmatisme juridique américain même si ce n’est pas un code de commerce au sens français ou allemand du terme. Après la lutte persistant au xxe siècle entre les partisans de l’intégration du common law américain et les défenseurs de la tradition civiliste, la Louisiane a adopté l’U.C.C. en excluant des aspects contraires à l’esprit du Code civil. L’apparition de ces codes uniformes montre qu’en dépit de la grande influence du common law sur la Louisiane, celle du droit civil sur le common law américain est encore très prononcée avant 195048. L’importance de la jurisprudence dans le common law américain est relativisée à mesure de l’adoption de codes, la règle du précédent (stare decisis) n’ayant pas la même intensité qu’en Angleterre.
Comme dans beaucoup d’États américains et en Grande‑Bretagne, la fonction de juge en Louisiane est traditionnellement réservée aux avocats expérimentés, pour leur maîtrise des rouages de la procédure. Par leur légitimité électorale, les juges se montrent sensibles à l’expression de l’opinion publique tout en conservant leur indépendance à l’égard du politique. Sous cet angle, la résistance relative du modèle civiliste en Louisiane peut être perçue comme un héritage culturel « démocratique » lointain du droit français49. La culture juridique française a même parfois survécu aux différentes souverainetés sous forme de coutumes et d’usages, transmis de génération en génération par les praticiens locaux50.
L’expérience historique de la codification d’un droit pluriculturel à la fois français, espagnol, anglais et américain dans l’ancienne colonie invite à reconsidérer le Code civil de Louisiane comme le vecteur d’un dialogue des cultures juridiques, cristallisées par leur adoption, leur rejet ou leur influence indirecte. Le « bijuridisme », terme technique incarnant la richesse d’un droit mixte mêlant common law et droit civil, est doublé d’un bilinguisme universitaire qui ouvre des perspectives de comparaison et de réflexion sur les potentialités d’un tel droit et les inclinations des juristes qui le pratiquent ou l’étudient. L’histoire du droit civil louisianais est indissociable d’un mouvement politique, sociologique et culturel, passé de l’hésitation dans le choix du modèle juridique applicable à la concurrence, voire l’émulation, entre common law et droit civil.
II. Le Code civil de Louisiane dans le dialogue des cultures juridiques
Comprendre les mécanismes du dialogue des cultures juridiques à partir de l’expérience de la Louisiane suppose d’en identifier non seulement les enjeux mais surtout le rôle de certains acteurs. L’ordre juridique local est assurément le fruit d’une expérience historique originale, par la structure binaire de son mode de production du droit (A). Grâce à un certain recul, ce « bijuridisme » n’offrirait‑il pas une source d’inspiration, modeste mais sans doute utile, aux projets d’harmonisation juridique à l’étude sur le continent européen (B) ?
A. La nature et la portée du « bijuridisme » en Louisiane
Le système mixte est « un droit dont les institutions émanent de systèmes juridiques différents et résultent de l’application cumulative ou de l’interaction de techniques qui appartiennent ou se rattachent à ces systèmes51 ». En Louisiane, la mixité du droit s’entend aussi bien hors le Code civil que dans le Code civil par un esprit dialogique entre le texte et celui qui l’applique. Les modalités d’application locale du common law sont spécifiques et il est assez délicat de qualifier la manière dont évolue le droit louisianais, qui oscille entre l’adoption préparée du common law et son influence plus ou moins assumée pour des raisons pratiques dans la rhétorique judiciaire. L’environnement culturel de la Louisiane donne également toute sa particularité et sa richesse à l’approche civiliste de la jurisprudence et de la doctrine.
La manière dont le common law exerce son influence en Louisiane soulève une question d’ordre sociologique, le droit commun américain pénétrant d’une manière progressive dans la culture juridique locale. La portée du common law s’observe dans le cadre des premières divergences au sein de la Cour suprême de Louisiane après l’adoption du Digeste de 1808. En 1811, dans le premier arrêt Orleans Navigation Co. v. New Orléans, les juges Lewis et Martin52 sont divisés. Dans le cadre de la même affaire rejugée, le juge Mathews rédige l’opinion de la majorité à laquelle Lewis se rallie, Martin restant d’avis contraire. Or, le juge Mathews regrette que Martin se détourne, avec un « dégoût apparent de toutes les expressions tirées de la common law [...] alors que les caractéristiques ou l’appellation d’un droit ne sont pas propres à la common law mais qu’elles ressortent du sens commun ainsi que du droit romain qu’il insiste pour considérer comme la seule autorité valable ». Le juge Mathews considère que la distinction entre le droit civil et le common law a peu d’importance et qu’il est « tout à fait superflu, les solutions étant les mêmes dans les deux systèmes de droit, de se demander si elles avaient été établies par un édit du préteur romain, ou d’un empereur, ou définies par un éminent juriste anglais53 ». Le juge Martin, originaire de Marseille et qui a étudié le droit en Louisiane et maîtrise autant le droit civil que le common law, affirme alors « que la common law d’Angleterre n’était pas reconnue par les parties comme règle de conduite ; et qu’au contraire, la règle du droit civil, seule applicable dans l’État, différait totalement sur ce point de celle qu’il avait plu à la Cour de prononcer54 ». La divergence des juges dans la perception des sources de droit est révélatrice de la difficulté à s’identifier à un modèle juridique dans le jeune État de Louisiane. Si l’origine nationale de Martin explique probablement sa préférence pour la tradition civiliste, ses prises de position en tant que juge n’en sont pas moins emblématiques de la complexité du choix qui s’impose entre deux approches du droit local, c’est‑à‑dire de la manière de concilier deux droits.
La procédure suivie par les juridictions de Louisiane est également hybride, mêlant des aspects civilistes et de common law. Dès 1805, une loi inspirée du modèle espagnol simplifie la procédure civile, codifiée en 182555. Les décisions anciennes de la Cour suprême de Louisiane – réunies et publiées par le juge Martin – rappellent sensiblement les décisions françaises par leur contenu bref et concis, mais en diffèrent par l’apposition de la signature personnelle des juges. Dans un premier temps, la jurisprudence se fonde presque exclusivement sur les articles du Code de 1808 et sur des opinions doctrinales françaises, alors que les ouvrages traduits en anglais sont extrêmement rares, à l’exception du Traité des obligations de Pothier traduit par le juge Martin. Dès le milieu du xixe siècle, les juges locaux citent dans leurs décisions, entre autres, le Story on Abatements et le Edwards on Abatement, même si la doctrine française est encore présente à travers les références à Merlin, Pothier, Toullier, Troplong ou Duranton56. Il devient alors fréquent de voir les décisions rapportées avec les opinions divergentes et concordantes des juges57, alors que l’autorité de la doctrine française décroît. Dans ces procès, les mémoires et plaidoiries, parfois reproduits avec les décisions, se réfèrent souvent au common law et cela même à travers la parfaite maîtrise du droit civil par les avocats. D’importants éléments du common law ont pénétré ainsi le droit louisianais par le biais de l’autorité doctrinale de grands auteurs, dans une approche qui demeure pourtant d’esprit civiliste.
En substance, le droit prétorien de la Louisiane appartient « génétiquement » à la tradition civiliste58. Les juristes locaux considèrent aujourd’hui encore que le Code civil est la source principale de leur droit et que les textes législatifs servent à régir des questions particulières comme autant d’instruments de réforme. Les techniques importent autant que le contenu d’un droit dans la manière de l’étudier. Au demeurant, l’approche civiliste du droit en Louisiane se situe en‑deçà de la tradition civiliste européenne. La résistance d’un modèle civiliste suppose certes l’existence d’un Code civil, mais aussi la vocation de ce dernier à jouer le rôle d’une source de droit par l’interprétation des juges59. De nos jours les juges locaux appliquent moins le Code civil qu’ils ne l’utilisent comme norme de contrôle dans l’application des lois de l’État et du common law. Il en va de même des droits « spéciaux », comme auparavant le droit des mines en Louisiane (ou au Texas) qui régissait des industries locales et soulevait des problèmes non envisagés par le code, d’où la difficile intégration des règles inspirées de la doctrine en droit minier, « l’exemple le plus considérable d’une extension faite par analogie du code à un cas non prévu60 ».
La forme joue autant sinon plus que les règles de fond dans la mise en scène du droit. La plupart des avocats et des juges considèrent qu’une jurisprudence constante a l’autorité du précédent en Louisiane61. Il est reconnu que la jurisprudence a la même force que la doctrine, les tribunaux la considérant depuis la seconde moitié du xxe siècle avec autant de respect que les écrits d’un auteur reconnu62. Le droit prétorien a acquis la même autorité que les écrits doctrinaux, mais dans une approche plus civiliste qu’influencée par le common law des États voisins. Si dans ce système une loi écrite n’intéresse les juristes que dans la mesure où elle a déjà été interprétée par les tribunaux, la conception des sources de droit est différente en Louisiane. Les juges ne semblent en effet attacher d’importance qu’à la seule jurisprudence constante compatible avec le Code civil, ses commentaires et la doctrine, d’où un style judiciaire discursif et construit sur le modèle de celui des autres États américains63. Dans cette optique, l’opinion majoritaire, concurrente ou dissidente d’un juge s’appuie très souvent sur des références doctrinales, contemporaines ou non64. Les décisions des cours d’appel et de la Cour suprême sont publiées in extenso dans des recueils officiels, avec les avis des juges. Les commentaires d’une décision qui ne concerne par définition que la cause du litige, permettent d’en anticiper les conséquences dans un champ plus large65. Le juge qui rédige une opinion doit ainsi convaincre les autres juges de la pertinence de son point de vue, dans l’esprit des droits latins selon lequel une interprétation doit l’emporter non seulement pour aboutir à une solution, mais surtout comme impératif épistémologique66. La réalité judiciaire en Louisiane reste tributaire d’un héritage culturel de la respublica dans l’infrastructure locale. La jurisprudence de la Cour suprême de Louisiane s’adresse aussi à toutes les cours inférieures, comme les cours d’appel aux tribunaux de première instance. D’une certaine manière, les juges s’adressent aux avocats, professeurs et étudiants en droit, comme aux citoyens en général.
La doctrine est la source dont l’orientation générale reflète les mouvements de fond d’un droit mixte en évolution quasi‑permanente. Les travaux du Louisiana State Law Institute créé en 1938, à l’instar des programmes d’études à l’université, témoignent dans l’ensemble d’une tendance à maintenir voire à développer la tradition civiliste. Les universitaires jouent un rôle accru dans l’évolution du droit louisianais tout au long du xxe siècle : dès 1916, l’Université de Tulane entreprend le premier travail doctrinal important avec le lancement de la Southern Law Quarterly, devenue aujourd’hui la Tulane Law Review. L’Université d’État de Louisiane67, l’Université Loyola ainsi que la Southern University y contribuent plus tard en publiant leurs propres revues. Le conseil du Louisiana State Law Institute joue également un rôle majeur dans la conservation de la doctrine civiliste par la traduction d’ouvrages de Planiol68, Aubry et Rau69, Gény70 ou encore des articles de Carbonnier71. Il faut reconnaître aussi la contribution apportée par des auteurs contemporains qui ont publié en anglais, comme André Tunc et René David72. L’Institut a aussi entrepris la publication d’une série de traités sur le droit de propriété, les servitudes personnelles et le droit des obligations. Dainow est par ailleurs l’auteur de nombreux ouvrages sur le droit civil de Louisiane73 et de deux volumes des codes civils retraçant l’histoire de chaque article74. Cette « exégèse » locale est complétée par des tables et tableaux de concordance qui permettent de remonter à la source des dispositions du code et de référencer les commentaires doctrinaux dans les revues. Malgré la moindre fréquence des commentaires de décisions en comparaison avec les pratiques française et italienne, la Louisiana Law Review publie chaque année un numéro spécial dans lequel les auteurs font l’analyse critique des décisions importantes rendues par les cours d’appel. Les revues juridiques publient aussi beaucoup de « notes » sur la jurisprudence, le Code et les lois de l’État75. Une autre particularité de la Louisiane réside dans la nature du rapport entre les professionnels du droit. Alors qu’en France, ces métiers relèvent de corps et souvent de réseaux distincts, en Louisiane – comme aux États‑Unis en général – ils appartiennent aux mêmes associations d’avocats et peuvent collaborer à la révision du droit et aux travaux de l’Institut. Il est fréquent que des juges et des avocats se voient confier d’importants enseignements en droit à l’université et que des professeurs soient d’excellents praticiens. Jurisconsulte des temps modernes, l’universitaire américain a progressivement gagné en prestige à mesure de son expérience dans les tribunaux, généralement dans un rapport de qualité avec l’univers du prétoire. Non seulement les praticiens peuvent recevoir une formation continue dans les universités et les associations d’avocats, mais celle‑ci est aussi ouverte aux juges. Chaque année, les membres de chaque cour de Louisiane se réunissent dans un séminaire propre à leur juridiction et souvent animé par des universitaires. Ces derniers ont été aussi régulièrement sollicités dans la préparation des avant‑projets de travaux de codification.
Tout en s’efforçant de conserver un modèle civiliste, la Louisiane dépasse la conception classique des rôles du juge, de l’avocat et de l’universitaire. L’enseignement du droit en Louisiane est lui‑même de nature mixte : le programme de l’Université d’État contient ainsi une instruction obligatoire en droit civil et en common law, les étudiants pouvant développer leur capacité à comprendre comment est pensée la règle de droit dans les deux systèmes. Cette formation « bijuridique », à l’image du droit local, explique pourquoi les juristes formés au droit louisianais sont tant convoités par les employeurs dans un contexte de mondialisation. Le lawyer (professionnel du droit au sens large) formé en Pennsylvanie a moins de chances de connaître le droit civil qu’un confrère ayant étudié en Louisiane. Le juriste louisianais, qui connaît et maîtrise aussi bien le droit civil que le common law, peut exercer son métier partout où l’un des deux droits est pratiqué, que ce soit en France, en Angleterre, aux États‑Unis ou au Canada. Par ailleurs, le fait d’avoir deux systèmes juridiques distincts sur son propre territoire attire l’investissement étranger et confère d’autres avantages significatifs dans un marché globalisé76. Le Code civil de Louisiane pourrait ainsi contribuer à éclairer certains débats académiques sur l’harmonisation du droit, en particulier s’agissant du continent européen.
Le dialogue local entre common law et droit civil, par‑delà ses aspects judiciaire et doctrinal, résonne également à travers la linguistique. Quelques auteurs envisagent même sérieusement le Code civil de Louisiane comme une source d’inspiration pour un futur code civil européen.
B. La perception du Code civil de Louisiane au‑delà des frontières
La publication légale n’étant prévue qu’en anglais depuis le Code civil de 1870, l’État de Louisiane encourage de plus en plus l’enseignement et l’usage de la langue française, notamment à destination des juristes, comme condition essentielle de la survie de la tradition civiliste. La linguistique reste l’une des grandes préoccupations des universitaires locaux. D’une part, les traités rédigés en français par les juristes au xixe siècle et gardés à la bibliothèque de l’Université d’État sont rarement utilisés ; d’autre part, seuls quelques grands traités de droit civil français sont traduits en anglais et ne sont d’ailleurs consultés qu’en version traduite par la plupart des juristes, qui délaissent la version originale. Sans la maîtrise préalable du français, il leur est difficile d’utiliser les ouvrages des juristes louisianais du xixe siècle et des grands auteurs français non traduits. Or, la traduction ponctuelle et expéditive, souvent trop littérale, des extraits de grands ouvrages selon des besoins pratiques, annihile les potentialités d’interprétation et de réflexion à partir de ces ouvrages. Rien ne remplace les travaux scientifiques collectifs de traduction du point de vue de la précision terminologique, de la rigueur technique et du recul historique77. Cette carence dans la traduction en droit civil s’ajoute aux facteurs risquant d’affaiblir la tradition civiliste en Louisiane, contrairement à la situation du Québec78 qui a su mieux préserver sa culture civiliste française à travers sa langue. En formant plus de juristes bilingues anglais‑français, la Louisiane cherche à préserver et mieux faire vivre son système, voire à diffuser plus largement sa culture juridique comme source d’inspiration des standards internationaux.
Au-delà de la question de l’efficience de chaque système juridique, le droit de common law n’apparaît pas comme le plus adapté aux rouages de l’économie, en raison de sa plus grande imprévisibilité par rapport au droit civil des pays romano‑germaniques79. La vigueur d’un droit mixte comme celui de la Louisiane malgré la pression culturelle anglo‑saxonne, ne saurait nous surprendre. Les systèmes inutiles tendant à disparaître d’eux‑mêmes, la résistance d’une telle tradition n’est pas fortuite. Sa survie nous questionne sur les différentes manières de problématiser la construction d’un droit supranational – pour ne pas dire « plurinational » – à l’échelle européenne, et sur le rôle historique des juristes français80. Récemment, plusieurs membres de l’Union Européenne dont la France ont admis ou envisagé d’admettre l’anglais comme une langue optionnelle de procédure81. Tout comme les Law Schools, le droit américain jouit d’un grand prestige en Europe, d’où sa réception croissante ne serait‑ce que dans les « parcours d’excellence » des universités. L’anglais demeure, pour l’instant, la langue vernaculaire du xxie siècle dans les contrats internationaux82. Or, le Code civil de Louisiane est non seulement pratiqué par des juristes maîtrisant deux cultures juridiques, mais est aussi porteur d’un anglais civiliste qui ne provient pas d’un pays de common law83. Ce qu’il faut appeler un « anglais de droit civil84 » pourrait fournir les bases d’un langage commun aux civilistes d’Europe, universitaires et praticiens compris, au‑delà de la conscience historique du ius commune hérité des droits savants médiévaux.
Le français reste parlé et utilisé au‑delà même des anciennes colonies, l’espagnol étant pratiqué dans la majorité de l’Amérique latine et de plus en plus aux États‑Unis. En somme, le droit civil « pluriculturel » de la Louisiane reste accessible dans des langues connues, au moins passivement, d’une majorité d’acteurs économiques et de professionnels du droit dans le monde. Aussi ce droit posséderait‑il « cette dose d’universalisme nécessaire pour s’adapter à différents endroits et à différentes cultures85 ». Le Code civil de Louisiane et le modèle qui l’anime, apparaissent bien adaptés aux relations économiques transfrontalières. Les juristes, administrateurs et élus européens pourraient‑ils méditer cette expérience historique originale du droit, dans une réflexion comparatiste à l’aune d’un futur « code civil européen » ? Une telle discussion n’en est sans doute qu’à ses débuts.
Conclusion
Les juristes français se sentent en terrain connu lorsqu’ils se plongent dans le Code civil de Louisiane, alors même que les réformes des dernières décennies s’inspirent ponctuellement du droit allemand, du droit néerlandais ou du common law anglais. Au fond, l’évolution récente du Code louisianais l’a rendu moins français qu’il ne l’a été, mais peut‑être plus européen par la variété de ses sources de révision. À défaut de disparaître, l’opposition des grands systèmes juridiques semble avoir vécu. Depuis la décolonisation, la fin de la Guerre froide et l’accélération de la mondialisation économique et financière, nous vivons à l’ère d’un « marché du droit » sur lequel les États peuvent choisir les matériaux qui conviennent à leur ordre juridique – les droits mixtes de l’Afrique du Sud, de la Namibie ou encore du Sri‑Lanka suffisent à le montrer. Toute entité politique peut évidemment compléter son droit par des éléments issus de différents systèmes, mais l’expérience de la Louisiane montre, à travers l’histoire de son Code civil, de sa jurisprudence et de sa doctrine, qu’un droit homogène peut se construire dans l’articulation de deux traditions juridiques héritées d’anciennes puissances coloniales. Une approche tocquevillienne autorise à dire que l’essence libérale des institutions américaines a contribué à faire vivre la tradition civiliste comme un héritage culturel freinant les velléités d’assimilation intégrale de l’ancien Territoire d’Orléans au common law. C’est pourquoi il est juste de parler, non d’un système civiliste, mais plutôt d’un modèle civiliste en Louisiane, « taillé » par le juge et, dans une moindre mesure, par l’universitaire. Le mouvement des hommes et des idées nous ramène sur le temps long aux origines de notre propre culture, parfois sous des traits inattendus. Le libéralisme philosophique et politique américain apparaît bien comme un vecteur de la résistance locale de traditions juridiques européennes conciliées aujourd’hui avec le common law. À l’instar du Code civil du Québec, le Code civil de Louisiane reste un point focal autour duquel se (re)dessinent les méandres d’une culture juridique universelle née à Rome, et réunissant aujourd’hui les héritages de deux grands systèmes de droit à travers les aléas d’une histoire coloniale devenue mondiale.