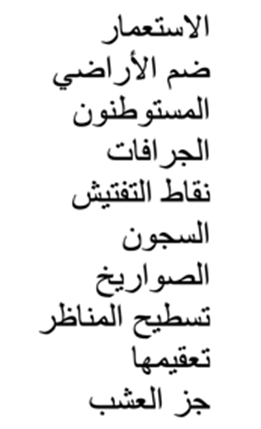Et après ? Que feront les rescapés de la terre ancienne ?
Reprendront-ils le récit ? Qu’est le commencement ?
Quel est l’épilogue ?1
Mahmoud Darwich
« Fait rare dans l’histoire de la littérature, le nom d’un pays, la Palestine en l’occurrence, est devenu en soi une poétique2 », observe Abdellatif Laâbi en introduction de la troisième anthologie qu’il consacre en 2022 à la poésie palestinienne. Dans le vaste paysage des poésies migrantes, les œuvres palestiniennes occupent une place singulière : écrites souvent en arabe, parfois dans une autre langue de la diaspora, toutes sont porteuses d’une histoire marquée par les conflits et les exodes, les déplacements de population sur le territoire palestinien, l’exil consécutif aux guerres et à la colonisation : pour le poète Ashraf Fayad, « Être sans pays/veut nécessairement dire être palestinien3 ». Plusieurs générations de poètes se sont succédé, diversement décrites dans des anthologies qui ancrent les formes poétiques dans l’histoire du territoire qu’elles arpentent. Ghassan Zaqtan distingue ainsi, dans Le Poème palestinien contemporain, les générations de la Nakba – la Catastrophe4 – en 1948, de l’Al-Naksa – la Rechute – en 1967, à la suite de la guerre des Six Jours5, et une poésie du Mahjar6 – l’émigration –, enfin, où la Palestine se constitue « dans l’imaginaire comme une nouvelle “terre promise”7 ». D’autres, comme Abdellatif Laâbi, soulignent, après le temps des précurseurs au début du xxe siècle8, l’importance de la génération des années 1960-1970, dont Mahmoud Darwich est le « porte-flambeau », pour constituer une « identité nationale et culturelle palestinienne9 ». C’est toujours en termes de « poétiques » que ces étapes de construction d’une poésie d’origine palestinienne sont décrites, traduisant les liens indéfectibles entre la situation – géopolitique, sociale, historique – de la Palestine et l’écriture. Les migrations contraintes, déplacements internes des populations, exodes, diasporas, forgent des représentations sociopolitiques dont les circulations composent l’identité même de la création littéraire palestinienne. Une sociopoétique10, donc, qui se constitue, selon des modalités différentes, sur les territoires palestiniens et dans la diaspora11. Face à la violence de l’histoire contemporaine, elle désigne ontologiquement une situation d’écriture toujours confrontée à son propre anéantissement. Hassan Makhlouf l’exprime dans « je suis un homme plein de trous » : « Je suis un homme plein de trous/Je suis venu au monde/pour combler le vide avec du sens12 ». Olivia Elias mentionne quant à elle dans Point de suspension « les petits carrés de notre effacement13 ». Dans Ce Mont qui regarde la mer, la Palestine est définie par la métaphore des trous qui perforent à la fois le territoire, l’identité et la langue : une métaphore qui rappelle le poème d’Henri Michaux, « Je suis né troué14 ».
langue comme terre
pleine de trous
mots ne veulent pas prendre consistance
s’échappent par les trous
ne sais que répéter répéter
mon
nom
n’est pas
Personne
du
pays
de
Personne15
Aussi les poétiques de la diaspora palestinienne entrent-elles en lutte contre le danger d’effacement, tout en portant profondément l’empreinte du plus grand péril dont elles témoignent à distance. C’est cette tension entre effraction de l’événement et défense de la Palestine qu’exprime la poésie palestinienne de l’exil.
L’œuvre d’Olivia Elias, poétesse de la diaspora palestinienne
Dans ce paysage poétique et politique très largement dessiné par les œuvres de poètes palestiniens encore présents dans les territoires occupés – souvent diffusées à l’étranger par le biais d’anthologies16 – et les poètes de l’exode17 écrivant le plus souvent en arabe, la poétesse de la diaspora palestinienne Olivia Elias présente la singularité d’écrire en français18. Son œuvre poétique convoque tout d’abord un itinéraire personnel entre trois continents. Née à Haïfa en 1944, Olivia Elias est contrainte par la Nakba, en 1948, à prendre le chemin de l’exil avec sa famille : « Nakba mot monstrueux qui se nourrit de notre sang19 », écrit-elle dans Ce Mont qui regarde la mer. Elle souligne dans un entretien récent la présence ravivée de ce passé de la Nakba dans le présent de la Palestine :
Ce qui se passe sur nos terres ancestrales ravive une douleur profonde, ancrée dans notre histoire familiale et collective. Celle de notre expulsion, de notre remplacement et de notre persécution, qu’un mot, Nakba, la Catastrophe, résume. Une douleur continuellement ravivée car, pour nous Palestiniens de l’intérieur ou de la diaspora, le passé n’est pas le passé20.
Après un passage par Alexandrie, la famille rejoint le Liban où est établie une branche de la famille paternelle21. À l’âge de 16 ans, Olivia Elias part à Montréal où elle fait ses études en sciences économiques avant d’y mener une carrière professionnelle qui l’amène à voyager, notamment en Inde, et à enseigner l’économie en IUT et comme chargée de cours à l’université du Québec à Montréal. Elle s’établit en France en 1982. Après un livret en auto-édition (Je suis de cette bande de sable, 2013), Olivia Elias publie pour la première fois un recueil d’une facture militante et descriptive qu’elle ne mentionne plus dans sa bibliographie (L’Espoir pour seule protection, Alfabarre, 2015) et se consacre à son œuvre poétique. Ton Nom de Palestine (Al Manar, 2017, réédition La Feuille de thé, 2025) est un recueil inspiré de l’œuvre d’Aimé Césaire22, présenté par Khaled Najar en ces termes : « Ses poèmes évoquent la Palestine. Destruction et sang, celui des siens répandu depuis des décennies dans les rues – et également soleils de Méditerranée. La Palestine, sa souffrance. Sa poésie, un cri de douleur silencieux […]23 ». Le recueil est traduit en anglais par Sarah Riggs et Jérémy Victor Robert, illustré d’œuvres originales de Basil King24 et publié à New York sous le titre Your Name, Palestine (Worlds Poetry Books, 2023). Chaos, Traversée (La Feuille de thé, 2019) naît également des déflagrations que l’Histoire produit dans la conscience intime de l’autrice contrainte à l’exil : les poèmes racontent précisément la « traversée » du « chaos » du monde. Chaos, Crossing en est l’édition bilingue augmentée, traduite en anglais par Karem James Abu-Zeid, avec une préface de Najwan Darwish (Worlds Poetry Books, 2022)25. Revenant aux origines, Ce Mont qui regarde la mer (Cambourakis, 2025) est ancré sur le mont Carmel qui surplombe Haïfa. S’affrontant à la violence extrême et à l’effacement, aux destructions et aux plaies béantes qui s’ouvrent dans l’actualité même de l’écriture, Olivia Elias tente obstinément de redessiner les contours de la Palestine. Enfin, Point de suspension (L’Amourier, 2024), œuvre co-écrite par Olivia Elias et Michaël Glück, est constituée de chroniques, ou « carnets de bord26 » où les deux poètes diaristes évoquent successivement, depuis la France, la violence vécue au quotidien à Gaza. Le titre renvoie aux points de suspension des textes que Michaël Glück publia sur les réseaux sociaux après les attaques du 7 octobre 2023 : contre le désespoir et l’engrenage de la haine, il exprime le vœu insensé d’une « Suspension dans le cercle infini de la haine. Une suspension. Dans le cercle infini des représailles27 ». Mais ne se produit « ni trêve ni pause ni accalmie ni suspension ni arrêt à peine le temps de la relève, à peine celui de laisser le béant, le creusé, le troué, le blessé se refermer28 ».
Palestine, « l’appel de ton nom29 »
Comme en atteste l’héritage culturel occidental de textes fondateurs – l’exode hors d’Égypte des Hébreux dans l’Ancien Testament, la fuite en Égypte de Marie et Joseph dans le Nouveau Testament et l’hégire de Mahomet quittant La Mecque pour Médine dans le Coran –,
l’exil recouvre la notion de départ contraint, d’éloignement de la résidence ordinaire et des proches avec une dimension de souffrance liée au déracinement et au dépaysement. Le lieu de l’exil peut alors devenir celui de l’absence, « le non-lieu, le nulle part » comme écrit Georges Perec à propos d’Ellis Island30.
Ainsi, selon Khalid Lyamlahy dans « Cette Palestine réfugiée en poésie » : « Lire Olivia Elias, c’est accepter de voir le monde depuis la Palestine et vice-versa. Va-et-vient indispensable, presque salutaire, entre l’ici et l’ailleurs, une manière de disséminer la résilience palestinienne, de la faire résonner par-delà les frontières31. » Ce mouvement réversible dont l’impulsion première naît de l’appel de la terre – qui inspire depuis Ovide la littérature de l’exil – oriente toute l’œuvre de la poétesse de la diaspora, « gardienne du récit », « Ariane qui déroule le fil », ainsi qu’elle l’écrit dans Chaos, Traversée : « je flaire les traces du chemin/qui va d’ici à là et vice-versa32 ».
Une représentation mythique de l’origine perdue est offerte dans Ton Nom de Palestine. Le premier mouvement de retour imaginaire en fixe une vision édénique, dans une mémoire sensorielle, en partie reconstruite ou transmise – Olivia n’a que quatre ans quand sa famille doit quitter Haïfa – :
Je suis née au pays de la beauté
la beauté devant
la beauté derrière
la beauté tout autour […]
Ta beauté ardente Ô Palestine chemine
à nos côtés sur les chemins de l’exil
avec dans nos baluchons
un peu de cette terre rouge
talisman sur l’autel des disparus33
« Olivia Elias enjambe les villes et les continents pour cultiver l’art du décloisonnement poétique34. » Depuis la « prison » de l’exil, l’évocation de la terre natale emprunte ainsi à la poésie antique et à l’Ancien Testament ses références – Odyssée, Atlantide, sortie d’Égypte – et ses accents lyriques, voire élégiaques, échappant momentanément au temps présent :
Palestine à l’appel de ton nom
les foules se lèvent chantant ton odyssée
Engloutie tu deviens éternelle […]
Je dis que le triomphe de l’amour est l’espoir
Je dis ton nom de Palestine
comme le mantra suprême de la libération
et je prends mon envol du fond de ma prison35
Le temps s’arrête sur « Ce Mont qui regarde la mer ». Olivia Élias évoque encore, in illo tempore, le « paysage autobiographique/où hommes & bêtes apaisés par/la tranquille certitude d’être de ce lieu/éternel & nouveau-né/habitent l’espace sans peser36 ». Le poème « Langue comme terre » métamorphose le mont Carmel qui domine Haïfa – appelé ailleurs mont Fuji37 – en matière organique constitutive du corps même de l’autrice, dans une rêverie élémentaire qui réunit en un temps primitif le sol palestinien et la mer Méditerranée, la terre, l’eau et la chair :
suis bien vivante faite de l’argile & du limon de ce Mont
surplombant la même mer sur laquelle brille le même soleil
qu’aux premiers temps38
Dès lors, les premiers mots de tous les recueils ancrent au cœur de la migration une poétique qui, associant imaginaire de la terre, références mythologiques, généalogie et transferts cosmiques, dessine une cosmogonie originelle. « Conspiration des arbres et des vieilles pierres », premier poème de Chaos, Traversée, s’ouvre sur une « lumière blessée » qui « migre », associée à l’évocation fondatrice des oliviers :
la lumière blessée
migre dans les étoiles
laissant des fragments
argentés aux branches
des oliviers39
Chaos, Crossing confère à la migration une dimension cosmique : « Migration des étoiles » est le poème du recueil inaugural. Le motif de l’instabilité, sidérale, parcourt l’imaginaire d’un pays où « les étoiles n’étaient pas stabilisées », « pouvaient tout aussi bien s’envoler d’un seul coup migrer vers des contrées où le bonheur est moins précaire/Et c’est ce qui arriva40 ». Ce Mont qui regarde la mer donne à la Catastrophe une même dimension cosmique :
il y eut des éclairs
un tremblement de terre
le soleil devint noir
la lune comme du sang
& les étoiles sont tombées du ciel41
« Migration des étoiles » lie une telle cosmogonie au symbole de l’olivier – non plus l’arbre aux branches duquel s’accrochent quelques fragments de lumière, mais l’arbre arraché dont l’évocation fait référence au prénom de la poétesse : « savez-vous le bruit que fait un olivier qui s’écroule racines en l’air 42 ? » L’image édénique des origines s’altère en visions de dévastation, liées non pas à la perte exilique, mais à l’occupation de la Palestine. Dans Ce Mont qui regarde la mer, l’image de l’olivier se développe en « Tour-Forêt » dont la destruction signe l’impossibilité du « refuge » :
Tour-Forêt
oliviers amandiers arbres
de toutes sortes par millions tronçonnés
incendiés racines à l’air transplantés
pour orner leurs places & jardins
déboisée la forêt séculaire
refuge des familles
aux portes de
Bethléem43
Dans la lettre qu’il adresse à Olivia Elias en guise d’envoi de leur recueil partagé, Point de suspension, Michaël Glück souligne l’importance du prénom Olivia, devenu arbre, forêt, pays perdu, propre à désigner la terre « dévastée » de l’origine, mais aussi un art poétique lancé à l’assaut d’un monde de fureur :
Cela commence toujours par les mots, par un nom, un nom mis pour un autre, un pronom, elle en place de ce nom-là par exemple : Olivia. Un mot, un nom-rameau dans le bec d’une colombe rêvée, annonciatrice d’après déluge. On ne sait ce qui tombe, ou plutôt on feint d’ignorer le déluge des bombes qui tombent sur une terre déjà dévastée. On feint, on peint des paysages de langues tourmentées, hantées par des cris. Olivia, un nom d’huile sainte et bénie dans une lampe de terre cuite. Olivia, un prénom d’ombre fraîche et de paix : salam, shalom. D’une paix, sinon impossible, du moins improbable44.
Ainsi, le prénom de la poétesse et le pays perdu – « Embastillée Palestine » qui « enterra sa douleur au pied des oliviers45 » – se rassemblent imaginairement dès le début de l’œuvre. Quand il est question d’un pays qui n’a jamais connu la paix, Michaël Glück convoque à nouveau le prénom-arbre de la poétesse qui, depuis son exil, l’incarne : « on a oublié peu à peu le goût de l’huile, la beauté d’un rameau d’olivier »… et il est alors symboliquement question de l’écriture du témoignage : « on manque d’eau pour fabriquer l’encre nécessaire à l’écriture de nos témoignages46 ». Mais c’est également la destruction par le feu, réelle, que ces images expriment. Les assaillants affament le pays de l’origine en détruisant toutes ses ressources, « les oliviers ne donneront rien cette année, les oliviers ne sont plus des oliviers, ils sont reliques pour des charbonniers, stères des gagne-peu ou bien souvenirs d’ombre47 ».
Les allusions autobiographiques à l’exil se disséminent dans Ton Nom de Palestine comme dans les poèmes de Chaos, Traversée. Le premier recueil indique avec précision les coordonnées toponymiques de la ville de naissance, Haïfa, comme pour fixer avec certitude la géographie d’un monde perdu, immédiatement énoncé comme tel :
Je suis née à cette latitude et à cette longitude-là : 32°48’46 ’’ Nord, 35° 00’8 ’’ Est, 548 mètres au-dessus de la mer. Très précisément. Car tout le reste a bougé, mon pays, mon lieu et ma maison. Mon pays qui n’est plus mon pays. Mon lieu qui n’est plus mon lieu. Ma maison qui n’est plus à moi48.
Cette « géographie intime » ne disparaît pas en raison seulement de l’exil. Dans les affres de l’histoire contemporaine, la colonisation, la domination, les destructions, les expulsions n’ont de cesse d’effacer la Palestine, « pays biffé49 » du poème « Amnésie » :
géographie intime marquée
par chapelet de villes
dont le nom clignote dans
la nuit
pourquoi perdues trouées
défigurées
Haïfa Beyrouth Damas50
Le processus qui affecte par rebond les Palestiniens de la diaspora efface non seulement les villes, mais également « le nom de nos pères/& de nos enfants », « notre histoire/millénaire » ; c’est l’existence même qui devient une « fiction », « à l’instar du sol sur lequel/nous marchons51 ».
Dans Chaos, Crossing, le poème « Feu de la brûlure » inaugure un imaginaire de l’éruption, de l’incendie, du séisme, de la prison – autant de désignations de la Catastrophe et de ses conséquences – propre à la représentation de la Palestine occupée. Il formule également, de manière litanique, la perte du nom – pays, père, ancêtre – et montre combien l’occupation des territoires palestiniens et l’exil forcé qui s’ensuit attentent à l’identité même : à l’ascendance, à la généalogie, au nom.
Je suis née
En ce temps
Éruptif
Où mon pays changeait de nom
Je suis née
En ce temps
Sismique
Qui engloutissait
Jusqu’au nom
De mon père
Et du père
De son père
La terre
Tremble toujours
Et l’ombre
De la prison
S’étend52
L’identité exilique de la poétesse, « éternelle passante éternelle absente53 », est étroitement associée à l’imaginaire du pays absent. Cette absence – déracinement et désolation – constitue l’expérience paradigmatique de l’exil. La nostalgie qu’expriment ces vers – étymologiquement douleur (ἄλγος, álgos) du retour (νόστος, nóstos), mal du pays – conduit à une identification avec l’objet perdu. Dans la désincorporation de l’exil, la Palestine s’apparente à un « membre-fantôme » que suggère la métaphore de l’amputation, à l’origine d’un processus neurologique : « la douleur du membre fantôme (nommée) » se rattache à « l’empreinte indélébile » gravée « sur la carte du monde/& dans le cortex54 ». Cette expérience singulière de la diaspora réunit le corps de l’exilée et le pays perdu dont le nom menace d’être effacé. Le poème construit physiologiquement une identité-peuple exilique. Dans Ce Mont qui regarde la mer, le poème « Ne suis pas un fait divers » syncope le rythme et la diction pour évoquer un « peuple voix souffle/cou coupés55 », hommage au recueil Soleil cou coupé d’Aimé Césaire repris d’Apollinaire. Dans « J’écris d’un pays perdu », c’est une question sans réponse qui qualifie la relation entre l’écriture poétique et la double perte d’un lieu « en marge de toutes les marges » :
comment continuer d’écrire en ce lieu perdu
en marge de toutes les marges ?
ce lieu qui est le mien
la question résonne en une immense
déflagration qui obscurcit
le ciel56
Selon Edward Saïd, l’écriture fonctionne pour les exilés marqués par des dynamiques de déterritorialisation comme un effort pour surmonter la paralysie de l’éloignement. La condition d’exilé est une douleur : « [L’exil] est la fissure à jamais creusée entre l’être humain et sa terre natale, entre l’individu et son vrai foyer, et la tristesse qu’il implique n’est pas surmontable57. » Mais l’exil qu’évoque Olivia Elias n’est pas en premier lieu celui de la migration : il s’ancre originellement dans une terre assiégée, où « un Mur bouche l’horizon », où surgit « une maison de béton », « bientôt suivie de milliers d’autres toutes semblables ». Les frontières qui se dressent, le « volcan prêt à exploser58 », les laves qui jaillissent, la maison et le champ qui s’évanouissent, l’eau qui s’arrête de couler. Par le bouleversement de ces forces telluriques, c’est la terre même qui dénonce la colonisation. Dès lors, l’exil pensé dans les poèmes d’Olivia Elias dépasse le témoignage intime pour raconter l’histoire d’un peuple exproprié. Dans Ton Nom de Palestine, cet horizon d’un exil indéfini est dessiné, dont sont égrenés les noms des stations, en Jordanie, au Liban, en Syrie :
Mais vint le temps de l’exil. […] Les derniers attendirent en file valises sur la tête, pataugeant dans l’eau du port, d’embarquer sur les navires qui les emmenaient vers l’ailleurs. Avant eux, d’autres furent poussés à bord de camions ou de trains. […] Au bout du petit matin, le train qui les emmena fit une halte à Amman, puis à Beyrouth et ainsi de suite. Les derniers descendirent à Damas, Dimachq, El Cham, la ville au milieu de laquelle coulait la Barada.
Ils ne surent qu’après qu’il leur faudrait attendre si longtemps pour cueillir à nouveau les oranges de leur jardin59.
La chronique de l’exode témoigne des routes, des traversées, des transits par navires ou trains dont les stations marquent de nouveaux lieux de vie, au hasard des pérégrinations. Un devenir universel des migrations contraintes s’inscrit dans l’histoire intime dont Ton Nom de Palestine témoigne. L’exode palestinien devient ici l’archétype du départ sans retour. Il exprime l’une des acceptions historiques de l’exil : « Peine qui condamne un individu à quitter son pays, soit définitivement, soit temporairement, l’exil est historiquement une forme de bannissement, une “punition par l’espace60” qui interroge le rapport au pouvoir et la manière dont ce dernier circonscrit ses limites territoriales et ses valeurs politiques61. »
Archétypal, l’exil palestinien est également universel. Dans Ce Mont qui regarde la mer, son expansion par terre et par mer atteint les océans – symboles des migrations contemporaines – pour devenir un « exil-sentiment océanique » :
océan Arctique
Méditerranée Manche
vies ballottées
coques disloquées
exil-sentiment
océanique62
« Vague après vague », les figures de la migration butent « sur forteresse Occident/béton armé/& barbelés soldats/prêts à tirer63 ». Implicitement suggérées, les frontières européennes surveillées par l’agence Frontex, les points de passages hérissés de barbelés – telles les barrières de Ceuta et Melilla – ou encore « la jungle/aux portes des cités » où l’Europe « encage/ceux d’ailleurs64 » se superposent aux images des postes-frontières israéliens, blocs de béton du mur – « barrière de sécurité » – et checkpoints en Cisjordanie, à Abou Dis ou Bethléem. En Palestine, la route des populations civiles déplacées ou en fuite rencontre la mort. Ainsi dans « Homme, enfant, route », à Khan Younès, « zone humanitaire dite sûre » :
un homme jeune
sur des béquilles
un enfant
une route
une route chemin de terre labouré
dans paysage d’outre-monde […]
tous deux avancent dans le Corridor de la Mort65
Déplacées, migrantes, en exil ou en fuite, en Palestine ou aux frontières de l’Europe, le destin de populations déshérentes, exclues des droits fondamentaux, accuse « l’ensauvagement du monde ». Ton Nom de Palestine évoque la dérive en pleine mer d’un « homme accroché à un canot » : « Sa vague d’épouvante continuera/de creuser un trou où viendra/mourir peu à peu la lumière66 ». Dans le sillage de l’exil palestinien, ce « mutant cabossé67 » devient dans les poèmes suivants la figure allégorique de toutes les migrations contemporaines, de celles et ceux qui « avancent pas après pas », « labourent les terres d’Europe les chemins écartés68 », figures porteuses d’un espoir insensé69 : « Il n’y a plus que la route/et ce pays qui ne veut pas de moi/voyageur sans bagage70 ». Traversées, départs, marches « depuis si longtemps/au bord de nos terres » relèvent de l’histoire globale des migrations qui s’enrayent dans une répétition tragique, et dont Ce Mont qui regarde la mer psalmodie la litanie sans fin :
marcher encore tourner
en rond s’accrocher
à la moindre racine faisant
de grands signes
aux bateaux passant au loin
depuis si longtemps
au bord de
marchons71
La poétique accomplit ici l’expansion d’images précisément situées sur le territoire palestinien à une vision-monde des errants contemporains. Une telle expansion constitue l’expression d’une écopoétique palestinienne. Khalid Lyamlahy la commente dans « Cette Palestine réfugiée en poésie » : « Olivia Elias repousse les limites du poème, gravant la douleur des Gazaouis dans l’ordalie des réfugiés de tout bord » : « la poésie martèle que la question palestinienne reste indissociable du Vivant72. » Aux portes de l’Europe et en Palestine, la Mort est « passagère clandestine des navires73 ». Pour les Palestiniens comme pour les réfugiés dans le monde, le recours à l’oikos, le lieu où l’on habite, est remplacé par l’impossibilité d’habiter le territoire de ses origines et les contraintes d’un « habiter dehors » – pour les exilés – ou d’un « habiter l’inhabitable74 » – pour les Palestiniens déplacés dans un territoire détruit et menacés de mort. Habiter auprès du Mur et des maisons de béton revient à « camper au bord d’un volcan prêt à exploser75 ».
Sociopoétique de la guerre, sociopolitique de la poésie
Incluant les migrations internes des populations déplacées ou fuyant les zones de feu après le 7 octobre 2023, Michaël Glück évoque dans Point de suspension le continuum meurtrier entre guerre et exodes : « … n’a pas cessé le feu, n’a pas cessé non plus la guerre, ni exodes ni destructions, ne se sont pas arrêtées a peur, la faim, la soif, n’ont pas accepté de rester au fond, se sont exondés les noyés, n’ont pas survécu à l’exil, à la traversée des terres brûlées, aux interminables pluies de bombes76 ». Une autre singularité du conflit, liée à la précédente, est que l’exode palestinien se joue sur le territoire même, soumis aux oppressions et à la colonisation.
En temps de guerre, la poésie de la diaspora palestinienne met en scène de manière obsessionnelle la distance creusée entre les lieux de l’exil et celui de l’origine abîmé dans la guerre. Les « bombes/pleuvent là-bas/ici aussi/à des milliers de kilomètres77 », « à des milliers milliers de kilomètres des immeubles/s’effondrent sur les Vivants comme châteaux de cartes78 ». La multiplication des espaces typographiques qui amplifient et fracturent le vers accentue la distance, la fragmentation du vers troué accuse et dénonce la violence paroxystique. Mais en même temps qu’elle est ainsi désignée, la distance d’avec le territoire de l’origine est paradoxalement anéantie : « à chaque explosion la maison vibre vont-ils débarquer/chez moi79 ». Confrontée au déchaînement de la violence en Palestine, la poétesse en exil témoigne, subit les dommages dans son corps, « les sons réverbèrent/de cœur à cœur80 », ils affectent le psychisme81 : « Quand on est une Palestinienne de la diaspora, on affronte les cauchemars en plein jour82. » En exil, l’extériorité est impossible, quand les poèmes témoignent du paradoxe d’une écriture intérieure, incorporée. Or, cette incorporation poétique est précisément le signe d’une résistance aux injonctions à se tenir à distance et de la volonté d’être partie prenante :
Écrire en dehors est-il recommandé
comprendre garder une distance
quel en dehors lorsque dedans tellement
réduit en miettes tellement explosé
qu’il tient tout entier dans une tente83
À distance, mais situant son écriture obstinément au cœur même d’un chaos planifié, Olivia Elias dédie ses poèmes aux villes martyres, dessine une toponymie de la destruction. Aussi la nomination constitue-t-elle le principe vital d’une poétique en lutte contre l’effacement de ce « pays-peau-de-chagrin84 » car « cela commence toujours par des mots, Gaza85 ». Gaza, renommé « Gaza-Ghetto86 », territoire de toutes les attaques – « ghetto & bantoustans prisons bombes & extinction87 » – est cité plus de quinze fois dans le recueil : « n’ai vu que bombes & encore plus de bombes sur Gaza88 », témoigne la poétesse, dont l’espace de vie occidental que symbolise l’automne s’efface littéralement devant « le déluge phosphorique89 » subi en Palestine. Dans Ce Mont qui regarde la mer, l’histoire est présente avec la scène de massacre de Sabra & Chatila90, deux poèmes sont consacrés à la ville martyr d’Huwara91, les villes de Palestine – aussi terrains de guerre – « Gaza Jabaliya Chajaya Khan Younès/Jérusalem Bethléem Hébron Jénine Naplouse92 » sont nommées dans « J’écris d’un pays perdu ». Dans « Amnésie », la « géographie intime » est encore marquée par les villes de Haïfa, Beyrouth, Damas, « perdues trouées », « défigurées93 ». La géographie de la destruction est inscrite dans la prosodie qui troue le vers et en ouvre l’espace lacunaire comme une béance, véritable principe de composition du poème. Dès lors, la nomination entre en résistance contre la « Tabula rasa » de « cinq cents villages rasés94 » et contre la volonté guerrière d’inscrire « un nouveau récit » « par le glaive & le feu ». Par la nomination, le poème rend également hommage, dans une épitaphe en lutte contre l’effacement, au poète et activiste palestinien Refaat Alareer95, tué à Gaza le 6 décembre 2023 lors d’une frappe israélienne et dont la postérité est portée par les cerfs-volants de son poème « If I must die ».
Nommer est le premier acte poétique et politique de l’écriture diasporique. Dans le poème « Dis mon nom », il est une injonction : « dis mon nom radioactif », « dis mon nom ancestral en pièces96 ». Face à l’action de destruction massive, Olivia Elias assigne à la poésie une mission conative, dès lors que le poème est, selon Juan Felipe Herrera, « action mise en mots97 ».
C’est bien la guerre qui dessine une géographie des stations de l’errance dans la Palestine d’après le 7 octobre, que l’ennemi met en relation avec des opérations militaires contre l’Allemagne nazie et ses alliés, l’État islamique : bombardements de Berlin et bombardements atomiques à Hiroshima en 1945, bombardement et « reconquête » de Mossoul en 2014. Cependant, comme dans ces combats historiques, les victimes en Palestine sont massivement des civils et sont jetées, pour celles qui survivent, sur les routes et dans les camps de réfugiés par la « machine de guerre » israélienne :
Du nord au sud puis du sud au nord
De Gaza à Khan Younès & de Khan Younès
à Rafah de Rafah au diable sait où
errent les errants non encore dévorés
par la machine de guerre98
Dans les vagues successives de migrations, le sort des déplacés et des expulsés est fixé par la loi israélienne. Dans Ce Mont qui regarde la mer, Olivia Elias explique précisément la législation qui régit le statut des « Absents » et des « Présents-Absents », dans une note à propos du poème « Sans rémission » :
Dans le pays des Absents et des Présents/Absents. Selon la législation israélienne, les deux termes désignent les résidents non juifs (c’est-à-dire palestiniens) expulsés ou déplacés en Palestine mandataire durant la Nakba – principalement pendant et immédiatement après la guerre de 1947-1949. « Absents » désigne ceux qui furent forcés de prendre la route de l’exil sans possibilité de retour. « Présents/Absents » s’applique à ceux qui purent demeurer sur le territoire devenu l’État d’Israël mais qui furent déplacés sans pouvoir réintégrer leur lieu de vie, soit parce que leur village/quartier avait été rasé, soit parce que de nouveaux venus s’étaient installés dans leur maison. Comme dans le cas des Absents, leurs actifs, biens et propriétés ont été saisis, sans compensation aucune99.
Ce « pays qui flotte entre présence et absence100 » fait signe vers le recueil testamentaire de Mahmoud Darwich, Présente Absence101. Il en est réduit à une citoyenneté-fantôme. L’« expulsion » hors de ce territoire est l’un des signes de la violence de l’oppression. Mais dans la tension de la langue, la « présence/absence » qualifie également une identité poétique exilique :
Nous Arabes
citoyens d’un pays
au territoire
avalé par la langue
Absents
Présents/Absents
flottant sans rémission
entre ciel & terre102
Ancré dans l’histoire du temps présent, le poème « Temps a-historique » dénonce la destruction totale d’après le 7 octobre, la « folie de destruction à l’extrême/de la barbarie » opérée par des « robots-tueurs », sous le nom de code « Amalek103 » :
temps a-historique où n’existent plus
qu’Absents & Absents/Présents & millions
expulsés sur une autre planète104
Dans la guerre et en exil, Olivia Elias se présente comme « témoin », celle qui a vu, s’assignant une mission face à l’infinie réitération des catastrophes :
J’écris ce que je vois disait Etel Adnan qui en savait beaucoup
sur la force des montagnes & la Catastrophe
je connais aussi la puissance de ce Mont qui regarde la mer
Carmel de ma toute petite enfance
mont de l’absence & du déni au-dessus les grands corbeaux
noirs de la désolation
comme je connais tout de notre Apocalypse un passé qui n’en finit
pas de se répéter la terre qui pivote sur son axe le soleil
qui se voile la face
voici ce que je vois105
Etel Adnan, l’autrice d’origine libanaise de L’Apocalypse arabe, ancre sa mission poétique dans cette injonction de la Bible de Jérusalem : « Écris donc ce que tu as vu : le présent et ce qui doit arriver plus tard106 .» : « … et la réalité s’élève enfin au niveau apocalyptique de la vision d’un artiste107 », poursuit-elle. À partir du premier massacre dans un camp de réfugiés palestiniens en Jordanie en 1970, appelé « Septembre noir », toute son œuvre porte la mémoire des guerres au Liban et des camps de réfugiés. L’Apocalypse arabe compose la chronique poétique et graphique du début de la guerre civile en 1975, des massacres des Palestiniens par les phalangistes au camp de la Quarantaine le 18 janvier 1976, du siège du camp de réfugiés palestiniens de Tell Zaatar et des massacres du 12 août 1976. Dans le poème « La nuit du non-événement108 », Etel Adnan évoque les « Palestiniens sans Palestine » et les « réfugiés sans refuge ». La citant, l’œuvre d’Olivia Elias témoigne du double traumatisme de la guerre et de l’exil, pour l’une depuis la Nakba, pour l’autre depuis le second exil des Palestiniens au lendemain de la guerre des Six Jours en juin 1967 et de « la Grande Défaite ». Olivia Elias intègre l’Apocalypse dans un imaginaire plus largement mythologique : les « Conquérants », « déesses de la Vengeance & de la Conquête109 », « Kérès déesses de la Mort110 » ou encore « hordes de nouveaux Khans111 », fondent « dans la nuit comme sauterelles de l’Apocalypse112 ». Puis elle en appelle à Bosch, peintre du Jugement dernier et des Visions de l’au-delà – La Chute des damnés et La Rivière vers l’enfer, à l’Orwell de L’Hommage à la Catalogne, La Ferme des animaux et 1984 :
au royaume de Bosch & d’Orwell
incendie flambe jusqu’à
obscurcir
le ciel
ce à quoi l’on assiste
digues qui cèdent
tragédie qui avance rugissant
sur la crête
des vagues
effondrement des possibilités113
Les métaphores ensauvagées, « corps démembrés114 », « boules de fer enflammées/dans le ciel », « tourbillons rouges & noirs », « cendres noires115 » sont le prélude d’un tableau de Francis Bacon :
rêve au petit matin tableau de Bacon
où mots
accrochés aux crocs
du boucher sont l’Écorché en lieu
& place des personnages
quel que soit l’alphabet mensonges
& récits mythologiques
nourrissent le cru qui pisse
sang & terreur
de cruauté116
Le poème évoque ces morceaux d’imaginaire accrochés aux crocs du boucher propres à l’inspiration de Bacon dans Personnage avec quartier de viande ou dans ses triptyques associés à la figure récurrente de l’Érinye, comme Volaille morte suspendue accompagnée d’une Érinye. Fasciné depuis l’enfance par la viande de boucherie suspendue aux crocs, Bacon déclarait : « Nous sommes de la viande, nous sommes des carcasses en puissance. Lorsque je vais dans une boucherie, je pense toujours qu’il est surprenant que je ne sois pas à la place de l’animal117. » Ce sont les « mots » que le poème d’Olivia Elias accroche « aux crocs/du boucher » pour pointer la collusion entre l’humain sacrifié dans la guerre et l’animal accroché. La poésie confrontée à la violence paroxystique représente l’Écorché « en lieu/& place des personnages », le « cru qui pisse », « sang et terreur/de cruauté ». La poétique relève ici d’un geste de révélation de ce qui, ordinairement, est caché : la sauvagerie des atteintes aux corps suppliciés, mis à mort, le cru de l’exposition des carcasses de victimes traitées comme des animaux, dans une Palestine devenue « Ghetto dévasté », dont le peuple « se vide de son sang118 ». C’est par ces morts animalisées que la « folie de destruction à l’extrême/de la barbarie » est dénoncée, avec ses « robots-tueurs hurlant/des ordres » : « Sortez animaux humains119. »
Des visions apocalyptiques, « laves de sang » du « volcan allumé par la furie/de vengeance des nouveaux Khans », sont projetées « sur les écrans du monde entier120 ». Le poème d’exil se mue en poème de résistance dont la puissance agonique est tangible, il devient la voix populaire d’une Palestine abandonnée, en lutte contre « les Alliés puissants », le « chef du Gouvernement d’Annexion » avec ses « discours de guerre et d’extermination », le « Grand Chef d’Amérique agitant son hochet-droit-de-veto121 » :
les Puissants détournent les yeux
nous mourons par milliers & milliers
& le Chef de la Grande Nation d’Amérique
garde la main levée122
« J’écris d’un pays perdu » dénonce les « mots inscrits aux registres officiels » et « éléments de langage soigneusement/mis au point depuis plus de cent ans », parmi lesquels « Une Terre sans Peuple/Pour un Peuple sans Terre » : « j’écris & tisse des cordes de mots/pour venir à bout de cette montagne/de fables & légendes mensonges/& trahisons123 » Dans Point de suspension, le poème « Cela commence toujours par les mots » rectifie les messages mensongers propres à la stratégie de communication israélienne, en cite les sentences qui condamnent le peuple à mort : « Terroristes Tous sans exception » et les périphrases qui euphémisent ironiquement les ordres de destruction massive : « “Tondre le gazon”/“Aplanir le paysage”/“le Stériliser”124 ». Trouant les poèmes, l’italique, et plus rarement les guillemets, sont autant d’échos de la rhétorique guerrière proférée contre le pays des origines, violemment réfractés dans l’exil pour la poétesse qui vit « à des milliers de kilomètres de là », « réfugiée dans [s]a maison125 ». La langue arabe tend à abolir cette distance, tout en se dressant contre les discours et actes de guerre qu’elle évoque126 :
L’engrenage de la violence est également montré par la réitération mimétique : « Le sang appelle le sang/& la Mort se nourrit de la Mort127 ». Les stratégies de nomination – car « cela commence toujours par des mots » – dénoncent un ennemi dont l’identité est mécanique, déshumanisée, désignée par métonymies et synecdoques : « leurs bouches rampes de lancement/de missiles crachent à jet continu condamnations/à mort128 », la « forteresse Occident/béton armé/& barbelés soldats/prêts à tirer129 », « mur d’écrans des bunkers drones & missiles », « voix anonyme130 ». La violence mobilise le langage : « stériliser le langage stériliser la vie la ravir/du verbe latin rapere s’emparer de force/encager la vie le langage/les violer les cribler de balles131 ». Dans Point de suspension, Michaël Glück dénonce également en une charge agonique des exactions qui se jouent également dans l’usage des mots :
… ça fabrique de l’histoire, ça fabrique de la géographie, ça trafique l’une et l’autre, ça refait le vocabulaire, la nomenclature, la toponymie, ça change les mots, ça les détourne comme on détourne l’eau d’une rivière ou d’un fleuve ; ça assoiffe qui vit en aval, ça assèche les terres ; ça désertifie ; ça défait l’histoire, ça refait la géographie ; redistribue les cartes ; ça nomme, dénomme, renomme, pire dégomme les lieux, les anéantit ; ça arrache les enfants à leurs noms ou les attache à d’autres noms ; ça terrifie, ça fait terre, ça atterre […]132
Il exprime à quel point la poésie, confrontée à la « violence du monde », « l’ignominie de l’histoire », « l’horreur absolue du présent », est affectée au point d’en perdre le verbe : « la phrase s’est égarée », la phrase est « irrespirable133 ». Au « bord du précipice », les poèmes d’Olivia Elias réfractent l’altération de la structure du temps qui « divague/& n’en finit pas de se répéter134 » : « le temps a avalé le temps », « la nuit a avalé le jour », passé et futur sont « confondus/dans un présent de terreur135 ». Dans « Du sens & de l’usage du mot Fin II », le temps « s’auto-engendre & simultanément œuvre/violemment à son abolition136 ». Depuis une éternité, « Gaza déclaré/Zone de Mort137 ».
Contre l’aphasie et l’asphyxie, plusieurs poèmes de Ce Mont qui regarde la mer – « Langue comme terre », « Art poétique de la sauvagerie », « Âme sentinelle », « Ai écrit », « Rêve, alphabet », « Millions de x », « Dans le train » – comportent ce qui pourrait être qualifié de contre-poétique. S’affrontant à la barbarie d’événements proprement irreprésentables, la poésie doit paradoxalement y puiser la violence nécessaire à leur expression. Qualifier la nouvelle conquête requiert d’autres imaginaires et d’autres dispositifs poétiques. Dans « Art poétique de la sauvagerie », la poétesse en appelle à Fernando Pessoa pour transcrire la « blessure chauffée à blanc138 ». Les mutations poétiques sont plus radicales quand il s’agit d’une guerre totale vue depuis l’exil, qui nécessite une traduction. « Oyez, oyez », poème halluciné, s’enraye ainsi dans la répétition des mots féroces des conquérants israéliens, « avec la plus grande fermeté », « fer-metÉ/comme/Fer-chauffÉ-À-blanc » :
pluspluspluspluspluspluspluS
grgrgrgrgrgrgR
grandegrandegrandegrandegrande
grandegrande
Fermeté139
Cette contre-poétique plonge dans le lexique officiel de la « novlangue des Puissants », « novlangue joint-des-murs-de-la-prison », et s’attaque à toutes les puissances de mort qu’elle engendre – « nécropolitique », « nécrophages » – propres à transformer terre et vie en « fiction140 ». La force sociopolitique d’une poésie qui s’affronte et fait « effraction » se joue au cœur du langage, « non régimenté/par jurys & académiciens » :
suis arrivée par effraction
personne ne m’attendait
isolée dans mon coin ai dit
dans mon idiome
l’urgence141
Des syncopes rythmiques aux interpellations accusatrices, la violence du temps et « la blessure chauffée à blanc » engendrent dès lors cet « Art poétique de la sauvagerie » identifié dans Ce Mont qui regarde la mer comme une fracture au cœur même de l’écriture. Olivia Elias définit en outre la place de la poésie de la diaspora palestinienne, arc-boutée contre l’élimination sociale et physique du pays et du peuple des origines. Une poésie qui sans se lasser « tente & retente/de gravir cette Montagne/de l’effacement et de l’extinction142 ». Point de suspension exprime un espoir insensé, porté ici par Aragon :
Un jour pourtant, un jour viendra
couleur d’orange…/
un jour comme un oiseau sur la plus haute branche143
où nous nous assiérons
à la place laissée vide à notre nom
dans la grande Maison humaine
et là par l’artiste chilienne Cecilia Vicuña à qui Olivia Elias confie les derniers mots du poème : « Un jour nous serons144 ».
Conclusion
La poésie est la migrante : celle qui voyage. La poésie est la témoin : celle qui écoute.
La poésie est la survivante : celle qui persiste145.
Michaël Rosen
Dans l’ensemble d’une œuvre diasporique, Olivia Elias rend compte d’une double situation d’exode et de guerre liée à l’histoire du territoire de l’origine dont résonnent perpétuellement l’appel et le manque. Dans le paysage des écritures migrantes, elle permet de saisir la singularité irréductible mais aussi le caractère archétypal d’une poésie palestinienne de l’exil, où la poétique de la migration est indissociablement liée à une poétique de la guerre sans cesse recommencée – la diaspora étant l’une des conséquences des expulsions engendrées par la guerre. Et c’est au cœur de la poésie palestinienne de l’exil que survit cette « Palestine réfugiée en poésie146 ». « La poésie-refuge147 » correspond dès lors à la situation ontologique de l’exilée qui engage à la fois une écriture, une identité intime et un pays perdu dans l’Histoire : « Réfugiée en poésie/vis la vie qui est la mienne/sur laquelle plane l’ombre/d’une grande Catastrophe148 ». L’exode palestinien ne saurait s’écrire sans révéler ce séisme dans lequel il s’origine : car « Exil/est l’autre nom/de l’éclatement du temps/et du choc/des continents149 ».